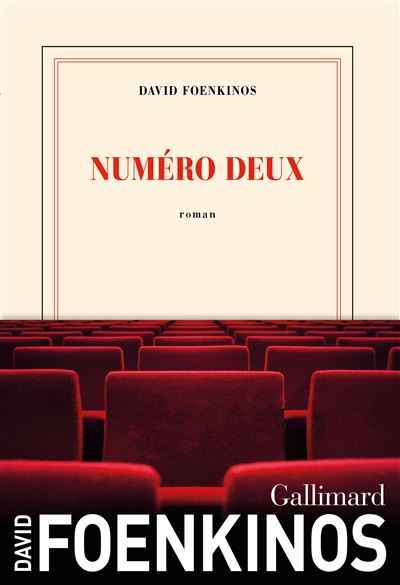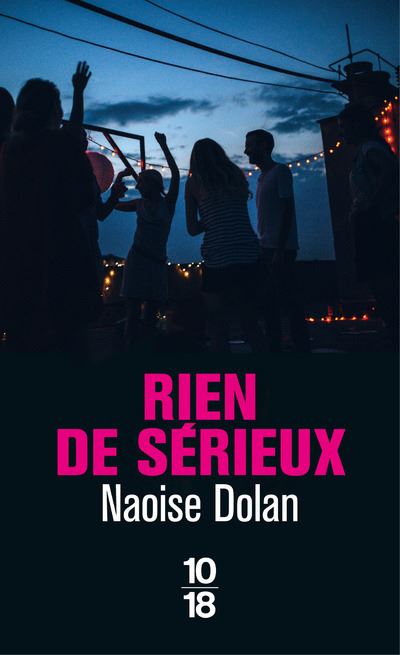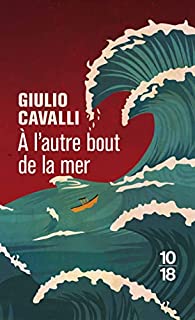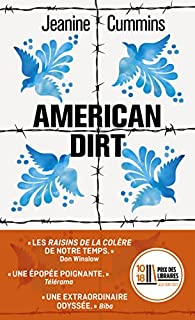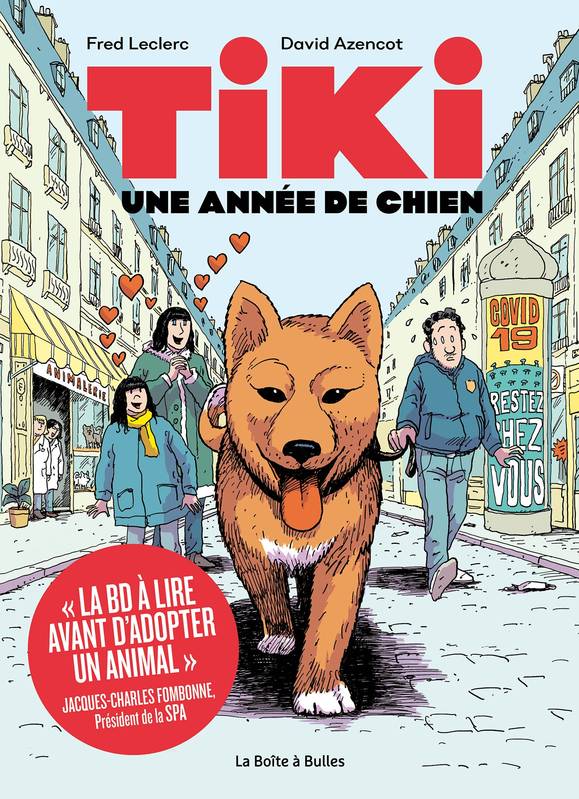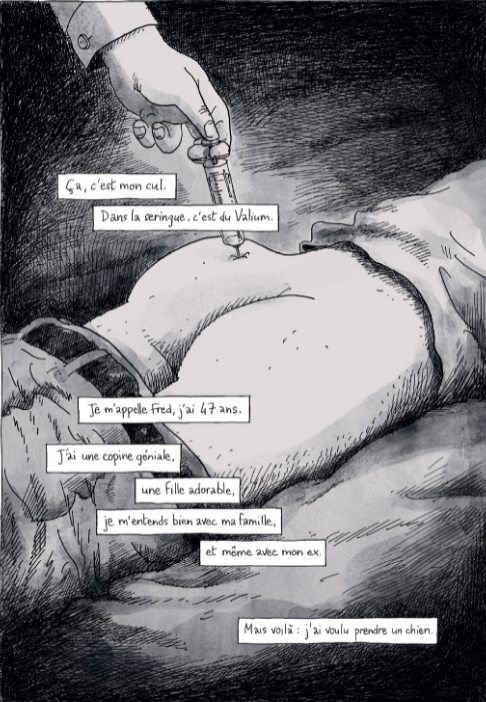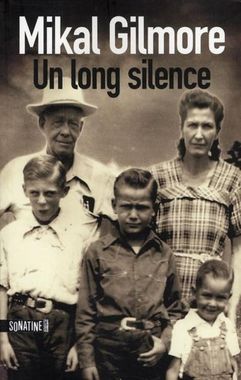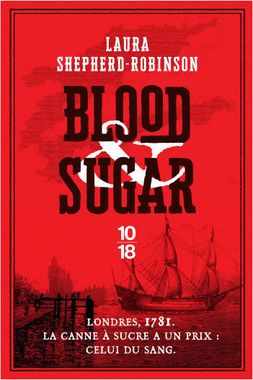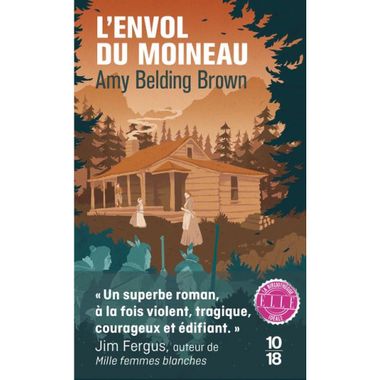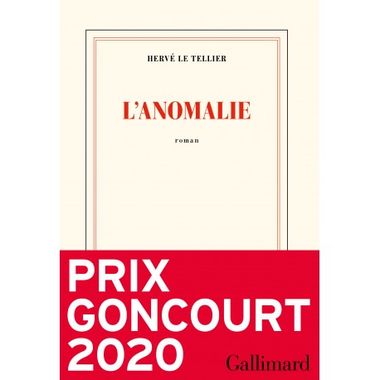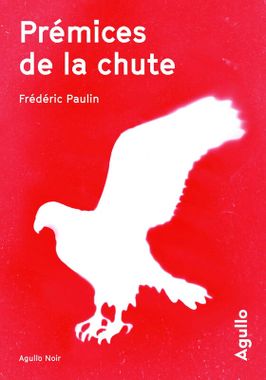Lettres d’excuses, Patrick Chesnais, Lucernaire
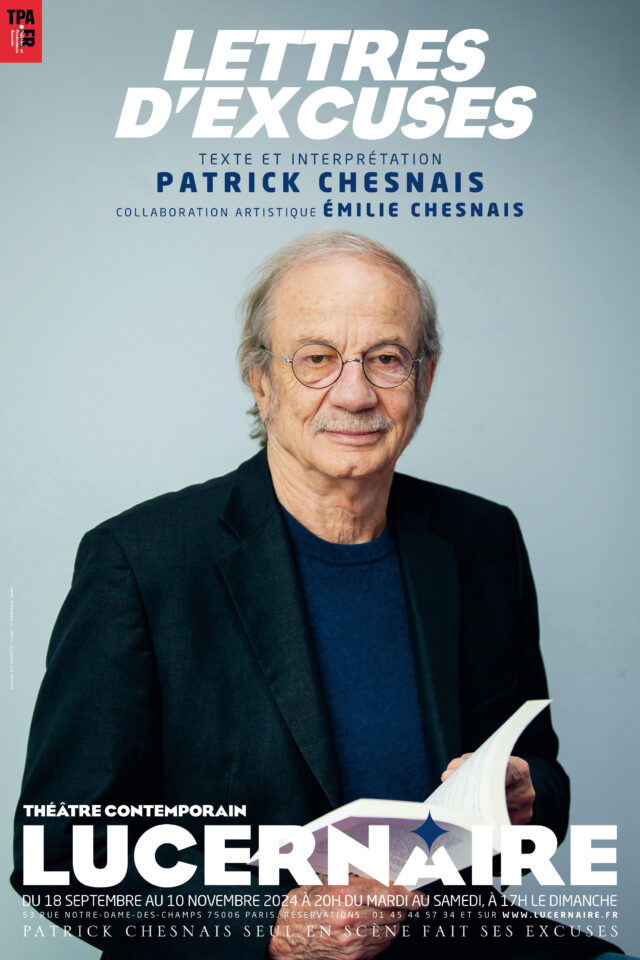
Même s'il rechigne à y croire, Patrick Chesnais vieillit. Il est des signes qui ne trompent pas : il triche sur son année de naissance, un jeune homme lui cède sa place dans le bus et puis la prostate... "La prostate qui grossit, c'est un marqueur absolu d'une grande maturité" !
À l'heure de faire le bilan, il fallait toute l'élégance de Patrick Chesnais pour dresser un inventaire fait de ratages flamboyants ou pathétiques. Depuis mon enfance ("ma grand-mère vous adore depuis qu'elle est toute petite !"), j'ai de l'affection pour ce comédien à l'air triste mais joyeux et je me souviens de ma compassion quand j'ai appris en 2006 la mort de son fils, victime d'un chauffard.
C'est d'ailleurs à ce fils décédé, Ferdinand, que Patrick Chesnais consacre sa première lettre d'excuses. "Mon petit Ferdinand, je te demande pardon de n'avoir pas pu profiter un peu plus longtemps de tes beaux yeux bleus." C'est une déclaration sobre et belle, vraiment poignante. (En l'écoutant, j'ai senti une grosse larme couler sur ma joue.)
Pendant un peu plus d'une heure, Patrick Chesnais nous lit ses lettres d'excuses écrites à celles et ceux qu'il a blessés au cours de sa vie. Il le fait sans se donner le beau rôle. Il écrit à sa mère qui a terminé sa vie en EHPAD ("Je t'ai laissée tombée, ma mère"), à sa Mémé de la Garenne, à sa jeunesse, à sa vieillesse, à Naomi Watts ou encore à Jack Nicholson.
C'est doux amer, c'est tragique et joyeux comme la vie, c'est un beau moment passé en compagnie d'un homme attachant.
Jusqu'au 18 novembre 2024
Théâtre du Lucernaire - Paris VIème
Texte et interprétation Patrick Chesnais
Assisté d'Emilie Chesnais
1h10 | de 10€ à 32€
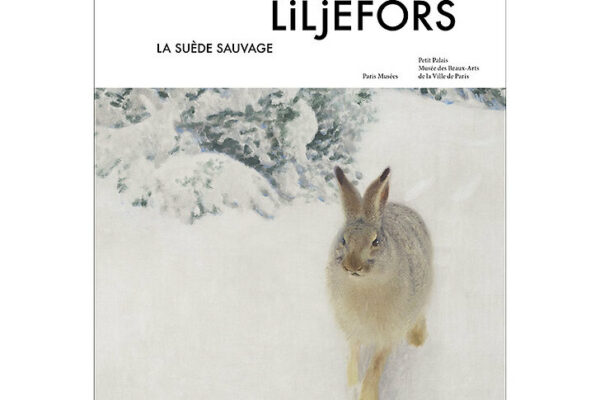
Bruno Liljefors, La Suède sauvage, Petit Palais
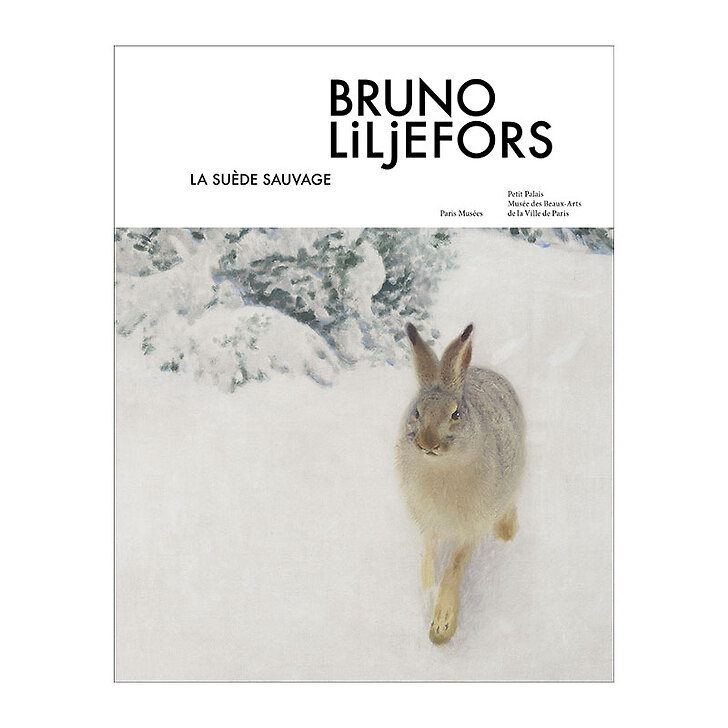
En son pays, la Suède, Bruno Liljefors (1860-1939) était surnommé le Prince des animaliers. Ce titre n'est pas usurpé. Dès la première salle, j'ai été saisi par cette irrésistible famille de renards. La touche du peintre est à la fois impressionniste et précise, il suffit de s'éloigner d'un pas pour être frappé par le réalisme des scènes présentées et par la restitution fidèle des plumes et des poils (la touffeur des queues de renard). La peinture de Liljefors est expressive mais nette.
Bruno Liljefors travaillait sur photos, sur modèles empaillés, mais il était surtout amateur d'affut et n'hésitait pas à grimper aux arbres pour observer les animaux. Peintre et chasseur, on ressent parfois sa fascination pour les prédateurs. Il montre d'ailleurs à de nombreuses reprises combien le chat est un ravissant destructeur de biodiversité.
Mésange huppées, chardonnerets élégants, bouvreuils pivoines, moineaux domestiques... (Aviez-vous remarqué que les noms d'oiseaux sont toujours composés?), l'amateur d'oiseaux que je suis s'est régalé devant ces véritables portraits d'animaux. Des portraits sur le vif, comme celui d'un lièvre courant sur la neige (tableau repris sur l'affiche de l'exposition). L'instant est saisi avec maestria.
Si vous voulez, sans sortir de Paris, vous offrir un véritable week-end à la campagne (avec une petite excursion en bord de mer), allez donc voir ces toiles fascinantes !
Jusqu'au 16 février 2025
Petit Palais Paris
de 10 à 12€ (Gratuit : - 18 ans)
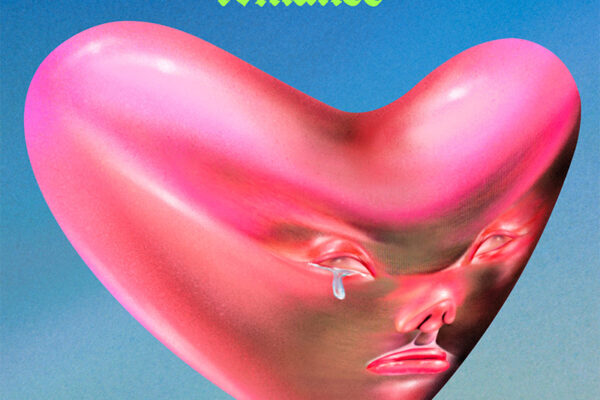
En route vers la joie ! avec Nick Cave, Fontaines DC & Cassandra Jenkins

Le moral va sombrer vers des abîmes de tristesse. Heureusement Nick Cave est là ! Je n’ai pas encore bu mes trois Spritz autorisés ! Nick Cave et ses mauvaises graines ont décidé d’être joyeux. Ce qui n’était pas franchement gagné depuis quelque albums et la disparition tragique des fils du chanteur.
On était dans le noir complet et visiblement Nick Cave a trouvé une petite ampoule. De son éclat, il invente avec son groupe fidèle une dizaine de chansons qui semblent sortir d’une euphorie toute relative pour ce crooner de plus en plus chamanique ou christique. Il semble être le digne descendant d’un Johnny Cash : en vieillissant son charisme augmente et son aura le rend essentiel.
Ce 18ème album est donc une œuvre éclairée. Les musiciens reprennent le pouvoir dans une pastorale élégante. Les paroles sont étrangement optimistes. Un chœur supplante la voix toujours troublée de Nick Cave. Dieu serait sauvage mais l’écriture des Bad Seeds prend un nouveau tournant. Ce qui est franchement formidable après les derniers opus plus qu’élégiaques et torturés. Hé oui, c’est bien Nick Cave qui nous invite à sourire.

Eux aussi, ils n’avaient pas l’habitude de nous faire rigoler mais les Fontaines DC se sont faits un nouveau look pour signifier qu’ils avaient changé leurs habitudes. Les dandys sombres sont devenus pour leur 4ème album des punks californiens.
Les gars se prennent pour Sum 41 ou les Red Hot ! Mais le changement n’est pas si radical. On retrouve toute la verve littéraire qui a fait le succès de ce groupe irlandais populaire et exigeant. James Ford, complice de Gorillaz, transforme le quintet torturé en super groupe prêt à affronter les marchés internationaux. Les musiques sont plus abordables mais pas du tout honteuses.
Le groupe n’est pas l’ersatz du groupe britannique qui veut en découdre avec le reste du monde. Il conserve avec habileté son style post punk mais assez vivace. Le disque se nomme Romance et il est évident que Fontaines DC nous fait un peu la danse du ventre. Mais le rythme et les mélodies sont agréables et il est difficile de leur en vouloir : l’ambition les pousse vers nous un peu plus et sans se trahir. Eux aussi, par surprise, ont l’envie de rire pour cette rentrée.

Mais celle qui nous donne l'envie de plus sourire c'est l'inattendue Cassandra Jenkins et son album au titre tout aussi heureux : My light my destroyer. Cette fois-ci voilà une belle découverte à la rentrée : une petite nana l'air de rien, qui convoque Neil Young, Joni Mitchell et toute la pop la plus moderne. Le grand écart est périlleux mais il se révèle merveilleux.
Elle aurait pu rejoindre le supergroupe de l'année dernière, Boygenious. Encore une artiste au fort caractère, capable de répondre à toutes les contraintes de l'industrie et servir autre chose de de la soupe pour radio à tunnel de tubes. Son album est une magnifique piège. On devine de la pop et on se retrouve avec un truc indé, qui fait semblant de fuir dans tous les sens pour surprendre ensuite par sa cohérence.
Cassandra Jenkins assume une passion pour le jazz mais son album pique dans tous les styles avec une grâce assez rare. On se marre à écouter une réelle agilité. Elle bifurque sans arrêt mais ses mélodies restent très solides et entêtantes. Il y aussi des petits interludes qui mettent une ambiance si ouatée que l'on se met à penser à une lointaine cousine de Tom Waits.
Elle fabrique un petit univers bien à elle. Elle a laissé beaucoup de places pour nous. Par les temps qui courent, ce petit monde nous fera bien oublié le notre, un peu trop triste, un peu trop flippant. Et si Nick Cave se met à rire, autant dire que l'espoir d'un monde meilleur est certain... et les autres en sont la preuve.

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Musset, Eric Vigner, Montansier

Thibault de Montalembert arrive par la salle, une bougie à la main. Ce clair obscur est assez joli. Il prend la parole et ce qu'il dit est assez obscur, aussi. Il parle de l'amour, de la passion, comme un poète, c'est-à-dire comme un mec qui aime aimer plus que l'être aimé.
Son costume est épouvantable, comme sa coupe de cheveux digne des années 90. Le comédien fut jadis Sociétaire de la Comédie Française, et cela s'entend. Il articule et surjoue la diction ampoulée du théââââtre classique.
Puis entre en scène sa partenaire, Christèle Tual. Tout deux, ils prennent des poses improbables, elle garde un bras grand levé pendant de longues minutes (mais pourquoi ? Un plaisir sadique de metteur en scène ? L'ambition de nous faire rire?). Montalembert se lance soudain dans une marche saugrenue. On se croirait alors dans le sketch "Ministry of silly walks" des Monty Python, sauf qu'ici le public n'est pas mort de rire.
A la quinzième minutes quelques spectateurs quittent la salle. Ma voisine ne peut réprimer un "j'ai envie de faire pareil !", mais je lui bouche le passage. Les lycéens au fond de la salle attendent sagement que cela se passe. Le public semble plongé dans une douce léthargie. Pour ma part, j'avais envie de rire très fort, mais j'étais au Montansier à Versailles, pas au théâtre de la Ville de Paris.
Et puis, vers la moitié du spectacle, je suis comme bercé par le texte d'Alfred de Musset qui se révèle intéressant. Le Comte déclare sa flamme à la Marquise et elle lui répond "Mon Dieu que vous m'ennuyez" ! L'auteur moque les hommes qui se ressemblent tous quand ils font la cour, qui mentent, qui enjolivent et prennent leur proie pour une gentille imbécile.
"C’est donc parce que je me suis trouvée seule que vous vous croyez tout à coup obligé, oui, obligé, pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si ridicule, si rebattue. Mais qu’est-ce que je vous ai donc fait ?"
Il m'a semblé qu'Eric Vigner n'avait pas trop su comment monter ce texte spirituel (dans le sens d'à la fois intelligent et amusant). Je regrette que le metteur en scène n'ait pas davantage fait confiance à ce texte, et qu'il se fut senti obligé de demander à ses comédiens de jouer "comique".
Sincèrement, je ne vois pas trop comment on aurait pu monter cette pièce, et je me dis qu'au moins Eric Vigner s'y est colleté. J'ai donc fini par apprécier ce spectacle assez déroutant, à l'image du texte. Manifestement, je n'étais pas le seul car, à la fin de la représentation, les applaudissements étaient nourris,
Jusqu'au 05 octobre 2024
Théâtre Montansier Versailles
1h15 | de 15€ à 32€

Le ciel en sa fureur, Adeline Fleury, Éditions de l’Observatoire

Bien que n'étant pas amateur de récits fantastiques, j'ai pris plaisir à lire ce roman bien écrit où les phénomènes surnaturels sont légions. Adeline Fleury, l'autrice, nous emmène dans une Normandie pleine de croyances, de goubelins, d'enfants-fées et de pluie de crapauds.
"Cette terre normande est parcourue d'ondes étranges, d'énergies contradictoires qui fragilisent les nouveaux arrivants, les secouent, font vaciller leur rationalité. Depuis leur arrivée au village, les deux anciennes citadines ont du mal à comprendre comment des gens aussi ancrés dans la terre peuvent être aussi attachés à tous ces contes et légendes fantasmagoriques. Cela doit avoir quelque chose à faire avec la mort. Les superstitions entourant les fantômes sont bien plus commodes à se représenter que la réalité de la finitude et de sa pourriture." (page 139-140)
Pour enrober le tout, l'écrivaine met en place une histoire d'enfant caché et de vengeance, une intrigue assez convenue, mais qui a l'intérêt de faciliter la lecture. Et puis, on n'est pas chez Agatha Christie donc l'enquête n'est pas le sujet.
Ce qui compte, c'est l'indéniable talent d'Adeline Fleury pour décrire des paysages et des ambiances. Elle nous embarque avec finesse dans un Contentin de légende qui ne vous laissera pas indifférent.e.
Paru le 02 janvier 2024
Éditions de l'Observatoire
202 pages | 20€
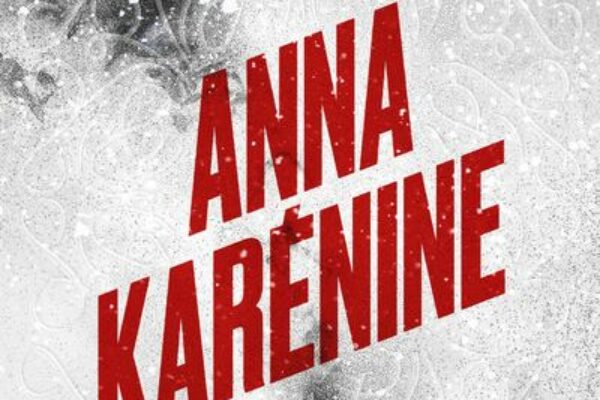
Anna Karénine, Léon Tolstoï, 10/18
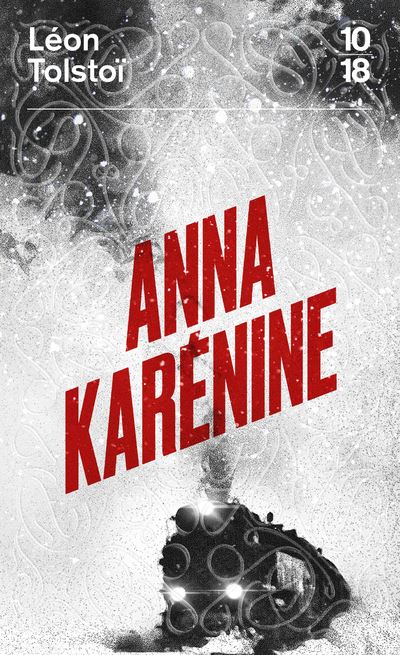
Quand j'étais petit, ma Maman m'a totalement divulgaché la fin de Anna Karénine. Je me suis donc longtemps dispensé de la lecture d'un livre de près de mille pages dont je connaissais déjà la fin ! (Combien vous dois-je pour la séance, Docteur.e ?!).
La réédition récente de chef d’œuvre de la littérature russe du XIXème siècle par la maison 10/18 m'a convaincu de me lancer dans la lecture de cette longue histoire d'amour contrariée. Je pensais qu'une nouvelle traduction justifiait la ressortie du livre, mais en fait non, il s'agit d'une traduction, anonyme, parue en 1886.
Heureusement, la traduction n'a pas du tout vieilli et j'ai été surpris de constater combien ce livre se lisait facilement. De façon habile et agréable, le traducteur (ou était-ce une traductrice?) conserve certains mots en langue originale et les traduit en bas de page. J'aime ce procédé qui permet de se projeter plus facilement en Russie. De la même façon, les références ou les mots compliqués (marmoréen, coterie...) sont expliquées afin de vous dispenser de sortir votre dictionnaire. Tout cela rend la lecture très fluide et c'est tant mieux car le livre est long.
Dans certains livres russes, on se perd dans la multitude de personnages et la multiplicité de leurs pseudonymes. Ici au contraire, le nombre de protagonistes est relativement limité et l'on identifie toujours facilement de qui on parle.
Il y a Lévine, l'idéaliste intransigeant, amoureux éconduit. Kitty, la jeune et belle trahie. Wronsky le bellâtre. Anna la mère de famille terriblement séduisante, Oblonsky le charmeur infidèle et Dolly sa femme blessée.
Pendant près de mille pages, tout ce petit monde de la grande bourgeoisie russe se séduit, se dédit, se trahit. Levine et Anna ont du mal à se satisfaire de leur condition de mortels et cherchent l'Absolu, tandis qu'Oblonsky et Wronsky se contenteraient bien d'une vie de plaisirs. Mais la chair est triste, hélas.
Un vrai feuilleton qui en vaut bien d'autres !
Paru le 20 juin 2024 (réédition)
10/18 Littérature étrangère
984 pages | 10,90€

La vie secrète des vieux, Mohamed El Khatib, Abbesses

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des vieux sur scène, surtout des vieilles et des vieux "normaux", des bedonnant.e.s, des ridé.e.s, des pas connu.e.s, des pas lifté.e.s ni botoxé.e.s. Ce spectacle est, de ce point de vue, assez extraordinaire.
Mohamed El Khatib a constitué une troupe de vieillards qui nous racontent leur vie secrète, leur vie intime, leur vie sexuelle.
D'abord, elle est délicieuse, cette bande de vieux qui livrent sans pudeur leur sexualité sur un plateau. C'est jouissif de voir ces vieux aux corps plus ou moins abimés nous dire crument leurs plaisirs, passés, présents et (s'ils ont de la chance !) futurs.
"Je ne veux pas mourir sans jouir encore." "Je ne peux pas m'empêcher de penser, à chaque fois que je fais l'amour, que c'est peut-être la dernière fois. Alors je m'applique."
Et puis, le spectacle prend un tour plus militant, plus revendicatif. Yasmine, aide-médicale présente sur scène, nous décrit son quotidien auprès des résidents d'un EPAHD. Son témoignage est enjoué mais aussi immensément triste et extrêmement poignant.
Alors, alors les larmes me sont montées aux yeux. Pour de vrai. J'ai été ému, bouleversé par ces fins de vie et par ces adultes infantilisés (il est vrai qu'ils n'ont pas toujours toute leur tête) à qui l'on refuse les (derniers) plaisirs des sens.
"On a torché nos gosses toute leur enfance (...) et maintenant ils viennent nous faire chier !".
Et puis, lorsque j'ai pris conscience que Yasmine n'était pas aide-soignante mais comédienne (Yasmine Hadj Ali), je me suis senti floué et, oserais-je le dire? trahi. Bien sûr, c'est du théâtre et je sais que tout est faux. Sauf que le metteur en scène laisse entendre que ce sont des "vrais" gens qui racontent leur histoire (il parle de "théâtre documentaire"). Or si Yasmine est une comédienne, alors...
Alors, on peut douter de tout. A y bien regarder, il m'a semblé que El Khatib servait la soupe à son public. Avec ses faux airs provocateurs et naïfs, son spectacle flatte en réalité son public dans le sens du poil. A des spectateurs majoritairement blancs et bourgeois, il présente des vieux - majoritairement blancs et bourgeois eux-aussi - qui, s'ils ne sont plus de première jeunesse, ont une pêche d'enfer et un appétit sexuel rassurants.
"J'ai 91 ans et, je n'ai pas peur de le dire - j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle - j'ai envie de faire l'amour tous les jours."
Alors, je me suis dit que Mohamed El Khatib est un roublard. C'est un spectacle plaisant à regarder et très très efficace. Presque trop.
Jusqu'au 26 septembre 2024
au Théâtre de la Ville de Paris - Abbesses(dans le cadre du Festival d'automne 2024)
Puis en tournée.
Durée 1h10
de 8 € à 33 €

Et c’est ainsi que nous vivrons, Douglas Kennedy, Pocket

En 2045, les USA n'existent plus. Ils ont été remplacés par d'un côté une République réunissant les états côtiers (est et ouest) et de l'autre une Confédération des états continentaux (les "Fly over", titre original du roman). Le scénario de cette Amérique divisée entre progressistes et conservateurs religieux semble très séduisant.
Malheureusement, au lieu de traiter du sujet, Douglas Kennedy se focalise sur son personnage de Samantha Stengel, agente secrète pour la République envoyée en mission pour tuer sa sœur, agente à la solde de la Confédération. Deux sœurs ennemies pour symboliser un pays où la fraternité régresse, c'est assez lourdingue comme procédé.
Ce n'est pas un roman d'anticipation, c'est un vulgaire thriller dont l'intrigue est assez médiocre et totalement prévisible. D'ailleurs, l'auteur en est tellement conscient qu'il le formalise: "Apprendre que c'était toi derrière le masque - toi, ma demi-sœur en mission pour me tuer... c'est à la fois incroyablement cliché et vraiment tordu." (page 420).
Kennedy n'a pas travaillé son sujet. Il fait l'impasse sur les technologies du futur, se contentant d'imaginer qu'on implantera une puce électronique aux individus et que les espions disposeront de masques leurs permettant de changer d'identité sans être reconnus (c'est tellement innovant qu'on voyait déjà ça dans les romans d'Alexandre Dumas ou dans Fantomas !). J'ai vraiment regretté que le livre n'ait pas été plutôt écrit par Marc Dugain qui aurait donné toute son ampleur à cette dystopie.
Avec Kennedy, il n'y a pas que les technologies qui sont dépassées (c'est vraiment l'an 2000 des années 80 !), les références aussi sont datées. A en croire l'auteur, en 2045, on ne s'intéressera qu'à des vieilleries en noir et blanc des années 1950. Mais oui bien sûr...
Pour faire bonne figure, Douglas Kennedy patine tout ça d'un vernis philosophique peu convaincant.
"A l'image des cellules biologiques qui nous composent, il est dans notre nature de nous diviser. L'histoire de l'humanité, individuelle et collective, n'est qu'une longue succession de schismes et de ruptures. Nous brisons nos familles, nos couples. Nous brisons nos nations. Et nous rejetons la faute les uns sur les autres. C'est un besoin inhérent à la condition humaine: celui de trouver un ennemi proche de nous afin de l'exclure en prétextant ne pas avoir le choix.
Vivre, c'est diviser" (page 448).
Amen !
Paru en poche le 06 juin 2024
chez Pocket
Traduction (anglais USA) Chloé Royer
456 pages

Ce qui nous tue, Tom McAllister, 10/18

Pour mon plus grand plaisir, le hasard a mis sur mon chemin Ce qui nous tue de Tom McAllister. Je n'avais jamais entendu parlé ni de cet auteur, ni de ce livre au titre bizarrement traduit puisqu'il s'intitule en anglais How to be safe (qu'on pourrait traduire par Comment s'en sortir). Un livre de 2021 qui reste terriblement d'actualité et qui aurait mérité un grand succès.
Toute la ville de Seldom Falls, petite bourgade de Pennsylvanie autoproclamée "LA VILLE LA PLUS AIMABLE D'AMERIQUE" (page 25) est sous le choc après qu'une tuerie de masse a lieu au lycée. Professeure récemment renvoyée du lycée car trop peu conventionnelle, Anna Crawford, voit les forces spéciales débarquer chez elle et la ranger au titre des suspects potentiels.
Avec son humour noir, la narratrice un brin parano dénonce le cynisme des politiques qui déclarent la guerre aux armes (sic) et utilisent la tragédie à leur avantage.
"Les politiciens adoraient les petites villes. Ils croyaient qu'on passait notre temps à manger de la tarte aux pommes et à agiter de petits drapeaux à l'église. Ils n'aimaient pas penser au fait que tout le monde prenait des opiacés, avait un boulot ingrat et vivait constamment dans la peur. Leur amour pour une vision idéalisée de l'Amérique profonde était pervers. Tandis qu'on mourait, ils s'enrichissaient sur notre dos en nous félicitant pour notre résilience. Ils s'arrêtaient pour boire une bière avec un gars du coin. Ils promettaient que, la prochaine fois qu'ils viendraient, ils apporteraient la prospérité." (page 129)
Bien que rapidement innocentée, Anna est toujours harcelée par des chaines d'info qui surfent sur le sensationnalisme. "L'appétit des médias (...) était insatiable. Ils avaient besoin d'images de mort pour rester en vie". (page 196).
Au gré de ce roman assez court et terriblement percutant, Tom McAllister évoque la difficulté qu'il doit y avoir à vivre dans l'Amérique profonde lorsqu'on n'est pas un homme blanc viril, pro-life et pro-armes.
J'ai beaucoup ri en lisant ce livre tant le regard de la narratrice est féroce, drôle et acerbe. Le virilisme - et la violence qu'il véhicule - en prend pour son grade. Savoureux !
Paru en poche le 18 février 2021
chez 10/18 Littérature étrangère
traduction Anne Le Bot
237 pages | 8€

Enfermés, Amaia et Sophie Teulière, Funambule

Moi j'aurais voulu voir Le nectar des Dieux, l'histoire du vin en une heure au théâtre Funambule, mais je me suis retrouvé spectateur d'Enfermés, une pièce qui a pour thème les Escape games. C'est donc peu dire que je me suis identifié à Alex, ce personnage qui voulait juste aller récupérer un recommandé à la Poste et qui se retrouve contre son gré dans un escape game avec ses deux copines, Léa et Jo.
Nos trois protagonistes sont enfermés dans un escape game où ils sont censé trouvé le sceptre du Pharaon Pasmoualtournevis mais où ils vont finalement lutter pour leur survie. Bon déjà, j'ai horreur des escape game, des labyrinthes et autres palais des glaces ; rien que l'idée me fait frémir. Et je n'ai aucune admiration pour l’Égypte antique. Des mecs qui ne savaient pas dessiner et qui adoraient les chats, tu parles d'une civilisation...
Malheureusement, cette pièce qui n'était pas faite pour moi n'a pas réussi à me convaincre. J'ai souffert pendant un peu plus d'une heure, avec une furieuse envie de m'échapper, moi aussi.
Les autres spectateurs ont eu l'air d'apprécier et de s'amuser, particulièrement ceux qui ont (su garder) une âme d'enfant et qui ne sont pas de vieux râleurs comme moi. Il faut dire que les gags fusent à un rythme effréné et que les comédiens donnent tout ce qu'ils ont: ils jouent, chantent, dansent, se roulent par terre pour emporter le public et le faire participer activement à cette grande aventure en chambre close.
Jusqu'au 1er septembre 2024
Funambule Montmartre
La Compagnie des brunes
de Amaia et Sophie Teulière
avec Antoine Ody ou Antoine Demière, Laura Hatchadourian ou Charlotte Bottemanne, Sophie Teulière ou Laurine Mével
mise en scène Amaia
création lumières Robin Belisson
durée 1h15
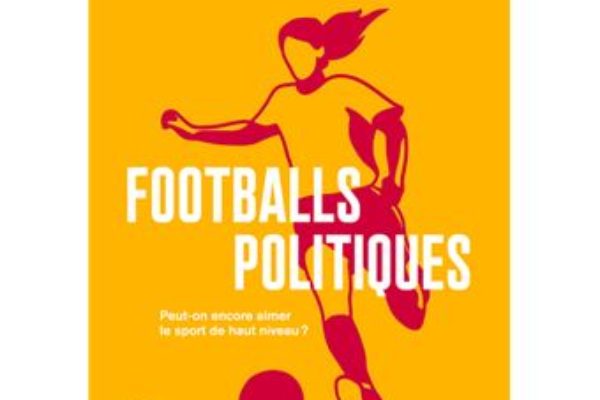
Football politiques, Pauline Londeix, 10/18
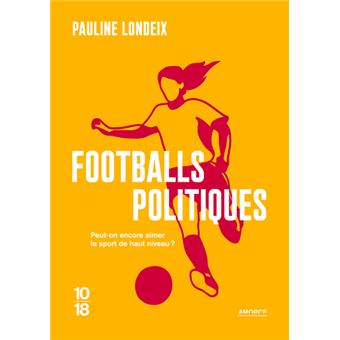
Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ?
Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ? Peut-on encore aimer le sport business ? Cette question pertinente est posée par Pauline Londeix dans ce fort intéressant petit ouvrage de sociologie.
Comme toujours avec la collection Amorce de 10/18, le livre est d’une clarté lumineuse. Chaque idée est bien expliquée, le plan est méticuleusement annoncé et d’utiles mises en exergue des points importants sont proposées.
Dans une première partie, Pauline Londeix commence par dresser la longue liste des défauts du football, le plus emblématique des sports business mais aussi celui qui connait le plus grand nombre de dérives. Sexisme, inégalités, argent roi, violence, tricheries… le sport roi concentre tous les défauts d’une société aussi machiste que capitaliste dont il est un véritable miroir grossissant.
"Les maux qui touchent le sport de haut niveau semblent refléter ceux dont notre société dans son ensemble est atteinte. Ainsi, savoir si on peut encore aimer le sport de haut niveau revient, d'une certaine façon, à se demander si on peut encore aimer le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, son élitisme, ses injustices, sa cruauté." (page 16)
Malgré tous ses défauts, il faudrait néanmoins sauver le soldat football au motif qu'il serait un formidable vecteur de communication entre les hommes. (C'est à dessein que je ne mets pas majuscule à hommes, tant la meilleure moitié de l'humanité semble peu concernée par ce jeu qui passionne littéralement des mecs, les vrais, les virils !).
Dans une seconde partie, l’autrice cherche donc une solution pour racheter le plus populaire des sports (popularité qui n’est pas faite pour me rassurer, soit dit en passant!). Pauline Londeix se prend ainsi à rêver que le foot féminin (moins athlétique mais plus technique, avec du vrai "beau jeu" et du collectif dedans) puisse un jour avoir une bonne influence sur le football masculin. Autrement dit que la footballeuse soit l'avenir du footballeur.
L'espoir fait vivre...
Paru le 06 juin 2024
chez 10/18 Amorce
144 page | 6€

Tous les membres de ma famille ont tué quelqu’un, Benjamin Stevenson, 10/18

D'une façon générale, je ne suis pas fan de romans policiers et encore moins de livres à énigmes (ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire et que je n'ai pas lu Agatha Christie...). Et je n'aime pas non plus cette manie anglo-saxonne des titres à rallonge. Oui, je sais, je n'aime pas grand chose.
Le roman de Benjamin Stevenson, intitulé Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un, une parodie de livre de détective à la Sherlock Holmes partait donc, de mon point de vue, avec un handicap certain.
Mais que voulez vous, je suis le genre de gars qui, au restaurant, est capable de choisir le menu surprise. En matière de livres c'est pareil, je suis ouvert aux découvertes. C'est comme ça que je me suis retrouvé à lire des bouquins de Patrick Sébastien ou de Christine Angot (qui ont en commun le même talent littéraire doublé d'une grande prétention, mais c'est une autre histoire).
Bref. Je me suis laissé tenter par ce livre car ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de lire un auteur australien.
L'écrivain joue avec son lecteur et annonce dès le départ la liste des pages où auront lieu les meurtres.
"Si vous ne lisez ce livre que pour les détails sanglants, les décès surviennent ou sont rapportés page 29, page 69, page 93, il y a un doublé pages 103-104 et un triplé page 113. S'ensuit une petite accalmie, mais ils reprennent page 230, page 274 (grosso modo), pages 286-288, page 298, page 325, quelque part entre la page 317 et la page 326 (c'est difficile à dire avec précision), page 340 et page 457. Je jure que c'est la vérité, à moins que le compositeur se plante dans la numérotation." (page 14)
Tant qu'à faire, il aurait pu aussi me prévenir qu'en page 144 on trouvait un chapitre récapitulatif du début du bouquin, ça m'aurait permis de gagner un peu de temps.
Tout au long du livre, Benjamin Stevenson joue avec les codes du roman de genre et respecte scrupuleusement le cahier des charges du bon auteur de livre à suspens. Malheureusement, lorsqu'arrive l'heure du dénouement (la scène se déroulant, comme il se doit, dans un bibliothèque où sont réunis tous les protagonistes ; du moins ceux qui ont survécu), je me fiche bien de savoir qui a tué le Colonel Moutarde avec une clef anglaise dans l'entrée.
En plus de soigner la construction de son énigme, l'auteur multiplie les clins d'yeux au lecteur. "Si vous suivez correctement les numéros de page, vous savez que quelqu'un vient de mourir." (page 69)
Le livre est supposé être drôle, moi je l'ai trouvé assez puéril et lourdingue ; et comme je suis sensible, j'ai eu du mal à rire d'une histoire qui multiplie les morts violentes, y compris les morts d'enfants.
Être curieux me réserve souvent de bonnes surprises. Mais parfois non. Tant pis.
Paru en poche le 06 juin 2024
10/18 Polar
480 pages | 9,60€
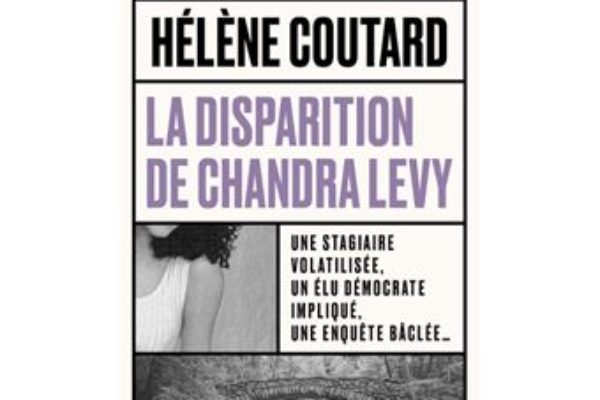
La disparition de Chandra Levy, Hélène Coutard, 10/18 Society
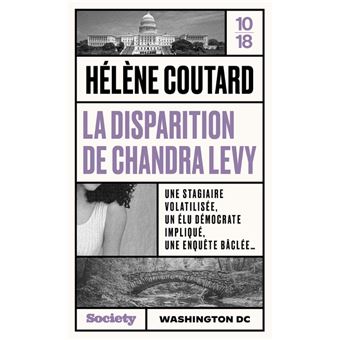
Le 1er mai 2001 Chandra Lévy disparait à Washington D.C. A l'été 2001, après l'affaire Clinton/Lewinsky et en attendant les attentats du 11 septembre, les journaux américains n'ont rien de mieux à se mettre sous la dent que cette histoire de disparition inquiétante d'une jeune femme, stagiaire dans la capitale, et qui avait une aventure secrète avec un député quinquagénaire et marié.
"Voilà donc atteint le point Godwin de toute enquête criminelle incluant une liaison illicite: et si Chandra était morte dans un jeu sexuel qui aurait mal tourné ?" (page 79)
La découverte du corps de Chandra dans une forêt, un an après sa disparition, n'apportera pas de réponse à cette question. Il faut dire que - contrairement à Hélène Coutard, l'autrice - la police de Washington DC a totalement bâclé son enquête.
Comme c'est toujours le cas avec la collection True Crime de 10/18 Society, le travail journalistique est fouillé et le livre élargit le propos en évoquant les répercussions du crime sur la société américaine, ou ce qu'il dit d'elle.
"Chandra, malgré sa liaison exceptionnelle avec un député, est devenue au moment de sa disparition la girl next door de l'Amérique, l'amie de la fac, la voisine, la jeune collègue... On l'a décrite - surtout avant la révélation de la liaison - comme une jeune femme drôle, passionnée, révoltée contre l'injustice et promise à un brillant avenir. On a dit d'elle qu'elle était sérieuse, prudente, bien élevée. On a parlé de ses études, de sa future carrière. Des caractéristiques correspondant aux descriptions généralement associées aux femmes blanches disparues, vues comme les sœurs, les filles, les mères de quelqu'un. A contrario, quand une femme racisée disparait aux États-Unis, l'accent est surtout mis sur les dysfonctionnements de sa vie ayant pu entrainer un drame et rarement sur ses réussites." (page 195)
"En 2001, l'année où Chandra Levy a disparu, deux cent trente et un meurtres et cent quatre-vingt-un viols ont été commis à DC. Aucun autre fait divers n'a été commenté." (page 196)
L'autrice raconte bien l'histoire, elle ménage le suspense et met en scène des rebondissements qui nous tiennent en haleine. Le bouquin se lit donc très vite, si ce n'est d'une traite.
Malheureusement (!!! attention spoiler alert !!!), comme on n'a jamais retrouvé l'assassin de Chandra Levy (si tant est qu'elle ait été tuée...), il m'a un peu manqué un bon gros tueur psychopathe qui aurait apporté plus de saveur au récit.
Parution le 06 juin 2024
10/18 Collection Society
224 pages | 8€

Lorsque l’enfant parait, André Roussin, Michel Fau, Montansier Versailles

Charles Jacquet (Michel Fau), la petite soixantaine bedonnante, est fier de lui : Sous-Secrétaire d’État à la Famille, il vient de faire adopter la fermeture des maisons closes et d'alourdir les peines frappant l'avortement.
Problème : une avalanche de bébés va lui tomber dessus en rentrant chez lui, après sa journée de travail. Son fils attend un enfant hors mariage et sa femme, Olympe (Catherine Frot), est enceinte. Il se passerait bien de ces grossesses qui viennent compliquer sa vie et télescoper la morale qu'il revendique.
"Je t'ai fait un enfant ? A ton âge, ça n'est pas sérieux !"
En parlant d'âge, et sans vouloir être désobligeant, il y a quand-même un côté surréaliste à confier le rôle d'un personnage censé avoir la quarantaine à une comédienne qui, à la ville, a près de 70 ans. Malheureusement, Michel Fau (qui signe la mise en scène) n'utilise pas ce décalage pour en faire quelque chose de comique ; il fait comme si de rien n'était et signe, d'une manière générale, une mise en scène classique au possible, aussi plate et prévisible que le texte de la pièce.
Mais qu'est-ce qui a pris à Michel Fau de monter cette comédie qui aurait pu s'appeler Retour vers le futur tant on se croirait revenu dans les années 1950 ?! Le texte écrit en 1951 par André Roussin (qui deviendra Académicien en 1973) est terriblement bourgeois et daté, ce qui plait manifestement à un certain public qui y trouve toujours son compte, même au XXIème siècle.
En ce 29 mai 2024 au Théâtre Montansier de Versailles, les spectateurs grisonnants et bourgeois sont venus voir des célébrités. C'est un bon public, c'est-à-dire un public indulgent et conquis d'avance (Michel Fau est d'ailleurs applaudi avant même d'avoir prononcé un mot). Il faut dire que ce soir, le Bourgeois et sa bourgeoise ne seront pas choqués, on les brocardera très gentiment avec un humour de bon ton légèrement suranné. Cela donne ce genre de répliques:
- (à propos d'une femme enceinte) "J'espère qu'elle ne couve rien."
- (au téléphone avec la grand-mère qui entend mal) "Son voyage tombe à l'eau. Non, je dis: son voyage tombe à l'eau. Allo ?"
- à chaque évocation d'un couple qui attend un enfant : "Mais comment ont-ils fait?!" (C'est le running gag de la pièce...)
Les gags sont pathétiques, les quiproquos et le dénouement se voient arriver à des kilomètres et la pièce n'a aucun rythme. Cela fait bientôt deux ans qu'ils tournent et, manifestement, ils sont tous fatigués de jouer cette histoire qu'ils récitent presque mécaniquement. La mollesse des comédiens est renforcée par un décor en entonnoir qui réduit l'espace scénique à quelques mètres carrés et leur interdit presque de bouger. Michel Fau n'a même plus la force de cabotiner, et seule Catherine Frot a parfois quelques sursauts d'énergie. Et je ne vous parle même pas des seconds rôles...
Pour tout dire, je n'ai pas ri une seule fois en deux heures et j'ai eu l'impression de passer la soirée avec Édouard Balladur. Mais ce qui m'a troublé, c'est que dans la salle, tout le monde semblait s'amuser, à l'exception notable de ma sœur et de moi qui avons ce soir-là tenu le rôle des deux vieux du Muppet Show. Les seuls qui avaient l'air de s'emmerder autant que nous deux, c'étaient les comédiens !

Jusqu'au 1er juin 2024
Théâtre Montansier Versailles
de 15€ à 39€
De André Roussin, mise en scène Michel Fau assisté de Quentin Amiot
Décor Citronelle Dufay, costumes David Belugou, lumières Antoine Le Cointe
avec Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer ou Laure-Lucile Simon, Quentin Dolmaire ou Baptiste Gonthier, Hélène Babu ou Anne-Guersande Ledoux, Sanda Codreanu, Maxime Lombard
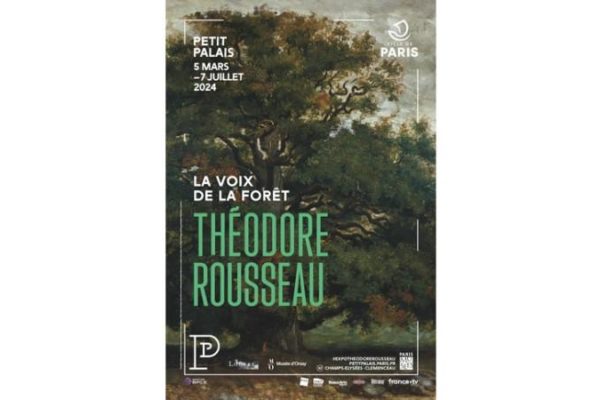
Théodore Rousseau, La Voix de la forêt, Petit Palais
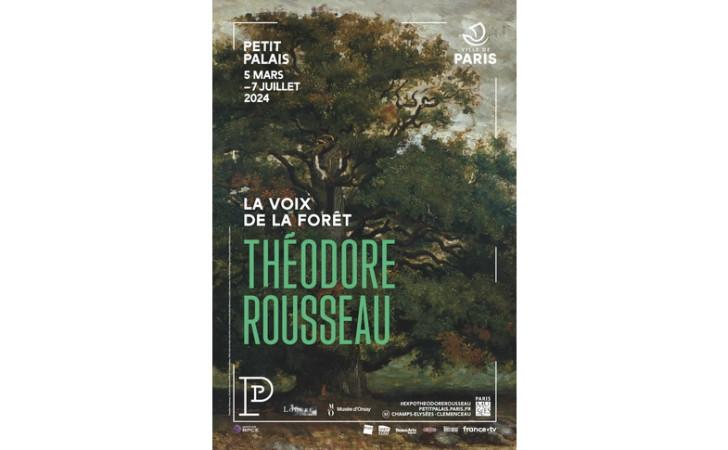
C'est pour moi toujours un plaisir d'aller au Petit Palais, véritable havre de paix au milieu du tumulte des Champs Élysées. Les collections permanentes sont belles (et gratuites !) et les expositions temporaires sont intéressantes et relativement délaissées par la foule. Cette fois-ci, je m'y suis rendu pour visiter l'exposition Théodore Rousseau, La Voix de la forêt.
Théodore Rousseau (1812 - 1867) était un peintre singulier. Un peintre dont l'ambition était de peindre la nature, la nature pour elle-même et non comme un simple décor à des scènes mythologiques. Son ambition était telle qu'il a renoncé pour elle à une certaine carrière, lui qui fut refusé au Salon de Paris et qui choisit de peindre à Barbizon des paysages français (et non italiens comme l'académisme l'aurait voulu).
Théodore Rousseau peint la nature comme il la voit, et non comme il serait de bon ton de la peindre. Pour mieux faire le "portrait" d'un arbre, il n'hésite pas à placer sa toile à la verticale. De la même façon, il mixte les techniques pour mieux restituer la matière qu'il voit. Comme il lui arrive également de présenter des ébauches, on lui reproche, à l'époque, de ne pas "finir" ses toiles.
D'ailleurs, en parlant d'ébauches et de toiles non académiques, il me semble que Théodore Rousseau ouvre la voie aux Impressionnistes (qui viendront juste après lui), même si son œuvre est moins accessible, moins plaisante à nos yeux que les leurs. Car il y a une certaine exigence - voire une intransigeance, une rigueur - dans l’œuvre de ce peintre. Ses paysages de forêt ne sont pas (com)plaisants. Ils sont touffus, extraordinairement détaillés et presque oppressants par moments, notamment lorsqu'ils représentent un magma de feuilles et de mousse et que le ciel est absent de la composition. J'ai été impressionné par le niveau de détail de ces "portraits" en gros plan d'arbres ou de sous-bois ; chaque feuille, chaque mousse, chaque brindille ou brin de fougère est restitué dans sa complexité. L'aspect technique force alors mon respect, mais sans vraiment m'émouvoir.
Je préfère lorsque Théodore Rousseau prend du recul, lorsqu'il fait entrer la lumière du ciel dans la composition, même si ses toiles sont alors moins singulières. Ses ciels gris sont magnifiques, comme dans Le lac de Maubuisson, une ravissante petite huile d'une modernité folle, tout en dégradés de gris. On sent l'influence des peintres paysagistes néerlandais du XVIIème, et l'on fait le parallèle avec Le Chêne de Flagey peint par Gustave Courbet en 1864.
J'ai aussi aimé ses tableaux représentant des grandes pâtures boisées avec des mares, ces paysages qui n'existent plus, remplacés par ces champs modernes aux labours profonds laissé à perte de vue par une agriculture mécanisée qui prétend entretenir le paysage alors qu'elle le démolit consciencieusement.
Nul doute que nos campagnes actuelles, trop souvent défigurées, attristeraient Théodore Rousseau qui fut écologiste avant l'heure, lui qui fit du lobbying afin que certains arbres soient sanctuarisés (les "séries artistiques") pour leur beauté et pour la source d'inspiration qu'ils représentent pour les artistes.
C'est sûr, je penserai avec respect à Théodore Rousseau lors de mes balades en forêt, à condition bien sûr que nos amis chasseurs me laissent passer !
Jusqu'au 07 juillet 2024
au Petit Palais
Plein tarif : 12 € TP | 10€ TR | Gratuit - 18 ans

Le tableau volé, Pascal Bonitzer, SBS Production

Le réalisateur, Pascal Bonitzer, s'est inspiré d'une histoire vraie : un commissaire-priseur d'une grande maison parisienne est informé qu'un chef-d’œuvre disparu d'Egon Schiele trône dans le salon d'un jeune ouvrier dans la banlieue de Mulhouse. D'abord incrédule, le spécialiste se rend en Alsace et convainc le propriétaire du tableau de le vendre aux enchères. Mais il y a un hic : ce tableau provient d'une spoliation lors de la deuxième Guerre Mondiale, ce qui pose un problème étique à son propriétaire, et un problème beaucoup plus prosaïque au commissaire priseur qui ne voudrait surtout pas laisser passer une affaire pareille !
Plutôt que d'axer son film sur cette histoire assez rocambolesque, Pascal Bonitzer préfère se focaliser sur André Masson (Alex Lutz), un professionnel de l'art qui - s'il est ému devant une œuvre qu'on pensait disparue (j'ai particulièrement aimé la scène où les deux commissaires-priseurs découvrent la toile) - semble être davantage intéressé par les belles bagnoles et les montres de luxe que par les tableaux.
On a envie d'aimer le personnage (pourtant tête à claque !) campé par Alex Lutz, et l'on est séduit par les femmes qui gravitent autour de lui, qu'elles soient une notaire de province (Nora Hamzawi), son ex-femme (la toujours émouvante Léa Drucker) ou sa stagiaire mythomane sur les bords (Louise Chevillotte, une découverte).
Autour du commissaire-priseur, Pascal Bonitzer dresse toute une galerie de personnages. Tou.te.s ont un rôle à jouer, même les simples figurants apportent quelque chose au film et à la compréhension du personnage principal. Absolument tous les comédiens sont bons, même les seconds ou les troisièmes rôles.
La narration est construite sobrement, la mise en scène est classique et suffisamment discrète pour être plaisante, les images sont belles, la réalisation honnête et, surtout, la direction d'acteurs est impeccable. Alors, si ce film sur un chef d’œuvre n'en est pas un, ce long-métrage est un ouvrage de belle facture réalisée par un bon artisan du cinéma. Et c'est déjà beaucoup !
Au cinéma le 1er mai 2024
1h31

Dans ton coeur, Akoreacro, Pierre Guillois, Rond-Point

Pierre Guillois, le metteur en scène de Les gros patinent bien (qu'on avait adoré à État-Critique) s'associe avec la troupe Akroreacro pour faire rentrer le cirque au théâtre.
Dans une usine qui évoque Playtime ou les Temps modernes, un homme et une femme se rencontrent et l'on assiste à la naissance d'un couple, à son installation dans un appartement, à l'arrivée de leurs enfants et à ses déboires. L'histoire n'est pas compliquée, elle est facilement accessible et compréhensible, même par de jeunes spectateurs.
Tous ces épisodes assez banals de la vie de couple sont magnifiés par l'extraordinaire troupe Akroreacro. La charge mentale de la jeune mère de famille est abordée avec une belle poésie : elle ne touche littéralement plus terre. Et lorsque l'homme fait des galipettes avec sa maîtresse, elles sont particulièrement acrobatiques ! Mais sa femme fait face avec détermination. C'est une battante, comme nous le prouverons les chorégraphies de bastons.
On admire le travail des circassiens, véritables athlètes de la piste, on apprécie la beauté des corps sculptés (dont les performers s'amusent à l'occasion d'un numéro de cabaret drôlissime) et l'on est épaté par le travail collectif. Quelle confiance ils doivent dans leurs partenaires pour réaliser ces voltiges !
A certains moments, j'étais émerveillé, bouche et yeux grands ouverts, complètement scotché par la vision de ces corps qui défient l'apesanteur. C'est exactement pour cela que j'aime le spectacle vivant et les performances physiques (et tout particulièrement la danse). Mes filles de 5 et 10 ans étaient elles-aussi captivées par le spectacle.
Contrairement à ce que l'on aurait pu craindre, le cirque ne rétrécit pas en quittant le chapiteau. Au contraire, ce qu'il perd en espace scénique, il le compense grâce à la narration et la mise en scène qui mettent en valeur les numéros. En parallèle, c'est le théâtre qui prend une autre dimension, notamment grâce à la présence des musiciens qui nous enchantent.
J'ai aimé que la représentation dépasse le simple enchainement de numéros, que le cirque mette un pied dans la théâtralité, avec un un vrai fil conducteur narratif. Dans ton cœur nous fait rire, retenir notre souffle et nous attendrir pour ce couple qui se débat dans le quotidien.
Les acrobates et musiciens d'Akroreacro apportent au théâtre un vent de joie sincère qui souffle jusqu'après la représentation !
Jusqu'au 26 mai 2024
Théâtre du Rond-Point
Durée 1h15 - à partir de 6 ans
de 8€ à 38€

Kevin, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Rond-Point

A l'entrée, on nous remet un carton format A4 avec une grosse flèche dessinée dessus. Lorsqu'on est tous assis démarre un petit sondage auquel on répond en direct grâce à sa flèche. Ce petit jeu nous amuse visiblement tous, et nous ne pouvons nous empêcher de rire devant l'incongruité des questions (dont on comprendra plus tard à quoi elles font référence).
Puis arrivent sur scène Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, deux profs dont vous avez peut-être déjà vu une vidéo sur internet expliquant que, si vous faites des fautes quand vous écrivez, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'orthographe.
Dans le spectacle Kevin, il n'est pas question de langue mais d'éducation, carrément. "On s'est demandé à quoi ça sert l'école. Et à qui ça sert ?"
Pendant une heure et quart, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron nous bombardent de faits, de chiffres, d’anecdotes sur les systèmes éducatifs français et belge qui ont la particularité d'être aux deux dernières places du classement de l'OCDE en ce qui concerne l'égalité des chances à l'école. Les deux conférenciers nous démontrent comment et pourquoi, en France et en Belgique, la richesse des parents est le facteur prédominant dans la réussite scolaire des enfants.
Au gré du spectacle, on apprend ainsi qu'il y a un lien entre prénom et mention au baccalauréat, qu'il existe des pays sans bonnes écoles, qu'il existe un programme invisible, ou encore que certains élèves souffrent de résignation acquise. Le fond du propos est parfois légèrement désespérant ; "la sociologie, ça pique. Et la sociologie de l'éducation, ça pique fort."
Mais rassurez-vous ! Ce spectacle n'est pas que documenté, il est surtout très drôle.
Grâce au talent de conteurs des deux compères et grâce à des infographies rigolotes et efficaces qui défilent derrière eux, les nombreuses données et informations sont toujours présentées de façon dynamique et ludique. C'est loin d'être un cours ennuyeux ! A la fin du spectacle, mon voisin de derrière s'est exclamé : "C'était génial ! En fait, c'est comme un documentaire, mais en live."
Surtout, le côté interactif du spectacle instaure une très bonne ambiance dans la salle ; c'est tous ensemble qu'on participe, qu'on joue, qu'on rit ou qu'on est atterré. C'est un très beau moment collectif d'apprentissage.
Jusqu'au 11 mai 2024
Théâtre du Rond-Point
Durée 1h15

La France sous leurs yeux, BNF

Une exposition belle et passionnante qui présente les français dans tous leurs états !
L’État a débloqué quelques millions d'euros pour tenter de sauver la profession de photojournaliste, mise à mal par la crise de la presse papier, l'omniprésence des appareils photo dans toutes les poches ou encore la crise COVID,
Pilotée par la Bibliothèque, la Grande commande pour le photojournalisme – intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire – a permis aux photographes lauréats de bénéficier d’un financement de 22 000 € chacun pour mener à bien leur reportage. Les 20 000 tirages inédits produits ont ensuite intégré les collections de la BNF.
Organisée en quatre chapitres (Libertés Égalités Fraternités et Potentialités), l'exposition offre à nos regards La France dans toute sa diversité : des français de tous (trans)genres, de toutes les couleurs, de toutes les latitudes et dans toutes les positions (sociales ou acrobatiques).
Il y a autant de styles et de sujets qu'il y a de photographes, c'est dire combien l'exposition est dense (sans être indigeste ni intimidante). Elle est vraiment passionnante et il serait dommage de passer à côté de cette exposition (qui partira ensuite en tournée en régions, par fragments). Pour ma part, j'ai même envie d'y retourner. Et comme le tarif est plus que raisonnable (10€ maximum), je ne m'en priverai pas !
Jusqu'au 24 juin 2024
Bibliothèque Nationale de France - François Mitterrand
10€ TP

Les Explorateurs : l’aventure fantastique

Là où tout le monde voit un énorme nuage menaçant, Alfonso, lui, voit un monstre-tempête. Et comme il est intrépide, il est sûr de pouvoir vaincre le monstre. Il tente donc de convaincre ses voisins de ne pas fuir leur village et part au combat.
Alfonso, en digne arrière-arrière-arrière-petit-fils de Don Quichotte, voit des géants là où il y a des moulins à vent. Son copain Arthur, lui, est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Sancho Pancha. Ces deux-là sont donc inséparables. Et, sans doute dans l'idée de séduire les petites filles, on adjoint Victoria, une fille un peu pirate, à ce duo masculin et l'on ajoute également une pincée d'histoire d'amour au récit. Les trois amis vont découvrir qu'un grand méchant cupide se cache derrière le gros nuage, et ils vont le combattre avec leurs petits bras, leur courage et les gadgets géniaux d'Arthur.
Sans surprise, tout cela va se terminer par une bataille bruyante et épique contre un effrayant robot géant. Un scénario paresseux pour un final de jeu vidéo d'arcade, donc.
Autre point commun avec les vieux jeux vidéo : les animations graphiques toutes pourries ! Les personnages en arrière-plan ont des expressions et des mouvements figés.
Le rythme est beaucoup trop rapide pour être supportable, et ce n'est pas le recours abusif aux ralentis qui rend la chose regardable. Toutes les cinq minutes, le réalisateur passe en slow motion, espérant sans doute de la sorte rendre compréhensible ce qui se passe à l'écran. C'est raté.
Manifestement, le scénariste/réalisateur aime aussi les blagues. Les vannes fusent toutes les dix secondes. Mais les enfants ne rient pas, pas plus qu'ils ne comprennent les références à la pop culture (E.T., Saturday Night fever, Bruce Lee...)
Si vous pensiez emmener vos enfants au cinéma pendant les vacances, vous pouvez chercher une autre idée de film !
Au cinéma le 03 avril 2024
1h 27min

Le Consentement, Vanessa Springora, Sébastien Davis, Rond-Point

Dans les années 1980, V. est une jeune fille de 14 ans qui succombe au charme sulfureux d'un adulte. Flattée d'être remarquée par un écrivain quinquagénaire qui fréquente l'élite parisienne, elle tombe résolument amoureuse de lui.
On peut trouver mille explications au fait qu'une fille pas encore sortie de l'enfance soit attirée par un vieux schnock : son charme sulfureux, l'absence de figure paternelle, la permissivité post-soixante-huitarde d'une mère, une certaine précocité pour la sensualité et la sexualité...
Mais une question demeure : "Lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas viol". N'est-ce pas ?
Au départ, V. croit désespérément à l'amour de G. "Son amour pour moi est d'une sincérité au-dessus de tout soupçon". Puis, progressivement, elle ouvre les yeux, en même temps qu'elle ose enfin ouvrir un livre de G. dans lequel il se vante de ses multiples abus (en forme de conquêtes) d'enfants. "A Manille, les petits garçons de 11 ou 12 ans que je mets dans mon lit sont un piment rare."
Le récit de Vanessa Springora, dont est tirée la pièce, m'avait frappé par sa justesse et sa force. Pas de voyeurisme ni de règlement de comptes en forme de clash, mais un récit aussi glaçant qu'équilibré.
Au démarrage de la pièce de théâtre, je vous avoue avoir eu un peu peur. Déjà, parce qu'il semble impossible de se hisser au niveau du livre de Vanessa Springora, ensuite parce que la mise en scène ne se distingue pas forcément par sa finesse.
J'ai eu l'impression que Sébastien Davis ne faisait pas assez confiance au texte, et qu'il avait jugé nécessaire de lui adjoindre des béquilles scéniques.
Par moments, la voix amplifiée de la comédienne se dédouble (sur fond de percussions lancinantes et hypnotiques). Cela m'a rappelé ma jeunesse et les dramatiques radio de France Culture des années 2000, Mais, franchement, à quoi ça sert ? A part à perturber la compréhension du texte par les spectateurs ? Et je vous passe les micros qui crachouillent très fort par moments.
A certains moments, Ludivine Sagnier se livre à une danse frénétique sur fond de percussions. A d'autres, elle se déshabille... (Derrière un voile opaque en fond de scène, on n'est pas à Avignon !) On se demande ce que cela apporte au propos. Idem pour le tambour chamanique (même si le talent du batteur, Pierre Belleville, impressionne).
La pièce aurait gagné donc à un peu d'épure, à l'image d'une scénographie très simple avec, on l'a dit, un fond opaque en fond de scène et quelques meubles (dont un lit aux draps de satin noir) restituant efficacement le dépouillement des chambres de bonne ou d’hôtel où (sé)vit Gabriel Matzneff.
Soyons juste, la pièce n'est pas gâchée par ses quelques défauts, et elle mérite largement d'être vue. La force du texte est préservée. Ludivine Sagnier joue de façon crédible la petite fille, l'ado puis la femme qu'est devenue V. (même si, dans mon souvenir, la narratrice du livre est un peu moins en colère). La comédienne campe également avec justesse les différents adultes qui passent dans le paysage, médecin, psy, parents qui sont tous plus hallucinants les uns que les autres, la palme revenant à G. lui-même, personnage au cynisme et à la prétention sans borne qui se compare sans modestie à d'illustres artistes dévoreurs de petites filles : Edgar Allan Poe, Lewis Caroll, Roman Polanski...
On est soulagé que V., telle une vaillante petite Gretel, soit parvenue à "prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre"
Jusqu'au 06 avril 2024
Théâtre du Rond-Point
Paris VIIIème
De 8€ à 31€ - Durée 1h20
Texte Vanessa Springora
Mise en scène Sébastien Davis
Avec Ludivine Sagnier
et Pierre Belleville (batterie)

Les soeurs Dalton, Cie Les Nomadesques, Le Ranelagh

"Nous ne serons jamais les sœurs des frères Dalton !"
"Tout est toujours calme dans cette bonne vieille ville calme de Toucalmcity". Et bientôt, la vie y sera encore plus agréable car - grâce à la fortune d'un joueur veinard dont la municipalité vient d'hériter - Toucalmcity va se doter d'une école, d'un orphelinat, d'un hôpital, d'une crèche pour les parents qui travaillent (disent les femmes)... et d'un saloon (insistent les hommes).
Malheureusement, ces beaux projets sont contrariés par Pat le Borgne qui a dérobé le magot. Sans perdre un instant, les trois sœurs Dalton se lancent aux trousses de l'infâme voleur, dans une course poursuite en forme de chevauchée endiablée qui nous tiendra en haleine pendant une heure quinze.
Le spectacle revisite et détourne tous les codes du western, dans un décor drôlement bien fichu, à la fois simple et très efficace (les comédiens retournent à vue des coins pour transformer en un tourne-main
un saloon en prison).
Comme le décor, simple et efficace, c'est l'air de rien que les comédien.ne.s déploient l'étendue et la multitude de leurs talents. Il s'en donnent à cœur joie et en rajoutent juste ce qu'il faut. On dirait qu'ils s'amusent, mais en réalité ils sont superpro ! Ils chantent, dansent, jouent du banjo, multiplient les gags et les aphorismes, chorégraphient des bastons... le tout avec une bande son calibrée au millimètre.
Même si ma fille de 5 ans a eu un peu de mal à bien comprendre toute l'histoire, elle a aimé ce spectacle dont l'énergie est communicative. Ma fille de dix ans, elle, a bien rigolé. Quant à ma sœur de 55 ans m'a dit en sortant "c'est le meilleur spectacle que j'ai vu depuis longtemps". C'est donc carton plein pour les Dalton.e.s. Bravo aux Nomadesques !
Jusqu'au 30 mars 2024
Théâtre Ranelagh - Paris XVIème
Compagnie les Nomadesques
55 minutes | de 10€ à 20€

En travers de sa gorge, Marc Lainé, Théâtre du Rond-point

Avec un beau décor, une scénographie impressionnante et avec, cerise sur le gâteau, Bertrand Belin au casting, cette pièce était pleine de promesses. Malheureusement, l'indigeste "En travers de sa gorge" m'est resté sur l'estomac !
Deux heures quinze durant, une narratrice (Julie Rompsault, Jessica Fanhan) nous conte - à grand renfort de passé simple et de formules ampoulées par-fai-te-ment ar-ti-cu-lées - l'histoire de Marianne Leidgens (Marie-Sophie Ferdane), une cinéaste dont le mari revient d'entre les morts.
Un an après sa disparition soudaine et inexpliquée, son mari (Lucas Malaurie, Bertrand Belin) vient lui rendre visite... mais dans la peau d'un autre ! L'esprit de Lucas prend en effet possession, de façon intermittente, de Mehdi Lamrani (Yanis Skouta), un spirite dont la spécialité est de finir les œuvres laissées inachevées par feus leurs auteurs.
Comme la personnage principale est cinéaste, Marc Lainé (auteur-metteur en scène et scénographe) a eu la subtile idée de projeter le film de la pièce (réalisé en direct) sur un grand écran situé au dessus de la scène. Manifestement, Marc Lainé est très fier de ce dispositif qui lui permet de montrer le fantôme du mari sur scène, mais pas à l'écran.
Évidemment, Marianne finit par faire l'amour avec le médium, dans l'idée de ne former à travers lui qu'un seul corps avec son défunt mari (vous suivez ?!). Sauf que l'époux se fâche, au motif qu'il est cocu (par lui-même pour ainsi dire !). Se superposent alors à l'écran les visages du médium et celui du fantôme, pour bien souligner l’ambiguïté de la situation. C'est fin comme du gros sel, comme disait ma grand-mère.
Si la mise-en-scène est lourdingue, le texte, verbeux à souhait, n'est pas en reste. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les comédiens n'arrivent pas à jouer ? Ou sont-ils gênés par la sonorisation qui nous donne l'impression de regarder un film mal doublé ? (J'ai horreur des micros au théâtre !)
C'est à un point tel qu'on est parfois embarrassés pour les comédien.ne.s.
A moins qu'il ne s'agisse d'un parti-pris de mise en scène et de direction d'acteurs ?
Ce doit certainement être le cas, sinon comment expliquer que strictement aucun.e comédien.ne ne soit juste ? Leurs énervements sonnent creux, à la limite du ridicule. Et que dire des roulements d'yeux du médium lorsqu'il a ses crises ?! C'est injuste car l'apprentissage du texte a dû leur demander un effort considérable.
Même si je rêvais de mettre fin à mon calvaire façon Yannick (de Quentin Dupieux), je dois reconnaitre que tout n'est pas à jeter dans cette pièce. Les moyens mis en œuvre sont importants : cinq comédiens sur scène, des décors réussis et qui changent à vue (c'est beau !), des moyens de prise de vue (rampe de travelling comprise), un soin apporté au son (avec, par exemple, des bruits de fonds différents quand deux personnages se parlent au téléphone).
C'est toujours intéressant d'aller au théâtre, même quand c'est mauvais. Et c'est réjouissant une salle de théâtre comble (je m'ennuyais, donc j'ai regardé le public...). Et puis à la sortie, on discutait joyeusement, ébahis d'avoir vu un spectacle qui, en plus d'être une pièce exécrable (je la mets dans le Top 50 des pires pièces que j'ai vues !), réussit l'exploit d'être aussi un mauvais film.
du 6 au 16 mars 2024
Théâtre du Rond-point - Paris VIII
Texte, mise en scène et scénographie Marc Lainé
Avec Bertrand Belin, Jessica Fanhan, Marie-Sophie Ferdane, Adeline Guillot en alternance avec Clémentine Verdier, Yanis Skouta
avec la participation de Dan Artus, Tünde Deak, Thomas Gonzalez et de Laurie Sanquer, David Hanse, Farid Laroussi

Journal d’un vide, Emi Yagi, 10/18

Comment échapper au travail lorsqu'on s'y ennuie terriblement et qu'on a l'impression d'y gâcher les premières années de sa vie d'adulte ? Mme Shibata, trentenaire japonaise, trouve une solution en simulant une grossesse.
A travers cette chronique d'une grossesse imaginaire, ce Journal d'un vide, l'autrice Emi Yagi décrit de façon implacable l'ennui au travail.
"Tous les employés restaient de longues heures au bureau. Chaque réunion était le prétexte à rassembler l'ensemble du personnel dans une salle pour y écouter les supérieurs répéter inlassablement les mêmes discours, idées et griefs, plusieurs fois par jour ; la moindre dépense devait être justifiée en détail auprès du chef de section, puis reformulée à l'intention du directeur de département, avant d'être finalement présentée sous la forme d'une épaisse liasse qu'il fallait distribuer, Dieu sait pourquoi, à chaque membre de l'équipe. Nous n'avions ni le temps ni l'énergie de réfléchir au sens de nos actions, encore moins de poser des questions." (page 58)
Emi Yagi adopte un ton clinique, détaché et assez plat (lorsqu'il n'est pas indigeste !). Cette voix monocorde sert un propos consistant à démontrer la monotonie et l'ineptie du travail de bureau, surtout lorsqu'en tant que femme, on se voit confier l'intégralité des tâches ingrates ou peu valorisées (préparer le café, vider les corbeilles...).
Cette dénonciation du machisme au travail (qui n'est certes pas l'apanage des japonais...) est agrémentée de considérations assez convenues sur la vie, le couple, l'amitié.
"Je me sens seule. (...) Peut-être est-ce bizarre, car c'est notre lot à tous depuis notre naissance, mais je n'y suis toujours pas habituée. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que, dans la vie, c'est chacun pour soi." (page 191)
Il m'a semblé que l'intérêt de ce livre (vite lu) ne dépassait pas vraiment l'idée de départ. Journal d'un bide, en ce qui me concerne.
Paru en poche le 1er février 2024
chez 10/18 Littérature étrangère
traduit par Mathilde Tamae-Bouhon (japonais)
216 pages | 8,60€
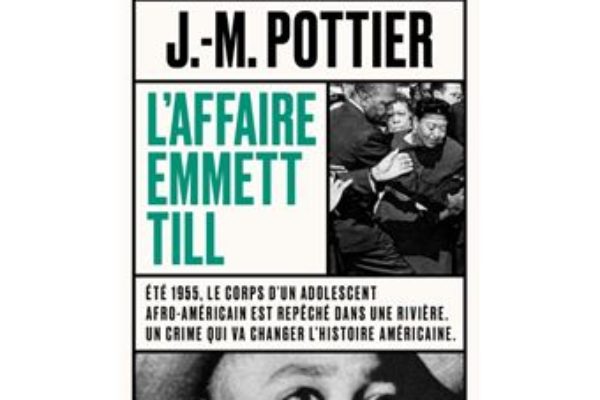
L’affaire Emmett Till, Jean-Marie Pottier, 10/18 Society
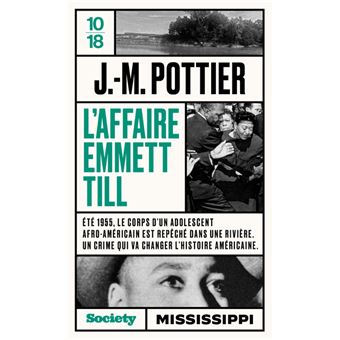
A la fin de l'été 1955 est retrouvé dans la Tallahatchie River le corps d'un gamin de 14 ans, un jeune noir de Chicago qui passait ses vacances "dans cette région d'un Mississippi qui reste, un siècle après l'abolition de l'esclavage, l’État le plus ségrégationniste des États-Unis" (page 19).
Le jeune homme a été enlevé puis assassiné par des blancs pour avoir osé siffler une femme blanche.
Sa mère l'avait pourtant prévenu. " (La) ségrégation, Mamie veut que son fils en respecte les règles pour ne pas se mettre en danger, surtout dans ses interactions avec les femmes blanches. Si Emmett en voit une, conjure-t-elle, qu'il baisse la tête pour éviter de croiser son regard, ou qu'il change de trottoir. Il ne doit pas parler aux blancs, sauf s'il y est invité " (page 32)
Certes, il y aura un et même plusieurs procès, mais que peuvent espérer des noirs d'une justice blanche ? "L'affaire était perdue dès le départ. Un jury aurait rendu sa liberté à n'importe quel homme qui aurait tué un noir pour avoir insulté une femme blanche." (page 111)
Mais c'est sans compter sur la mère d'Emmett, qui va s'opposer de toutes ses forces à la volonté des autorités d'enterrer précipitamment son fils en même temps que l'affaire. Elle fera rapatrier la dépouille d'Emmett à Chicago où elle présentera son visage martyrisé au public, donnant à cette mort injuste un écho qui résonnera pendant plusieurs décennies et qui marquera la lutte pour les droits civiques.
"Elle disait toujours que c'était son destin, qu'il devait mourir pour que le monde puisse saisir les injustices et les lynchages qui se déroulaient depuis des générations." (page 205)
Comme c'est toujours le cas avec l'excellente collection True crime de 10/18 Society, Jean-Marie Pottier signe une enquête fouillée et documentée qui se lit aussi facilement qu'un roman. J'ai juste un peu regretté que le récit ne parvienne pas vraiment à restituer le souffle que cette affaire a donné à la lutte pour les droits civiques.
Paru le 1er février 2024
10/18 Society True Crime
240 pages | 8€

Argylle, Matthew Vaughn, Marv Films

Avec cette histoire délirante d'une écrivaine découvrant à ses dépens que les vrais espions ne ressemblent pas aux héros de ses livres à succès, le réalisateur Matthew Vaughn mêle - comme à son habitude - action et dérision.
Lorsque le film démarre avec la voix chaude et apaisante de Barry White, on s'attend à passer un bon moment, un agréable cocooning qui nous réconforterait au cœur de l'hiver. Hélas, on constate vite que le réalisateur de Kingsman et de KickAss a perdu son mojo !
La scène d'ouverture à la James Bond, avec la rituelle poursuite motorisée dans les ruelles d'une ville du sud, donne le ton du film : à la fois grandiloquent et ironique. Car dans ce film à gros moyens, tout est à prendre au second degré, sauf les placements de produits pour Apple, qui paye la facture des 200 millions de dollars de budget !
Malheureusement, et personne ne rit dans la salle.
Tout le monde s'ennuie dans la salle. Personne ne rit. tant l'humour supposément décalé fait flop. Et ça n'est pas mieux à l'écran. Même des comédiens aussi talentueux que Sam Rockwell (qui campe un espion aussi flegmatique que crachepouille) et Bryan Cranston (qui incarne le trouble grand patron d'une organisation secrète implacable) s'ennuient. Mais au moins sont-ils payés pour assister à cette daube, eux.
Le scénario enchaine les retournements jusqu’à l’écœurement et la lourdeur de l'histoire n'est pas rachetée par la succession ininterrompue de scènes de baston, ni par les effets spéciaux numériques aussi pléthoriques que moches (merci Apple...).
Twist sur twist sur twist pendant 2h15, c'est loooong, car pour créer du rythme, il ne suffit pas de multiplier les morts violentes. (Il doit y avoir un mort toutes les dix secondes ; vous avez remarqué comme empiler les cadavres est une manie dans les films (anglo) américains ?).
Au cinéma le 31 janvier 2024
135 minutes

Un état de nos vies, Lola Lafon, Rond-Point

Lola Lafon, l'écrivaine du formidable Quand tu écouteras cette chanson,monte sur les planches pour nous livrer son regard affuté sur le monde.
Une femme et un homme se font face, chacun à une extrémité d'une longue table en bois. Comme dans une expérience scientifique, ou un test psychologique, il prend un petit carton, énonce un mot et attend sa réponse. Elle donne alors sa définition toute personnelle du mot, livre ce que cela lui évoque. En une heure de spectacle et à travers quelques mots ("être", "gauche", "jamais"... ) nous naviguerons dans notre société.
En observatrice avisée et lucide, Lola Lafon nous met gentiment face à nos contradictions, nos lâchetés, notre hypocrisie. Elle moque la Gauche réduite à "une alternative, c'est-à-dire un autre moyen d'aller au même endroit".
Elle pointe l'absurdité d'un système qui rend "l'inégalité de traitement désirable" et qui nous pousse à "être envahis du désir d'avoir ce qu'on ne désire pas", d'une société qui valorise la punchline alors que "savoir réduire son propos en quelques mots, c'est un idéal d'agent immobilier".
Lola Lafon interroge également la pingrerie de notre générosité et la faiblesse de nos actions face à l'horreur et l'injustice. "On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas" certes, mais en réalité "plus on sait, moins on peut".
Mais n'allez pas croire que vous allez vous faire gronder ou bêtement culpabiliser pendant une heure. Vous allez rire et, l'air de rien, réfléchir en profondeur.
Jusqu'au 09 décembre 2023
Théâtre du Rond-Point, Paris VIIIème
Un spectacle de et avec : Lola Lafon
Composition et interprète : Olivier Lambert
Collaboration artistique et lumières : Emmanuel Noblet

L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Frédéric Tellier, SND Films

Un honnête film du dimanche soir qui rend hommage à un impressionnant bonhomme dont le combat contre la pauvreté est toujours d'actualité.
Fils d'un riche industriel lyonnais et catholique, Henri Grouès consacra sa vie au Christ en devenant frère Capucin, un ordre de moines qui vivent dans une pauvreté. Mais il était trop fragile pour cette vie dénuée de tout.
"Vous n'êtes pas fait pour les capucins (...) vous serez plus utile ailleurs" lui dit le Père Abbé au bout de sept ans.
Après le monastère, Henri Grouès connaitra le désert, s'engagera dans la Résistance, se fera élire député avant de fonder Emmaüs, "un endroit pour ceux qui n'ont plus rien", un lieu où les exclus sont accueillis sans qu'on leur pose de questions, sinon celle de savoir s'ils ont faim. Rebaptisé "Abbé Pierre", Henri Grouès dédiera alors son existence aux plus pauvres. "Servir avant soi qui est moins heureux que soi" fut sa devise.
Car pour l'Abbé Pierre, un homme est un frère, tout simplement. Sa générosité sans œillères et l'intensité de son indignation forcent l'admiration.
Benjamin Lavernhe (de la Comédie française) impressionne par son interprétation de l'Abbé Pierre, de ses vingt ans jusqu'à ses quatre-vingt-quatorze ans. Au-delà de la transformation physique (d'ailleurs plutôt réussie) à grand renfort de prothèses, ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont le comédien redonne vie à la voix l'Abbé, à sa diction si particulière à la fois fragile et chevrotante mais d'une force et d'une détermination sans failles.
J'apprécie aussi que les auteurs du scénario aient mis à l'honneur Lucie Goutaz (interprétée par Emmanuelle Bercot), celle qui fut la compagne de route de l'Abbé et la cheville ouvrière d'Emmaüs.
Pour le reste, le film est vraiment réalisé au gros sel. Le réalisateur, Frédéric Tellier, ne lésine pas sur le lyrisme un peu grandiloquent. Au menu notamment: beauté des paysages et musique expressive (avec cuivres et roulements de tambour crescendo pour faire monter l'émotion). Par moments, le film devient vraiment n'importe quoi au plan visuel ! Il y a parfois d'étranges zone de flou à l'image. Et dans la période "rock star" de l'Abbé (après qu'il a lancé un appel retentissant à la générosité à la radio à l'hiver 1954), on voit simultanément jusqu'à six Benjamin Lavernhe à l'écran, à grand renfort de split screens,
L'Abbé Pierre, une vie de combat est clairement un film de producteurs qui ont fait appel à un bon film maker et qui ont engagé un comédien capable de tenir le haut de l'affiche. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Comme en témoignent le nombre de figurants et la qualité des costumes et des décors signés Nicolas de Boiscuillé, le film n'est pas fait à l'économie. On sent cependant un peu trop l'ambition de rentabiliser les 15M€ de budget en surfant sur l'image d'Emmaüs (à qui ne seront pas reversé de royalties).
L'Abbé Pierre, une vie de combat, est au demeurant un film honnête dont les auteurs se sont vraiment documentés. On n'est pas dans un biopic américain où tout est faux ! C'est un bon film familial dont il faut espérer qu'il remettra à l'honneur un message et un combat malheureusement toujours d'actualité.
"En temps de guerre, on ne dit pas Pouce, y a plus de sous !"
Au cinéma le 08 novembre 2023
SND Films | WY Productions
137 minutes

T-ma-vie-en-t-shirts, Haruki Murakami, 10/18

A la demande d'un magazine japonais, l'écrivain Haruki Murakami a commis une série d'articles qui sont aujourd'hui compilés en un court livre illustré et intitulé "T - ma vie en t-shirts".
L'auteur précise tout de suite qu'il s'agit d'un livre sans prétention : "Je ne suis pas sûr que ce livre sera d'une quelconque utilité à qui que ce soit (et encore moins qu'il contribuera à résoudre les innombrables problèmes du monde actuel). " (page 11)
Haruki Murakami fait tout son possible pour se rendre sympathique en multipliant les adresses au lecteur. "Vous n'êtes pas d'accord ?" (page 24), "vous en conviendrez" (page 45), "vous ne vous sentez pas concernés ?" (page 109), "vous n'êtes pas d'accord ?" (page 145).
Personnellement, cette connivence artificielle m'a vite lassé. Et puis, on peut aussi penser que, sous cette légèreté revendiquée se cache en réalité une grande prétention. Car il n'en faut pas manquer pour sortir un livre aussi creux (même si, j'en conviens, on a bien le droit d'écrire, et de lire, des livres légers).
Certes, ce n'est pas désagréable et c'est très vite lu mais, franchement, c'est assez vide. Autant, en série d'articles estivale, ça peut être sympa, autant cela ne mérite pas le détour par la case édition, ni les 9,60 € qu'il vous en coûtera pour acheter le bouquin, sauf si vous voulez l'offrir à votre (grand) père boomer qui pense rester dans le coup en portant des t-shirts de jeune.
Parution en poche le 02 novembre 2023
10/18 Collection Littérature étrangère
192 pages / 9,60€
Hélène Morita (traduction)

Quand tu écouteras cette chanson, Lola Lafon, Stock

Dans le cadre de la Collection Ma nuit au musée, l'autrice Lola Lafon a passé une nuit dans la maison d'Anne Franck et a tiré de cette expérience un livre intime, poétique et bouleversant.
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu au collège le Journal d'Anne Franck, "que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment" (page10) J'en ai d'ailleurs gardé un souvenir mitigé car, jeune ado mâle, j'étais plutôt agacé par la jeune fille en qui je reconnaissais certaines camarades de classe (je n'étais moi-même pas bien malin...).
Devenu père d'une belle demoiselle qui entrera bientôt dans l'adolescence, je suis désormais bouleversé par Anne Franck, mais aussi par l'histoire de son père, cet homme dont tout ce qu'il reste de sa famille c'est le journal écrit par sa cadette et un rectangle de papier peint sur lequel il marquait chaque mois la taille de ses filles ("en deux ans, Margot a pris un centimètre et Anne, treize") et qu'il "décollera précautionneusement" à son retour des camps de la mort (page 83).
Grâce à Lola Lafon, j'ai découvert chez Anne Franck une véritable autrice, qui retravaillait son texte et prenait très au sérieux le fait d'écrire. Quand on y pense, c'est vrai qu'il y a dû y en avoir quelques uns des journaux intimes de jeunes juives, et si celui-ci a connu la postérité, c'est aussi sans doute dû à ses qualités littéraires.
Mais que je ne vous induise pas en erreur, Quand tu écouteras cette chanson n'est pas une étude stylistique ou historique de Journal d'Anne Franck., même s'il relate des faits marquants et comporte quelques citations qui soulignent la maturité de la jeune fille.
"On ne me fera pas croire pas croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes, oh non, les petites gens aiment la faire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps ! Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d’assassiner et de s’enivrer de violence" (page 123)
Quand tu écouteras cette chanson est un livre personnel et intime constitué de courts chapitres d'une densité rare et d'une puissance folle, ce qui le rend d'autant plus émouvant. Il suffit à Lola Lafon de quelques mots pour nous faire ressentir ce que signifie être descendant de rescapés de l'indicible, de vivre avec un cortège de morts qui vous suivra jusqu'à la vôtre.
Car l'histoire d'Anne Franck touche de près l'autrice, cette grande blonde au nom de famille bien français qui a refoulé l'histoire d'une partie sa famille. Lola Lafon est issue par sa mère d'une famille de juifs d'Europe de l'est.
"L'histoire des juifs d'Europe centrale, je m'en suis écartée à l'adolescence. J'ai tourné le dos à l'abîme. Je ne voulais pas entendre, pas savoir. Leurs cauchemars ne seraient pas les miens. Ce que je souhaitais, c'était faire partie d'une famille normale. Qui ne soit le sujet d'aucun livre d'histoire, qui ne suscite ni pitié, ni haine" (page 45)
Les survivants directs de l'holocauste ont fait comme ils ont pu : "Lexomil et Temesta, compagnons de route de mes grands-parents, comme de tout leur entourage, ces immigrés juifs russes, polonais, roumains" (page 155)
Comment vivre quand on appartient aux générations suivantes ? Celles dont l'arbre généalogique a été taillé à la hache et réduit en cendres.
Comme le démontre Lola Lafon dans une prose délicate et percutante, cacher le traumatisme sous le tapis est illusoire : "Le ravage, dans ma famille, s'est transmis comme ailleurs la couleur des yeux" (page 44), "les fantômes, au contraire du mythe qui voudrait qu'ils nous hantent sans pitié, se tiennent sages" (page 53)
Paru le 17 août 2022
Éditions Stock, Collection Ma nuit au musée (dirigée par Alina Gurdiel)
180 pages | 19,50€

Récitatif, Toni Morrison, 10/18
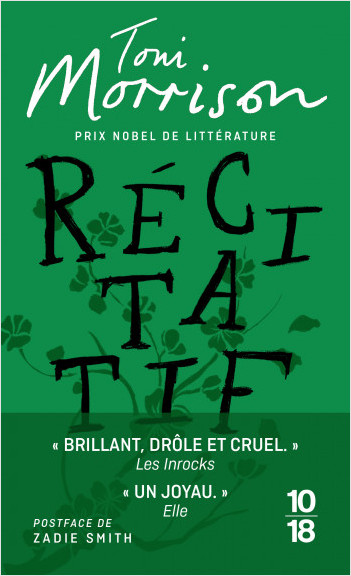
Récitatif, la seule et unique nouvelle jamais écrite par la prix Nobel de littérature Toni Morrison, nous est vantée par le bandeau presse comme "un joyau" "brillant, drôle et cruel".
L'histoire est assez simple : deux fillettes de "races différentes" partagent pendant quatre mois une chambre dans un orphelinat. Elles sont alors inséparables et complices. Devenues adultes, elles se recroisent de loin en loin et constatent avec nostalgie et amertume que leur complicité enfantine a laissé place au malaise causé par la question raciale.
Ce court texte (59 pages) est conçu comme "l'expérience d'ôter tous les codes raciaux d'un récit concernant deux personnes de races différentes pour qui l'identité raciale est cruciale" (page 64). En gros, le truc du livre, c'est qu'il est impossible de savoir en le lisant qui est noire et qui ne l'est pas, alors que cette question est prédominante dans les relations entre les deux (ex) copines.
Dommage pour moi, j'ai postulé dès le départ que la narratrice était noire, tout simplement parce que Toni Morrison l'est et parce que je pensais qu'il s'agissait d'un texte autobiographique. Ce n'est donc qu'en parcourant la postface que j'ai compris de quoi il retournait.
Moi qui n'aime ni les préfaces, ni les nouvelles ni les postfaces (surtout quand elles sont plus longues que le texte lui-même !) j'ai bien peur d'être totalement passé à côté du livre...
Il m'en restera malgré tout le souvenir d'une nouvelle très bien ficelé, émouvante et percutante, dont la première phrase est assez géniale : "Ma mère dansait toute la nuit et celle de Roberta était malade".
Paru le 07 septembre 2023
chez 10/18
Zadie Smith (postface de),
Christine Laferrière (traduit par)
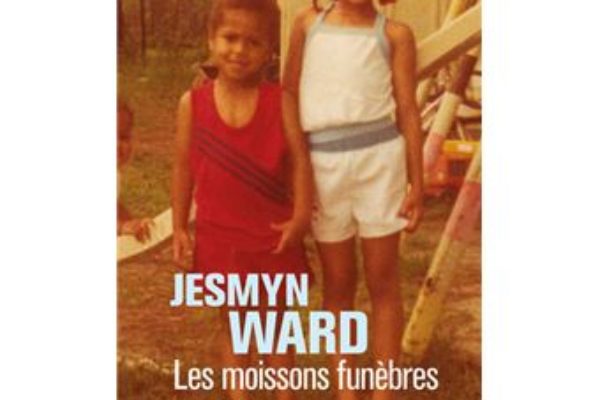
Jesmyn Ward, Les moissons funèbres, 10/18
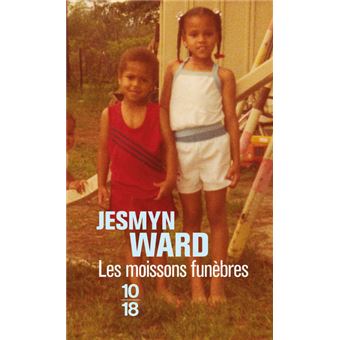
"La plupart des hommes que je connais pensent que leur vie, qu'ils soient dealers ou rangé des voitures, vaut la peine d'être couchée par écrit. A l'époque, je me contente de rire. Aujourd'hui, en écrivant ce livre, je vois bien qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette assertion." (page 86)
Jesmyn Ward se livre à un récit autobiographique plein de langueur et de nostalgie. Elle raconte son enfance dans le Mississippi des années 90 (elle est née en 1977) et l'on pourrait avoir la fausse impression qu'il ne se passe pas grand chose dans ce livre aux chapitres écrits comme des nouvelles.
Pourtant, à travers sa propre histoire et celles de cinq de ses proches morts en à peine quatre ans, l'autrice décrit "la dure réalité qui attend les jeunes Noirs dans le Sud - chômage endémique, pauvreté et drogues diverses pour faire passer le tout." (page196).
Avec son écriture humble et claire, Jesmyn Ward aborde des thèmes lourds et fondamentaux. Elle parle de racisme endémique, de pauvreté, de violence, de l'emprise de la drogue, du traumatisme de l'esclavage (dont les répercussions sont toujours visibles sur les familles) ou encore de l'inégalité entre les hommes et les femmes.
Les jeunes s'ennuient, il glandent et s'évadent comme ils peuvent grâce à l'alcool et la drogue. Mais c'est bien plus qu'une langueur adolescente. On est frappé par l'absence totale de perspective de ces jeunes dont on peine à croire qu'ils vivent dans la première économie mondiale.
"Toute la communauté souffre d'un déficit de confiance: nous ne pensons pas la société capable de nous offrir un minimum d'éducation, de sécurité, d'emplois décents et de justice. Et ce manque de confiance en la société qui nous entoure, en la culture dans laquelle nous baignons et qui nous rappelle sans cesse notre infériorité, nous amène à nous méfier de tout le monde." (page 193)
Un petit livre profond.
Parution en poche le 07 février 2019
chez 10/18 collection Littérature étrangère
Éditions Globe
288 pages | 8,30€
Traduction (anglais USA): Frédérique Pressmann

Anatomie d’une chute, Justine Triet, Le Pacte

A voir l’affiche et la bande-annonce, je m’attendais à un Faites entrer l’accusé au pays des bobos. Pas très motivant…
Heureusement, mon épouse m’a convaincu de voir ce film qui mérite de figurer sur votre liste de rentrée !
Un couple, Sandra et et leur fils, Daniel, vivent dans un chalet de montagne dans les Alpes. Elle est une écrivaine allemande et tente de mener un entretien avec une étudiante. A l’étage, son mari pousse la musique tellement fort que les deux femmes doivent renoncer à l’interview. L’ambiance est délétère…
La jeune femme préfère s’en aller, tandis que le petit garçon du couple sort faire un tour dehors avec son chien (il est malvoyant). A son retour, l’enfant trouve le corps de son père, mort, sur le perron de la maison. Les secours sont prévenus et, assez rapidement, la mère est soupçonnée d’avoir jeté son mari par la fenêtre et se retrouve face à ses juges.
C’est bien plus qu’un simple film à suspens.
Justine Triet aurait pu faire de l’intrigue l’élément principal de l’histoire. Alors, le film aurait été tout autre mais, à mon avis, nettement moins intéressant !
Savoir si elle a tué son mari ou pas n’est pas vraiment la question. L’enjeu est ailleurs : il s’agit de parler du couple et, plus généralement, des relations interpersonnelles, de la façon dont elles peuvent se détériorer, se déliter avec le temps. Dans la vie, il peut être tentant de faire peser ses propres échecs sur quelqu’un d’autre. Blâmer son partenaire plutôt que soi-même est une solution facile. Mais c’est à ce prix qu’on pourrit une relation.
Je loue Justine Triet de parvenir à déboucler son histoire sans verser dans le travers qui consiste – comme dans beaucoup de films - à délier des situations inextricables par une franche discussion qui sert de point d’orgue émotionnel à l’intrigue. Ici, ce n’est pas en discutant que mère et fils règleront leur problème !
Ce n’est pas qu’un film de procès
C’est toujours difficile de faire un film sur un procès, cela peut vite être barbant et irréaliste. Ici au contraire, Justine Triet et Arthur Harari (son mari et coscénariste) utilisent les audiences à la Cour d’assises de façon très habile pour dévoiler l'intime.
Bien sûr, il y a quelques petites choses qui manquent de crédibilité : le public de la Cour d’assises, la rapidité avec laquelle l’accusée se met à parler français parfaitement… Mais ces détails ne font pas le poids face aux nombreuses qualités du film.
Lors du procès, il y a quelques débats d’experts pour tenter de déterminer techniquement si le défunt s’est jeté par la fenêtre ou s’il a été poussé par sa femme, mais le plus intéressant n’est pas là. L’important, c’est que les différents témoignages nous éclairent sur la relation de couple et sur le drame. Par exemple, le témoignage du psy montre comme le mari et la femme voient leur vie différemment et comme l’amour et la bienveillance du début ont pu laisser place à la jalousie et à la rancœur. Ainsi, un même événement est vu et vécu de façons diamétralement opposées. C’est fascinant.
Une grande maîtrise formelle
J’ai relevé le soin particulier apporté par la réalisatrice au cadrage et au hors champ. Par exemple, Julie Triet ne montre jamais les jurés. Il lui arrive aussi de placer la caméra derrière un spectateur, comme si nous étions dans la salle. Parfois, un truc passe dans le champ, un bras ou autre, renforçant notre sentiment d’être une petite souris assistant au théâtre judiciaire. La façon de filmer est à la fois d’une grande technicité et d’une grande sobriété. La réalisatrice résiste à la tentation de faire de belles images avec les paysages de montages.
Au-delà de l’image, les bruits et les sons jouent un rôle crucial dans ce film. Un comble au cinéma ! Il est d’ailleurs frappant qu’un des personnages principaux (le fils) soit malvoyant. Les choses ne sont claires pour personne !
Il n'y a, pour ainsi dire, pas de musique (on n’est pas chez Clint Eastwood avec ses musiques qui soulignent lourdement les émotions !), mais Julie Triet peaufine la place des sons. Ainsi, la musique assourdissante qui passe en boucle au début du film crée une ambiance qui nous met mal à l’aise alors que Sandra, elle, ne semble pas gênée plus que ça par ce déchaînement de décibels. C’est aussi par le son que l’on découvre au cours du procès des facettes du couple, de son intimité.
Des comédiens exceptionnels
Scénario, son, image, le film recèle de grandes qualités, on l'a dit. Mais la grande qualité du film réside dans la direction d’acteurs et dans la qualité exceptionnelle des interprètes. Même les personnages secondaires sont soignés. Les petits rôles ne sont pas négligés. Et que dire des rôles principaux ?
Sandra Hüller est, pour moi, une révélation. Cette allemande qui joue dans une autre langue que la sienne est épatante. Son personnage ambivalent lui permet de déployer subtilement une palette d’émotions.
Swann Arlaud joue un avocat aussi réservé que séduisant. Le duo qu’il forme avec Sandra Hüller fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé cette scène où ils sont dans un restaurant, il s'en dégage un trouble indicible.
Même le chien est phénoménal ! D’ailleurs, il a reçu pour sa prestation la Palm Dog (ce n’est pas une blague !)
J’ai entendu un critique (sur France Culture) dire que le personnage de Daniel n’était pas crédible car bien trop mûr pour son âge. C’est avec ce genre de raisonnement (les enfants ne volent pas bien haut), que le cinéma nous sert régulièrement des personnages d’enfants au ras des pâquerettes. Ici, au contraire, l’enfant n’est pas infantilisé mais bien traité comme un personnage, une personne, à part entière. Et c’est tant mieux car ce rôle complexe est servi par un acteur incroyable. Milo Machado Graner a une qualité de jeu folle et il dégage une émotion qui vous tirera des larmes. Je ne crois pas avoir vu d'acteur garçon (il a 15 ans) aussi bon depuis les débuts de Benoît Magimel, et encore Milo est-il un cran au-dessus de Benoît. (Je le mets au même niveau que Céleste Brunnquell, vue dans En thérapie, qui dégage la même force mais qui est un peu plus âgée, 23 ans.). Il est bouleversant.
Seul Antoine Reinartz ne m’a pas convaincu. Du moins au départ. Ce comédien incarne l’Avocat général, c’est-à-dire le magistrat qui, dans un procès pénal, représente la Société. Il ne juge pas l’accusé.e mais, en notre nom à tou.te.s, réclame aux juges une peine au titre du mal que l’accusé.e nous a fait, à nous tous. En principe, cette fonction suppose mesure et impartialité. Il est arrivé même qu’un Avocat général requière un acquittement.
C’est pourquoi, à première vue, je n’ai pas trouvé ce personnage très crédible. Mais, à bien y réfléchir, c’est justement parce qu’il se livre à un réquisitoire totalement à charge, parce qu’il ne parvient à cacher ni son agacement ni son impatience, qu’il permet aux autres personnages de se révéler. C’est vraiment lui l’intégrateur négatif de l’histoire (en management, l’intégrateur négatif, c’est la tête de con qui soude le reste de l’équipe.) Et c’est la preuve que ce film transforme même ses apparentes faiblesses en qualités.
Car l’on sent que ce magistrat – et à travers lui la Société - est horripilé par cette femme forte dont il cherche à tout prix à démontrer la culpabilité. Une femme libre n’est-elle pas, en effet, forcément coupable ?
Au cinéma le 21 mai 2023
150 minutes
Les films Pelléas | Les films de Pierre

Le poids du mensonge, Mitch Hooper, Manufacture des Abbesses

Lorsque Marc arrive chez Jean au petit matin, il ne sait pas que son ami vient de tuer femme et enfant. Les deux hommes discutent dans le jardin. L'atmosphère est tendue, les silences s'installent et la rancœur affleure. Manifestement, les deux amis de longue date ont des vieux comptes à régler.
"J't'en veux pas de toute manière.
- Alors pourquoi tu m'en parles sans cesse?"
Les deux hommes remontent ensemble le fil de leur relation amicale, une histoire qui mène au drame. En filigrane, Jean se dévoile. Au détour de phrases à double sens il confie son crime et les raisons qui l'ont poussé à assassiner les siens. Car - comme Jean-Claude Romand (dont le personnage est inspiré) - Jean a menti à tout le monde. Depuis toujours. Lui qui n'a ni diplôme ni emploi escroque ses proches pour vivre. Mais au moment où d'être découvert, il a préféré faire du passé table rase, effacer son passé. Jean est glaçant. Lorsqu’il n'élude les questions, il y réponds de façon à laisser planer le doute.
"T'es le roi du monde, comment t'as fait ?
- J'ai menti."
Par un flashback habile, nous revivons la veille du drame, quand les deux amis et leurs femmes ont dîné ensemble. Là aussi, la jalousie pointe. Chacun.e fantasme la vie de l'autre et lui envie la réussite qu'il lui prête. Mais les apparences sont trompeuses et la dissimulation est reine. On sourit parfois devant l'énormité des mensonges.
"Ça fait des années que je porte ce poids et là, soudainement, je suis en apesanteur.
- Quel poids ?
- Le poids du mensonge."
Jean est un personnage complexe que Julien Muller incarne posément et avec justesse. Le comédien joue tout en retenue et donne au rôle une belle profondeur. Mâchoires serrés et diction lente. il est froid et distant. Il transpire la colère rentrée et le cynisme. On va jusqu'à rire de l'aplomb de Jean qui semble assez content de lui, malgré tout.
"Tout le monde a voulu me croire. Il a fallu continuer. Ils m'ont obligé à mentir."
La mise en scène est à l'épure, du mobilier de jardin, quelques déplacements et c'est tout. Tout repose sur le jeu au cordeau des acteurs qui maîtrisent l'art complexe du silence au théâtre comme celui des longs dialogues.
Julien Muller est bien dans le rôle de Jean, on l'a dit, mais ses partenaires de jeu ne sont pas en reste. Anatole de Bodinat a le charme qu'il faut pour jouer Marc, le beau mec prometteur un peu looser, et c'est un plaisir d'assister à son face-à-face avec Julien Muller. Anne Coutureau restitue bien l'état d'esprit de la femme de Jean ; Carole est manipulée, larguée et résignée. Sophie Vonlanthen, enfin, sait nous montrer combien Laurence - la femme de Marc - est, sous ses airs candides, un personnage froid et pragmatique.
La tonalité de la pièce reste grave, sans verser dans la pesanteur. L'auteur et metteur en scène, Mitch Hooper, réinvente et transcende le théâtre de Boulevard. Sauf qu'ici ce ne sont pas les portes mais les coups de feu qui claquent !
Une pièce sobre, dense et efficace qui mérite d'être vue.
Jusqu'au 15 octobre 2023
Manufacture des Abbesses, Paris XVIII
de 10€ à 26€

Jacques et Chirac, Régis Vlachos, Marc Pistolesi, Contrescarpe
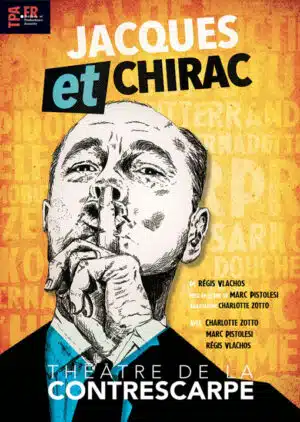
Après la pièce Chirac en 2019, le Théâtre de la Contrescarpe propose de nouveau un spectacle dont l'ancien Président de la République est le (anti) héros. Cette fois, c'est férocement drôle !
En ce 24 août 2023, septième jour de représentation de "Jacques et Chirac", la petite salle du Théâtre de la Contrescarpe est comble, preuve que le bouche à oreille fonctionne déjà bien. Dans le public, il ne semble pas y avoir d'admirateurs invétérés de Chirac... Sinon ils auraient jeté des tomates à la fin !
Rassurez-vous, ce n'est pas un spectacle politico-chiant, pas plus qu'une hagiographie ni un brulot anti-Chirac ; ce sont tous les Présidents de la Cinquième République qui en prennent pour leur grade !
Cette pièce, c'est de la dynamite ! Et plutôt deux fois qu'une.
D'abord, cette pièce, c'est de la dynamite au niveau de la mise en scène et de l'interprétation.
Ils sont trois sur scène. Régis Vlachos (qui signe également le texte) joue le rôle Chirac, tandis que Charlotte Zotto et Marc Pistolesi (aussi metteur en scène) incarnent à eux deux toute la galaxie des personnages gravitants autour de Chirac. Et en cinquante ans de politique, ça fait du monde !
Par un habile jeu de costumes et d'accessoires, les comédiens virevoltent et changent de personnages à toute allure. Pour un peu on se croirait dans un spectacle d'Arturo Brachetti (le transformiste italien) !
Les décors (signés Jean-Marie Azeau) regorgent de surprises. Chaque objet a un double usage : un bureau se transforme en canapé, un abat-jour en couronne... Et cela n'arrête pas pendant tout le spectacle. J'ai bien aimé aussi l'usage fait de la vidéo qui, bien plus qu'un simple élément de décor, agit comme un lien hypertexte, en parfaite synchronisation avec les comédiens.
Ensuite, cette pièce est explosive par son contenu. C'est aussi drôle que Douce France de Stéphane Olivié, mais plus féroce. Il y a un vrai décalage entre le ton survolté et comique de la pièce (Chirac en slip, une petite fille du public, qui n'avait pas les références historiques, était morte de rire) et le fond du texte.
Le texte, bien documenté, raconte comment Marcel Dassault, industriel et ami du père Chirac, a propulsé le jeune Jacques dans la politique. Au départ, le jeune parisien de bonne famille, légèrement paresseux et un brin rebelle, rechigne un peu. Mais lorsqu'il goute au frisson de la campagne électorale, c'est la révélation. Lorsqu'il entre dans l'arène politique, celui fut vendeur de l'Humanité (le journal du Parti Communiste Français!), qui se rêvât cowboy et qui se serait bien contenté d'une carrière peinarde de haut fonctionnaire se transforme en Bulldozer (comme le surnommait Pompidou).
Trouvant appui sur le cas Chirac (un sacré personnage, il faut bien le reconnaitre), la pièce dresse un portrait acide de la Cinquième République, rappelant des vérités historiques - "de massacres en génocides" - dont il n'y a pas de quoi être fiers. "Le réel, c'est pas croyable", c'est malheureusement parfaitement vrai.
C'est vif, c'est drôle, c'est instructif, c'est à voir.
Jusqu'au 05 novembre 2023
Théâtre de la Contrescarpe
de 11€ à 34€
Auteur : Régis Vlachos
Adaptation : Charlotte Zotto
Comédien·nes : Marc Pistolesi, Régis Vlachos, Charlotte Zotto
Mise en scène : Marc Pistolesi
Décor : Jean-Marie Azeau
Lumières : Thomas Rizzotti
Costumes : Coline Faucon, Louis Antoine Hernandez
Chorégraphie : Mathilde Ramade
Création son et vidéo : Cédric Cartaut
Illustration et graphisme : Emmanuelle Broquin, Cédric Cartaut
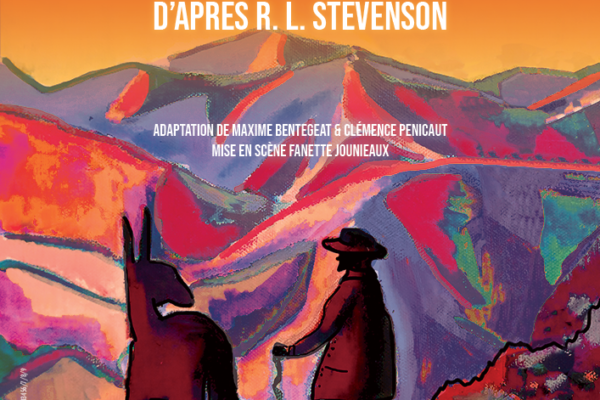
Voyage avec un âne, Robert Louis Stevenson, Fanette Jounieaux, Funambule
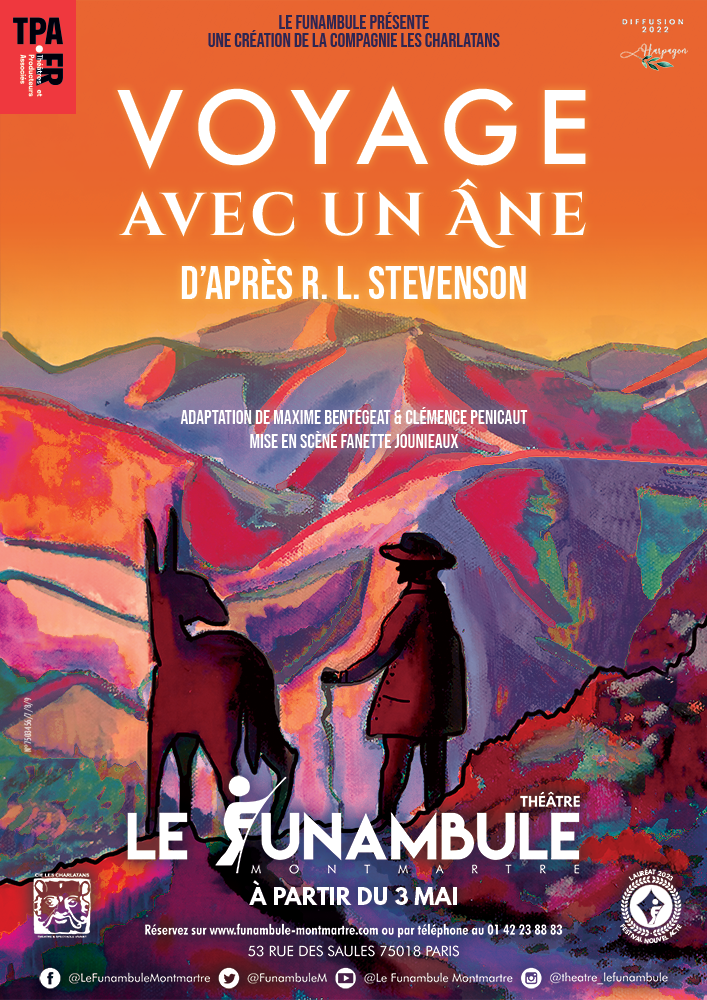
Pour terminer les vacances en beauté, que diriez-vous d'une randonnée dans les Cévennes avec un écrivain et une ânesse ?
Pour se remettre d'un chagrin d'amour, l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson (à qui l'on doit notamment Dr Jekyll & Mr Hyde et L'île au trésor) s'est lancé à la fin de l'été 1878 dans la traversé les Cévennes. 220km à pied dans un pays reculé où "il n'y a que des châtaignes et des oignons". Cette aventure a donné un livre intitulé Voyage avec un âne dans les Cévennes, aujourd'hui adapté au théâtre.
Maintenant que la randonnée est devenue une chose commune, on pourrait s'étonner que ce livre soit devenu un classique. Cela s'explique sans doute par le fait qu'il s'agit de l'un des tout premiers récit de la marche en tant que telle. "Je ne voyage pas pour aller quelque part, je voyage pour voyager, pour le plaisir de marcher."
Il faut dire aussi que Stevenson a un talent certain pour nous faire vivre l'aventure par procuration, talent partagé par la metteuse en scène Fanette Jounieaux. Pendant une heure, on part à l'aventure et l'on s'attache à Modestine. On marche sur des chemins difficiles, on dort à la belle étoile, on croise des aubergistes, des moines, des fermiers, des serveuses et autres paysans pas toujours très honnêtes ni accueillants de prime abord : "Je ne parle pas aux colporteurs !". Les rencontres sont drôles, belles, poétiques, mais la plus importante de toutes, c'est la rencontre avec Modestine, l'ânesse rétive mais charmante qui accompagne Stevenson dans son périple. Tout au long du voyage, elle sera sa meilleure amie et même la confidente à qui il livrera ses peines de cœur. Elle lui en fera baver aussi parfois, avec son caractère bien trempé.
Magie du théâtre, Modestine est aussi personnage central sur la scène du Funambule. C'est une comédienne qui - par une petit artifice bien trouvé - incarne l'ânesse d'une façon surprenante, amusante et convaincante.
Cette adaptation est très bien fichue. Beaucoup de choses passent par le son, il y a de nombreux bruitages qui sont fait à la vue du public, comme les changements de costumes (il n'y a, pour ainsi dire, pas de décor). La mise en scène et la scénographie sont efficaces, avec peu de moyens. Un comédien incarne Stevenson tandis que trois autres se partagent le reste des nombreux personnages.
C'est un beau moment de théâtre et j'ai regretté que ma fille de 9 ans ne m'ait pas accompagné car elle aurait été fascinée par ce spectacle qui se fait devant nous.
Jusqu'au 3 septembre 2023
Au Funambule Montmartre (53 rue des Saules 75018 Paris)
Tout public | durée 1h15

Barbie, Greta Gerwig, Warners Bros.
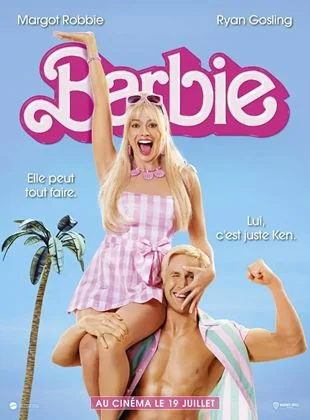
Deux heures de pub pour Barbie, c'est loooooong...
Appâté par une bande-annonce habile et un succès populaire notable (près de 4 millions de spectateurs en 3 semaines, quand-même !), je me suis laissé tenté par le Barbie de Greta Gerwig.
A BarbieLand, Barbie Stéréotypée vit entourée de ses copines Barbie et de ses admirateurs mâles, les Ken, dont l'unique ambition est de lui plaire. Vivre à BarbieLand, c'est comme vivre dans une comédie musicale rose bonbon inspirée du Jour de la Marmotte, mais en plastique. Tout le monde s'amuse bien jusqu'à ce que la plus belle des Barbie s'interroge sur le sens de la vie. Alors soudain le disque déraille, et notre Barbie stéréotypée doit se rendre dans le Monde Réel pour tenter de rétablir l'équilibre dans le sien.
Grâce à son talent d'actrice, Margot Robbie - qui est l'incarnation même de Barbie - rend ce film à peu près regardable. Ryan Gosling a, quant à lui, bien travaillé les pectoraux afin de ressembler à Ken, l'homme plastiquement parfait. Malheureusement, la préparation physique ne suffit pas à faire de lui un bon comédien. Car avec son expression figée, la star est définitivement un mauvais acteur, un de ces types à la Tom Cruise obligé de cacher son visage dans ses mains pour camoufler son incapacité à jouer.
Si le premier quart d'heure est assez réussi, la suite est poussive et ennuyeuse. Car peut-on parler de film quand il s'agit en réalité d'une longue page de réclame? Si l'on ne compte plus les placements de produits (Birkenstock, Converse, Yamaha, Chevrolet etc.) dans ce film qui est avant tout une publicité pour Barbie, orchestrée par le fabricant de la poupée lui-même. Ce très long métrage (durée 1h55, ressenti 4h00) est, en effet, une production Mattel ! Je m'étonne d'ailleurs que les foules se laissent prendre par ce bonbon acidulé et surtout très marketé.
L'objectif réel du film est confessé dans une réplique : "Il faut sauver Barbie" !
Si la Blonde à la taille de guêpe a pu être critiquée, c'est par des esprits chagrins et de façon outrancière (qui vont jusqu'à la traiter de "fasciste", rendez-vous compte !). C'est tellement terriblement injuste que la pauvre en pleure à chaudes larmes. Séquence émotion.
Car Barbie est "juste une poupée qui représente une femme" et qui montre aux petites filles qu'elles peuvent tout faire. Barbie, un outil féministe d'émancipation, donc.
En faisant le procès des ses détracteurs et en faisant mine de déconstruire Barbie, le film se livre en réalité à une totale réhabilitation de la poupée à la taille de guêpe et aux gros seins. Un peu d'autodérision et hop, on pardonne tout à Mattel ! Vous l'aurez compris, il s'agit finalement de vous donner envie, au XXième siècle, d'acheter une Barbie à votre fille, sans culpabiliser. Au passage, on va également vous refourguer un Ken qui n'est pas aussi inutile qu’il y parait. Et en plus il est revenu (bien vite) du patriarcat.
On peut y voir du second degré, moi je n'y vois qu'un cynisme consommé (et consumériste).
Le 19 juillet 2023
1h 55min
Mattel Productions / Warner Bros

La leçon du mal, Yûsuke Kishi, 10/18
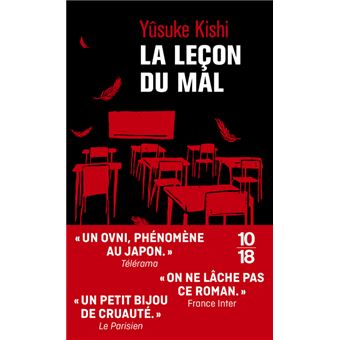
Un livre pour les amateurs de violence gratuite à la Tarantino. Un véritable scénario de série Z.
Seiji Hasumi est le séduisant professeur principal de la 1ère 4 du lycée Shinkö Gakuin, qui s'occupe personnellement de chaque membre de sa classe. Entre les élèves et le corps enseignants, on doit être pas loin de la trentaine ou quarantaine de protagonistes, dont certains ont des noms très proches (Sonoda avec des o comme prof de sport et Sanada avec des a comme prof de math...). Accrochez-vous pour vous y retrouver dans la foultitude de personnages. Personnellement, j'ai dû prendre des notes.
Assez rapidement, on comprend que ce professeur idéal n'est pas si gentil que ça. Manipulateur et dépourvu d'affect, il ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Le livre va donc inévitablement sombrer dans la violence la plus crue, la plus gratuite et, pour moi, la plus ennuyeuse qui soit.
Pour ce cocktail vu et revu, comptez trois doses de violence (ça dézingue à toute berzingue, avec des meurtres par pendaison, immolation, défenestration etc. etc.), deux doses de manipulation machiavélique (avec un personnage aussi séduisant qu'amoral), et une bonne dose de cul (y comprises l'incontournable infirmière cougar et nymphomane et les scènes de domination soft à tendance pédophilique...).
Pour couronner le tout, je trouve d'assez mauvais goût le fait de publier en France, après le Bataclan, un huis-clos où des jeunes se font méthodiquement tuer au fusil.
Si ce roman est un page-turner, c'est surtout parce qu'on a envie de mettre fin le plus vite possible au supplice que représente sa lecture !
Parution en poche le 17 août 2023
chez 10/18
624 pages / 10,10€
Traduction (japonais) Diane Durocher
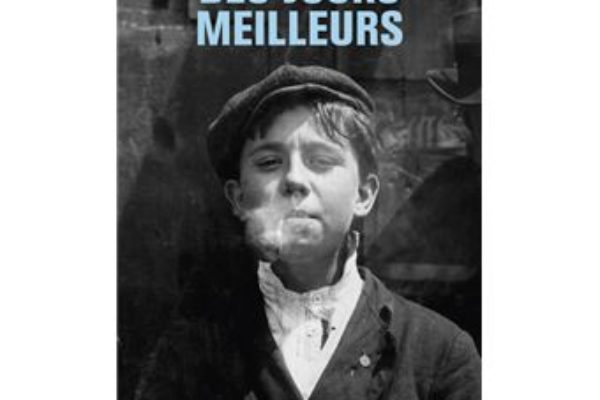
Des jours meilleurs, Jess Walter, 10/18
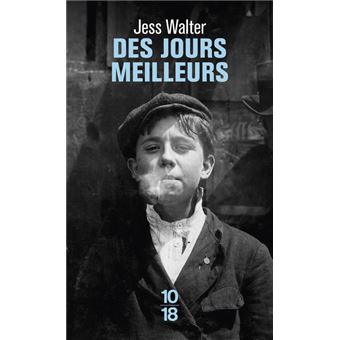
Une saga fraternelle, un roman passionnant sur les luttes syndicales des États-Unis du tout début du XXème siècle.
Jess Walter est né et vit à Spokane (État de Washington) ; il était donc bien placé pour écluser la bibliothèque locale et compiler en roman les articles de journaux de l'époque consacrés aux luttes syndicales qui se déroulèrent dans sa ville en 1909.
Il faut imaginer un monde où les travailleurs n'ont aucun droit et où la violence et la trahison sont reines. Une jungle où "Tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour un peu d'argent" (page 252) et où chacun lutte avec ses propres moyens avec pour ambition de changer le monde ou, plus modestement, de s'y faire une place confortable.
Deux frères. L'ainé, Gig, est un beau parleur séduisant et idéaliste qui passe son temps aux IWW (les Industrial Workers of the World), un syndicat ouvert à toutes et tous. Son petit frère Rye, 16 ans, est lassé de la vie de hobo et rêve de stabilité. Mais sa vie sera quelque peu bousculée lorsqu'il croisera le chemin d'Elizabeth Gurley Flynn, une militante syndicale de 19 ans au culot impressionnant (qui fondera plus tard le Parti Communiste Américain) . J'avoue humblement n'avoir jamais entendu parler d'Elizabeth Gurley Flynn avant de lire ce livre. C'est pourtant une figure historique dont la vie mériterait d'être enseignée à l'école. Un personnage bien réel, comme la plupart des protagonistes de ce livre.
Jess Walter fait évoluer ces deux frères de fiction au sein d'une révolte de travailleurs pauvres réprimée dans la plus grande violence par la police de Spokane en 1909. Des événements assez incroyables pour être vrais, car Jess Walter illustre parfaitement l'aphorisme d'Albert Camus (cité page 471 du livre) selon lequel "La fiction est le mensonge dans lequel nous disons la vérité. "
Ce n'est certes pas le roman le plus original qui soit, mais il est très efficace et je l'ai lu avec plaisir et intérêt. Tout au long du livre se pose la question de l'utilité du combat syndical. N'est-il pas perdu d'avance ? Les travailleurs ont-ils vraiment une chance de faire valoir leurs droits face à ceux qui les exploitent et accaparent éhontément les richesses ?
Ce livre nous rappelle avec à-propos la redoutable actualité de la défense des libertés et des droits fondamentaux. Car en filigrane, Jess Walter parle avec acuité de notre siècle qui est le digne héritier du précédent.
"Aujourd’hui nos poissons ont disparu (...). A cause de leurs foutus barrages. Maintenant, dans notre rivière, il n'y a plus que de la merde, des ordures et les déchets des mines. Sur terre, ils ont fait fuir tout le gibier avec leurs marteaux et leurs scies, ils ont arraché les baies dans les collines pour construire encore plus de maisons. Ils ont tué le monde et ils ont appelé ça "progrès" " (page 110)
Paru en poche le 15 juin 2023
chez 10/18 collection Littérature étrangère
480 pages / 9,60€
Traduction (anglais américain) Jean Esch
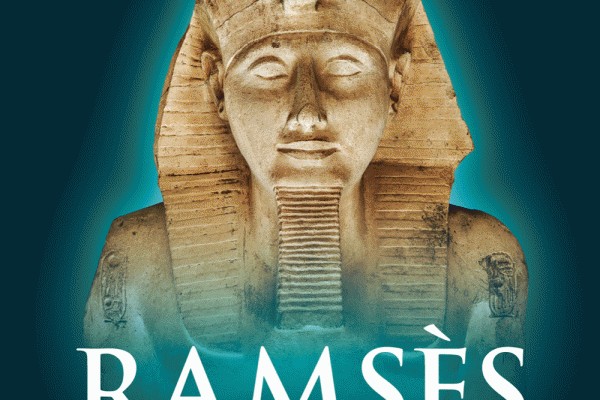
Exposition Ramsès & l’or des Pharaons, Grande Halle de la Villette
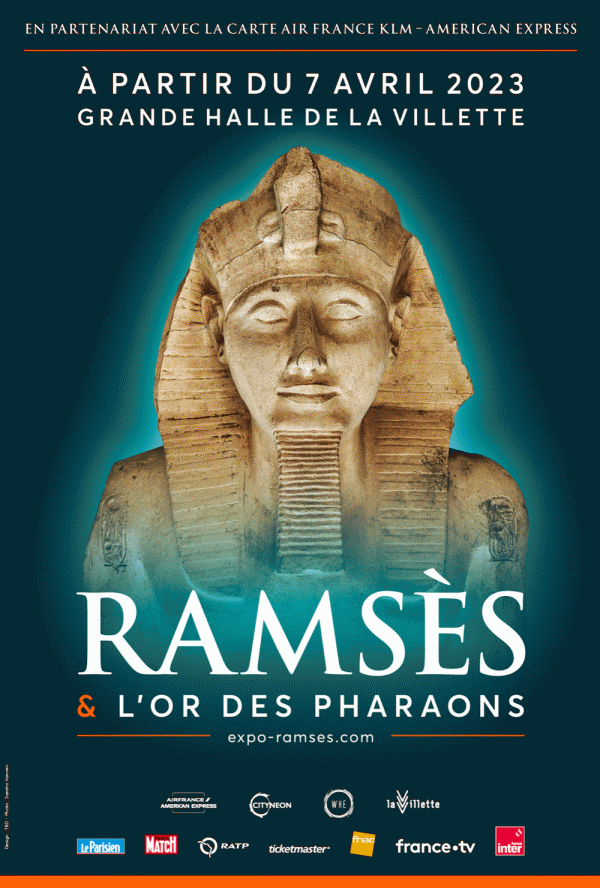
L'exposition Ramsès & l'or des Pharaons, depuis le 7 avril 2023 à la Grande Halle de la Villette, est prolongée jusqu'en septembre. Dépêchez-vous de ne pas y aller !
Je vous le dis franchement, les pharaons, moi je ne comprends pas. Je n'aime pas ni l'art pictural kitsch ni les tombeaux mégalos des égyptiens. Et puis, des mecs qui adoraient les chats ? Franchement !
Mais bon, pression sociale et marketing agressif obligent, ma fille de neuf ans a entendu parler de cette exposition sur l'Égypte antique à Paris, et j'ai voulu lui faire plaisir. Nous voilà partis pour la Grande Halle de la Villette.
A l'intérieur, les salles sont vastes afin d'accueillir un maximum de gogos... euh, de visiteurs. Le tarif est de 26€ par adulte et de 22€ par enfant, à partir de 4 ans, il n'y a pas de petits profits. Et si vous souhaitez imprimer vos billets, il vous faudra ajouter 1,50€ pour les frais (quels frais ? on se le demande puisque c'est mon imprimante qui tourne !).
Grandes sont les salles donc, mais petite est la collection d'objets présentés.
Pour faire diversion, les organisateurs ont recours à quelques vieux trucs. Tout d'abord, ils mêlent aux antiquités des éléments de décors en carton-pâte. C'est tellement moche qu'on se croirait dans la fille d'attente du manège Oziris du Parc Astérix.
Ils multiplient également les photos et les films (avec des animations bas de gamme à la clef).
Ensuite, ils cherchent à créer un suspens assez bidon sur le thème Est-ce que le cercueil de Ramsès II a été retrouvé ? A votre avis ? Réponse dans la dernière salle de l'exposition, aussi décevante que le reste.
Enfin, clou du spectacle et moyennant un supplément tarifaire de 20€ par personne, "L’exposition propose au visiteurs une expérience de réalité virtuelle immersive présentant les monuments sans doute les plus impressionnants de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari. Le fantôme de celle-ci accueillera le visiteur et l’entraînera à travers une aventure palpitante".
L'exposition Ramsès & l'or des Pharaons aurait pu s'appeler "l'Exposition Ramsès & les c... en or de ses organisateurs " !
PS: l'avis de ma fille sur l'expo : "J'avais envie de voir l'expo parce qu'ils en avaient parlé dans Salut l'info et qu'ils disaient qu'il ne fallait pas rater la dernière salle de l'expo sinon on risquait de manquer quelque chose. J'ai cherché, en vain, et j'ai été déçue ! Je pensais que c'était mieux que ça."
Expo Ramsès
Grande Halle de la Villette, Paris 19ème
TP 26€ | TR 20€
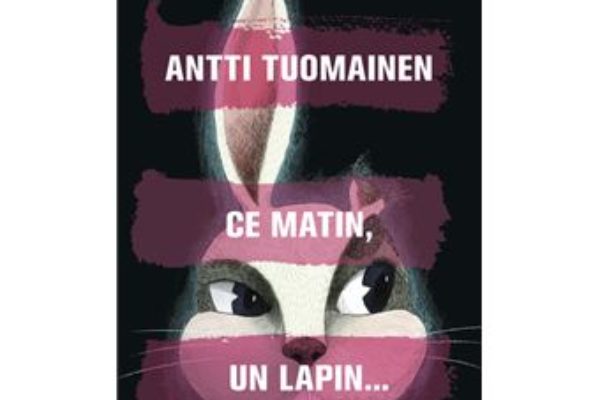
Ce matin, un lapin… Antti Tuomainen, 10/18
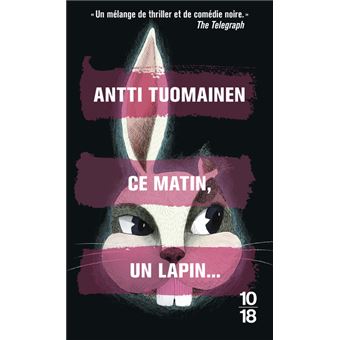
Henri est un matheux un peu autiste sur les bords. Alors qu'il vient de perdre son job d'actuaire dans une compagnie d'assurance, il hérite d'un parc de loisirs plein de surprises.
Henri réduit tout au raisonnement mathématique (c'est le running gag du livre...). "J'avais juré très jeune que ma vie se fonderait sur la raison, la planification, le contrôle et l'absolue nécessité de regarder la réalité en face et de toujours peser avec soin le pour et le contre. Dès l'enfance, j'avais vu dans les mathématiques la clé pour y parvenir. L'humanité était traîtresse, pas les chiffres. Le chaos régnait autour de moi, eux étaient garants d'ordre." (page 73)
Henri va à l'essentiel et ne s'encombre ni de possessions matérielles superfétatoires ni de relations humaines qui ne seraient pas strictement indispensables. Sa vie est bien rangée, et cela lui convient très bien : " Je trouvais plutôt inutile, dans la vie, d'aller au-devant des difficultés ; elles vous trouvaient bien assez vite d'elles-mêmes. " (page 61)
Lorsqu'il se retrouve soudainement chômeur puis propriétaire d'un parc d'aventure (pas un parc d'attractions, nuance), il pense naturellement gérer l'entreprise de façon rationnelle, comme il résoudrait "une complexe équation tridimensionnelle" (page 283). Mais évidemment, sa vie paisible va se retrouver bouleversée par l'aventure. D'ailleurs, au début du livre commence tandis qu'un "homme lourdement bâti, un gros balèze vêtu de noir " (page 13) le poursuit dans le dédale du parc. Et ce n'est que le début !
Malgré les tentatives (pas toujours réussies) de l'auteur de créer du suspens et de l'action, la lecture de ce livre ne recèle pas de grandes surprises. Les méchants sont caricaturaux, le personnage principal aussi et l'on n'est pas du tout surpris que sa rationalité se fracasse sur la réalité (y compris la réalité des sentiments).
Ce n'est certes pas désagréable, c'est même assez drôle mais pas passionnant non plus ; on est dans le pur divertissement. Ça fait penser à une série scandinave un peu cheap du genre de celles diffusées sur Arte. D'ailleurs, on sent bien que l'auteur - Antti Tuomainen - verrait bien son livre adapté à l'écran, fut-il petit. En témoignent, outre le fait qu'il termine son récit sur une fin ouverte, sa propension à remplir des pages de dialogues et à multiplier les gags macabres.
Ce matin, un lapin est le premier volet d'une trilogie. Personnellement je m'arrêterai là.
Paru en poche le 1er juin 2023
10/18 Polar
Traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
384 pages / 8,90€l
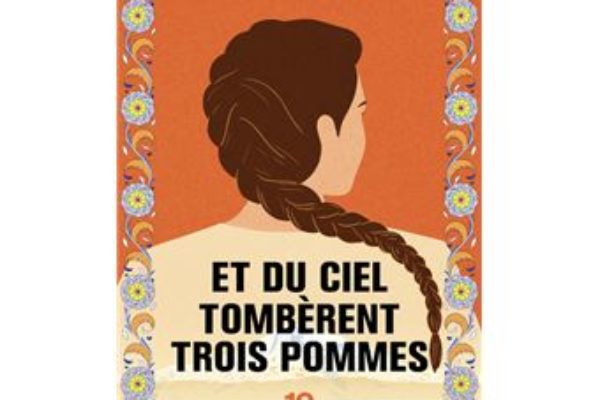
Et du ciel tombèrent trois pommes, Narinai Abgaryan, 10/18
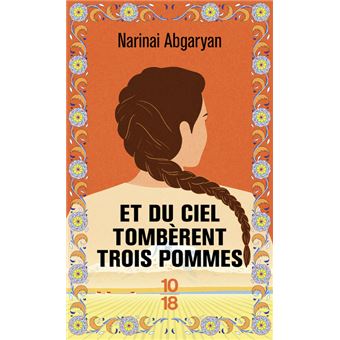
Dans un passé relativement récent, Anatolia - une vieille arménienne amoureuse des livres - se couche pour mourir. Mais la mort ne vient pas...
Alors, la grande faucheuse refusant de la prendre, Anatolia rêvasse dans son lit à l'histoire de sa famille et à celle de son village perché dans la montagne. Enfin, par dépit, elle se lie avec son voisin, un colossal forgeron capable de tuer un bœuf d'un seul coup de poing.
Narinai Abgaryan signe un roman sur la campagne arménienne, une campagne pittoresque et rude mais dont les habitants se respectent et s'entraident. Pour faire plus vrai, l'autrice en rajoute sur le côté pittoresque et authentique et multiplie les détails :
" (Chouchanik avait) reçu la meilleure dot constituée de trois tapis, deux coffres à linge , une parcelle de terre fertile, trois vaches, une truie reproductrice et vingt poules pondeuses, ainsi qu'un tas d'or si lourd qu'elle se serait littéralement cassé le dos si elle avait entrepris de le porter. Magtakhinai, quant à elle, reçu une dot deux fois moins importante, et des bijoux en argent plutôt qu'en or." (page 60)
L'éditeur nous parle de "récit universel" ; il est vrai que, lorsqu'on succombe aux clichés, rien ne ressemble plus à la campagne profonde que la campagne profonde. Dans ce livre, les gitanes sont voyantes (forcément!) et les campagnards n'ont pas oublié les croyances ancestrales et voient des choses que nous, citadins modernes, avons perdu de vue.
Si vous aimez les histoires de villages, de marché et de prophétie, vous trouverez ce livre dépaysant et exotique (la traductrice ponctue d'ailleurs habillement le texte de mots arméniens). Moi, sincèrement, ça me passe totalement à côté et je n'ai pu en finir la lecture.
Parution le 17 mai 2023
chez 10/18, Littérature étrangère
Traduction (russe) Ekaterina Cherezova
360 pages / 8,60€

Vers un avenir radieux, Nanni Moretti
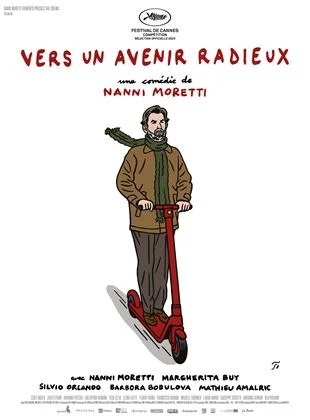
Nanni Moretti nous emmène dans son monde, un univers fait de petites manies qui virent parfois à l'obsession et de petits plaisirs consolateurs.
J'aime bien Nanni Moretti, son oeil vif, sa poésie, sa diction parfaite (il faut absolument voir ses films en version originale !). Ce réalisateur me fait rire, j'aime son humour décalé et empreint d'anxiété. Quand je bois un verre d'eau fraîche après un expresso, je pense toujours à la scène finale de Journal intime, un film de 1994 (quasi 30 ans, déjà !) auquel Vers un avenir radieux fait de multiples références. Nanni Moretti c'est mon enfance, mon Italie de rêve.
À l'annonce de son nouveau film, je me demandais : Est-ce que ce réalisateur vieillit bien? Ou est-ce qu'au contraire il tourne mal comme Woody Allen (autre idole comique de mon enfance, quand ma maman m'emmenait voir Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe)?
Dans Vers un avenir radieux, comme à son habitude, Nanni Moretti se met en abime en filmant un tournage et en digressant sur ses difficultés à réaliser un film. Ici, son personnage (lui-même, donc) s'est mis en tête de faire un grand film sur la grande époque du PCI (le Parti Communiste Italien qui, dans les années 50 regroupa jusqu'à 3 millions d'adhérents !). Mais c'est sans compter sur mille embuches qui se dressent sur son chemin : un producteur véreux (Mathieu Amalric), une épouse lassée, un gendre inattendu et surtout, surtout, une comédienne qui porte des mules. Des mules, rendez-vous compte, quelle horreur !
Pendant une heure et demie, Nanni Moretti nous amuse de son caractère ridiculement angoissé et intransigeant, mêlé à une capacité à apprécier les petits plaisirs de la vie (regarder des films en mangeant des glaces, chanter des chansons ou déambuler dans une ville qu'on aime - en l’occurrence Rome).
En plus de cette leçon de vie, Nanni Moretti nous donne une belle leçon de cinéma, rendant hommage à un cinéma à l'ancienne, avec de vrais décors. Il fustige la facilité qui consiste à se vautrer dans la violence gratuite et la pauvreté des récits proposés par les plateformes de diffusion (cf. la scène désopilante du rendez-vous chez Netflix).
Certes, j'aurais préféré que le film s'arrête dix minutes plus tôt ; sur cette magnifique scène tourbillonnante. Reste que j'ai pris beaucoup de plaisir à visionner ce film rafraichissant.
Mais je suis rassuré : la magie Moretti opère encore !
Il sol dell’avvenire
au cinéma le 28 juin 2023

Les larmes du Reich, François Médéline, 10/18
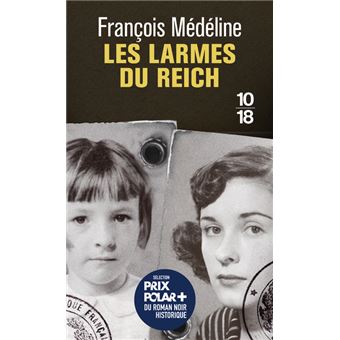
En 1951 dans la campagne française, un couple paisible est retrouvé assassiné tandis que leur fille a disparu. Un étrange inspecteur est dépêché de Lyon pour tenter de résoudre ce crime qui a un rapport avec la Seconde Guerre Mondiale.
François Médéline soigne son écriture et l'on sent qu'il aspire à être un écrivain littéraire. Il ne résiste pas au plaisir coupable de se livrer à des descriptions lyriques. C'est poétique, mais un rien ampoulé.
" La façade drague le midi pour cueillir le soleil de l'hiver. Elle est recouverte d'un ampélopsis pour se cacher de l'été. Par delà reprend la prairie, délimitée par des haies, une charmille de mûriers et puis, il le mettrait à quatre lieues, un massif anthracite dessinant, en son extrémité septentrionale, trois becs de calcaire. " (page 16)
Heureusement, on rentre vite dans son style, et dans le vif du sujet. Très rapidement, on pressent qu'avec son vélo et ses obsessions, le personnage principal, "l'inspecteur", est plus que limite. Et c'est ça qui est bien ! C'est cette étrangeté du flic, du héros, qui rend le livre si particulier et intéressant. Il prie avec bien trop de ferveur pour être catholique ! Le suspens monte efficacement et il vous faudra un peu de patience pour comprendre ce qu'il cherche à résoudre exactement dans cette affaire de double meurtre et de disparition, la clé n'étant donnée qu'à la fin du livre.
Ce roman qui se lit d'une traite est bien fichu et instructif, avec un regard légèrement décalé sur l'histoire de la dernière guerre mondiale. Un petit plaisir, même si le sujet est grave.
Paru en poche le 06 avril 2023
chez 10/18 Polar
192 pages / 7,50 €
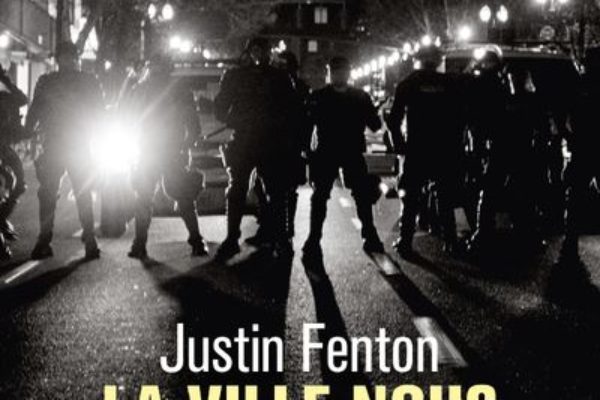
La ville nous appartient, Justin Fenton, 10/18
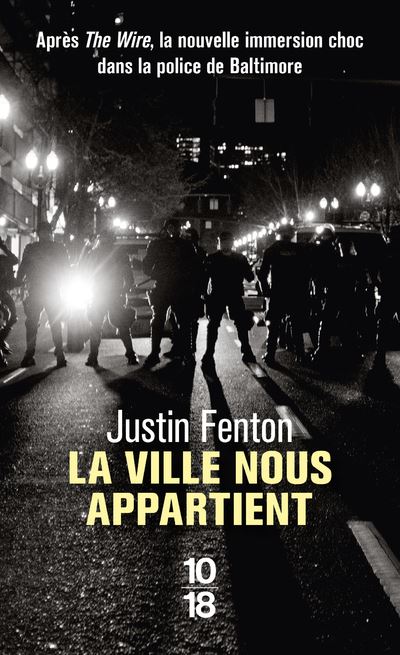
Voilà le prix à payer pour la politique du chiffre : des flics hors de contrôle dévissent et - fort de leur sentiment d'impunité - se comportent comme des malfrats.
Depuis son déclin industriel dans les années 1970, Baltimore n'en finit pas de sombrer et détient le titre de ville la plus violente des États-Unis d'Amérique. C'est dire le niveau de criminalité qui y règne ! Pendant des décennies, on y compte annuellement des centaines de mort par arme à feu.
Bien décidés à mettre fin à cette hécatombe, les politiques locaux décident de s'inspirer de New-York City et de sa tolérance zéro pour les criminels. Une équipe spécialisée dans la traque des armes à feu non déclarées est constituée : la Gun Trace Task Force. Peu importent les méthodes de ces enquêteurs en civil, tant qu'ils font du chiffre. Voilà le crédo. Ils bénéficient d'une confiance absolue de la part des politiques et des magistrats locaux, même si la majeure partie des interpellations ne tiennent pas devant un tribunal et ne débouchent pas sur des condamnations...
Parmi ces flics d'élite, on compte Wayne Jenkins, un ancien Marine qui - bien qu'ayant obtenu un maigre C aux tests psychologiques, est recruté au motif qu'il est poli, ordonné et pugnace ! Et plus il a la main lourde, plus il est apprécié et promu, jusqu'à ce qu'il soit autorisé à recruter lui-mêmes ses hommes.
Pendant des années, Jenkins et sa bande, "un supergang de ripoux" (page 236) vont semer la terreur parmi les dealers de drogue, les arrêtant sous de faux prétextes pour mieux leur voler leur drogue et leur argent. Or comment un délinquant pourrait-il se plaindre du comportement de la police ? Qui le prendrait au sérieux?
L'impunité des flics est telle qu'ils ne sont pas sanctionnés après que la police de Baltimore a été condamnée par leur faute à verser 700 000$ à un plaignant à qui ils avaient littéralement cassé la gueule au cours de son interpellation ! Quand 46 personnes reprochent à un flic d'être violent, c'est vu comme de la calomnie pure et simple (page 149). Quand un type tombe dans le coma après avoir été interpelé, et qu'il finit par mourir, les flics écrivent dans leur rapport son arrestation s'est "effectuée sans incident" (page 106).
Ce ne sont là que quelques exemples des comportements inadaptés et des bavures décrits par l'auteur sur 480 pages !
Jenkins est vu par ses collègues et supérieurs hiérarchiques comme un superflic. Pourtant, les chiffres auraient dû parler d'eux-mêmes : "le BPD effectuait près de 44% de ses arrestations dans deux petits districts, à prédominance afro-américaine, lesquels n'abritaient que 11% de la population de la ville. (...) Un noir d'une cinquantaine d'années avait ainsi été arrêté 33 fois en moins de quatre ans - sans qu'aucune de ces arrestations débouche sur un PV ou une inculpation." (page 267)
Les faits décrits par Justin Fenton - reporter chargé des affaires criminelles au Baltimore Sun - sont ahurissants. L'enquête est presque trop fouillée pour se lire comme un roman. D'ailleurs, on aurait préféré que cela soit de la fiction !
Paru le 16 mars 2023
chez 10/18
parution originelle chez Sonatine Éditions
480 pages / 9,20€
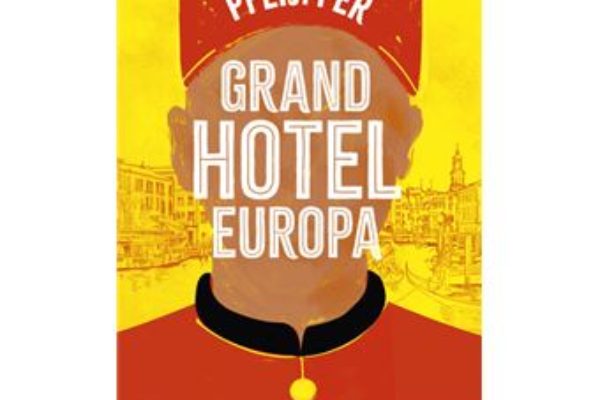
Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer, 10/18
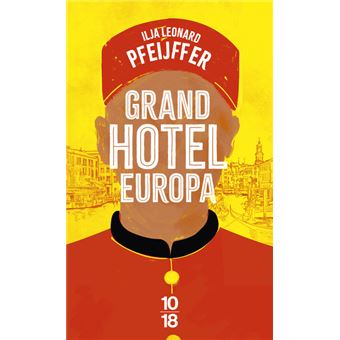
Quand j'étais petit, ma maman m'a appris à lire la première page d'un livre pour voir si cela valait la peine d'en continuer la lecture. Heureusement que je n'ai pas suivi ce conseil à la lettre !
Il m'a fallu aller un peu plus loin que la première page pour apprécier Grand Hotel Europa, le premier livre traduit en français de l'écrivain Ilja Leonard Pfeijffer - apparemment une célébrité aux Pays-Bas, son pays d'origine. Au départ, j'étais consterné par cette histoire d'écrivain d'âge mûr qui bande comme un adolescent pour sa nouvelle copine.
A coup de grandes phrases pompeuses, il nous raconte comment il tombe amoureux d'une intello italienne au "cul parfait". C'est tellement pathétique que ç'en devient drôle, au point que je ne résistais pas au plaisir d'en lire des passages à mes amis :
" - Je te trouve belle.
Je me rappelle très bien avoir dit ça. C'était la vérité, même si cela s'apparentait de plus en plus à une litote. Alors que j'avais d'abord été frappé par la petitesse de ses vêtements, la longueur des bas sous sa jupette, la hauteur de ses talons et son regard, juste celui qu'il fallait pour donner à l'élégance étudiée de son apparence un air de nonchalance, j'étais, en écoutant son argumentation, tombé sous le charme de ses yeux sombres qui étincelaient dans la nuit d'été, et de son enthousiasme, qui faisait danser son visage et ses gestes comme si un tango à l'attrait lancinant et irrépressiblement pulsant s'était embrasé dans le night-club de son âme, où rien d'autre n'était toléré qu'un total abandon." (page 55)
A ce stade de ma lecture, le livre me paraissait grandiloquent et barbant, à tel point que je me suis promis d'en arrêter la lecture à la page cent si la situation ne s'améliorait pas. Et puis assez soudainement, ma patience a été récompensée et je n'ai plus pu quitter ce bouquin jusqu'à la 696ème et dernière page. A croire que, lorsqu'il évoque la fougueuse Clio, l'écrivain en rajoute pour mieux montrer à quel point lui-même se trouve ridicule.
Ilja Leonard Pfeijffer est le protagoniste de son propre livre, il mêle son histoire personnelle (et même intime) avec une réflexion fine sur le tourisme de masse. Comme il habite à Venise, cela lui donne une vue imprenable sur ce phénomène.
L'auteur peaufine son personnage et c'est bien volontiers qu'il tient le rôle de l'écrivain intello, toujours impeccable dans ses costume-cravate-chemise à poignet mousquetaire. Mais Ilja Leonard Pfeijffer a aussi le sens du ridicule et n'hésite pas à se moquer de lui-même. Et lorsqu'il critique les touristes, il ne le fait pas en surplomb, il s'inscrit lui-même dans la description de cette plaie. Car si "le tourisme détruit ce par quoi il est attiré" (page 561), il n'y a pas de pire touriste que celui qui - comme lui et comme beaucoup d'entre-nous - n'assume pas d'en être un. Les touristes, ce sont toujours les autres !
La réflexion pertinente sur le tourisme conduit à une interrogation plus large sur le mode de vie européen et sur son devenir. J'ai pris tellement de notes en lisant ce livre que je ne pourrais pas tout restituer ici, tant les sujets abordés sont nombreux.
"Les touristes ne sont que des symptômes de quelque chose de plus grand et de plus grave, tout comme les gens à un enterrement ne sont qu'un symptôme de la mort. C'est cela que je veux explorer dans mon livre. Il doit traiter de l'Europe, de l'identité européenne empêtrée dans le passé, et du bradage de ce passé sur un marché globalisé faute d'autres options crédibles. Ce livre doit devenir une déclaration d'amour à l'Europe pour ce qu'elle fut jadis, et qui, pour ce qu'elle fut jadis, se fait en ce moment piétiner par l'ultime et irrémédiable invasion barbare. Ce sera un livre triste sur la fin d'une culture." (page 378)
Mais les barbares ne sont pas toujours ceux que l'on croit ! L'invasion touristique "vue comme une source de revenus et activement stimulée alors qu'elle représente en fait une menace constitue un parallèle intéressant avec la prétendue invasion africaine de l'Europe, présentée comme une menace alors quelle pourrait offrir des perspectives d'avenir" (page 288)
Nous sommes à ce point nos propres barbares que nous "en sommes venus à croire que notre passé est le noyau de notre identité" (page 316)
Roi de la mise en abyme et de l'ironie, Ilja Leonard Pfeijffer camoufle habillement un essai documenté en roman et s'amuse à jouer au parfait (gros) con. Le livre est tellement intéressant, tellement dense, que je pourrais multiplier les citations par dizaines.
C'est un livre érudit et tragi-comique qui se mérite un peu mais qu'on finit par dévorer avec avidité. Dire que j'ai failli passer complètement à côté de ce livre passionnant !
Paru le 16 mars 2023
chez 10/18 Littérature étrangère
696 pages / 10,70€
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine

Allez tous vous faire foutre, Aidan Truhen, 10/18
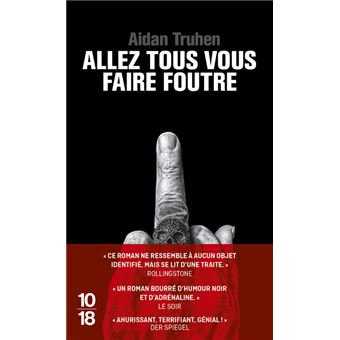
La vie bien réglée d'un dealer de cocaïne de haut vol part en sucette à partir du moment où sa voisine est assassinée. S'ensuit une spirale de violence délirante et drôle.
Jack Price est un riche trafiquant version 2.0 qui fournit les huiles en poudre blanche, sans même avoir besoin de toucher au produit. Aussi est-il surpris de trouver des flics dans son immeuble alors qu'il rentre chez lui. Fausse alerte, c'est juste Didi, sa vieille voisine acariâtre, qui a été assassinée.
"Je détestais Didi. Je détestais le fait qu'elle existe et qu'elle fasse flotter une odeur bizarre dans mon immeuble et qu'elle siffle - comme un cafard elle sifflait - après mes petites amies quand je les amenais pour admirer la vue et baiser sur le balcon et boire du whisky" (page 24)
"Je n'aime pas que Didi soit morte.
Ce n'est pas mon côté gentil ni un désir de rédemption, c'est du management." (page 25)
"Ça me turlupine. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pas genre besoin besoin. Juste besoin parce que sinon ça va continuer de me turlupiner et ce n'est pas une bonne chose. La concentration est importante. Didi est une putain de perte de productivité. Elle est semblable à Candy Crush mais avec un meurtre en plus." (page 39)
Alors qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé, le flegmatique Jack Price se trouve aux prises avec les Sept Démons, un groupe légendaires de tueurs sans pitié.
Le plus souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. On a des bribes d'informations qui partent dans tous les sens, jusqu'à ce que le protagoniste nous donne la clé de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la façon dont quelqu'un vient d'être liquidé. C'est une écriture façon puzzle !
L'écrivain Aidan Truhen multiplie les scènes ultraviolentes mais, étonnamment, on n'est jamais pris de nausée. C'est tellement outrancier que ça en devient comique. Les fans de Dead-Pool apprécieront ce bouquin dont je m'étonne qu'il n'ait pas encore été adapté au cinéma. On est juste dans le délire complet. Ce livre est méchamment drôle.
Paru le 3 octobre 2019
10/18 Domaine Policier
232 pages / 8,20€
Traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau

Zizanie dans le métro, Oulipo, Montansier Versailles

Hier dans le métro, le chien d’une demoiselle a fait pipi sur les chaussures d’un passager et, ce matin, ils se sont recroisées à la boucherie. Zizanie dans le métro est un hommage aux géniaux Exercices de style de Raymond Queneau. Le principe est simple : en jouant avec les mots et les styles, cette anecdote toute simple va être réinventée pendant une heure.
Le spectacle propose tout un tas de versions toutes plus drôles les unes que les autres de cette bête histoire : en rimes en « ul », en argot, à la façon interrogatoire de police, d’un journal intime, ou encore d’une histoire pour s’endormir. Il y a même la version rapée du chien, « un chien tout ce qu’il y a de normal ». DésOSpilant !
La version « histoire pour s 'endormir " racontée par un papa à sa petite fille amuse tout particulièrement les enfants (le spectacle est visible dès 7 ans). Je suis sûr qu’ils se reconnaissent ! Moi en tout cas, je me suis bien identifié à ce père qui tente difficilement de terminer son histoire et de garder son calme face à une enfant qui ne veut manifestement pas dormir.
Le spectacle joue agréablement sur les mots, sur les niveaux de langage mais ce n’est pas tout. Ce n’est pas qu’un spectacle intello (même si les références sont nombreuses). Il y a plein de gags visuels réjouissants, et la mise en scène drôle et rythmée est servie par des comédiens impeccables. Mention spéciale pour Gilles Nicolas qui, avec se tête et son look de parfait rond de cuir, prouve grâce à son œil qui pétille et son derrière qui remue que l’habit ne fait pas le moine.
Vu le 15 avril 2023 au Montansier Versailles
Durée 1h00 / dès 7 ans
conception, adaptation et mise en scène Jehanne Carillon et Christian Germain,
textes de l’Oulipo Paul Fournel, Jacques Jouet, Pablo Martín Sánchez, Olivier Salon et Christian Germain, chansons Jehanne Carillon, musique Arthur Lavandier,
dessins Etienne Lécroart,
lumières Jean-Yves Courcoux, création sonore Jehanne Carillon avec la complicité de Valérie Bajcsa
avec Jehanne Carillon, Gilles Nicolas et Alexandre Soulié
Production Cie l’amour au travail

Mon crime, François Ozon, Mandarin Cinéma

Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai confondu Dominik Moll et François Ozon, ce qui m’a conduit à voir Mon crime, le nanar de la semaine ! Heureusement qu’avec le Printemps du cinéma, la séance ne m’a couté que cinq euros…
L’argument en quelques mots : pour gagner en notoriété, une jeune avocate désœuvrée convainc sa comédienne ratée de copine de s’accuser du meurtre d’un producteur à la Harvey Wenstein. La stratégie est bonne : le procès aux Assises permet au deux comparses d’accéder à l’argent et à la célébrité.
La production disposait d’un budget conséquent (7,8M€ !) qu’elle a dépensé en bonne partie dans le cachet des comédiens (sans parler des 400 000€ gagnés par le réalisateur dans l’histoire…). Ils sont venus, ils sont tous là pour ce que les journalistes présentent comme la comédie française de l’année, qu’il estiment bien plus fine et drôle que l’Astérix de Guillaume Canet.
Il y a Dany Boon, André Dussolier, Daniel Prévost, Régis Laspalès, Fabrice Lucchini, Michel Fau… et ils ont même ressorti Franck de la Personne de son placard (situé à l’extrême droite du dressing). Inutile de dire qu’il y a aussi Isabelle Huppert car elle est de toutes les productions françaises et ne peut s’empêcher de mettre son immense (sic) talent au service de gros nanars (en témoigne sa pathétique prestation dans la Syndicaliste, pourtant là aussi saluée par la critique, allez comprendre).
Daniel Prévost donne l’impression de s’ennuyer ferme, tout comme moi d’ailleurs. Pour le reste, on dirait le concours de celui qui cabotinera le plus, concours remporté sur le fil par un Dany Boon à l'improbable accent de Marseille. C’est pire qu’une pièce de boulevard. (Le film est d’ailleurs tiré d’une pièce de théâtre des années 1930.)
Outre les comédiens, les moyens mis en œuvre sont impressionnants. Il y a de très beaux décors, des appartements Art Déco somptueux, des dizaines et des dizaines de figurants (en costume !) et des voitures d’époques en veux-tu en voilà.
Oui mais voilà, cette débauche de moyens ne suffit pas à faire un bon film, loin s’en faut. Il n’y a pas de rythme, aucun intérêt dans la manière dont est racontée l’histoire et les gags tombent à plat (même le running gag de la mort du producteur, dont on a une demi-douzaine de versions différentes). Certes, quelques spectateurs rient, mais tous semblent interloqués par cette fin qui reste en plan. Le film s’achève quand on pense qu’il va enfin commencer.
Et je ne vous parle pas du fond de l’histoire qui est assez écœurant en cette période de libération de la parole des femmes, ces femmes qui – à en croire Ozon – sont d’horribles manipulatrices utilisant à leur profit les travers des hommes.
Sortie le 08 mars 2023
Mandarin Cinéma
1h43

Apocalipsync, Luciano Rosso, Rond-Point

Apocalipsync nous fait passer de l’autre côté du miroir. Littéralement. Au début du spectacle, nous observons Luciano Rosso à travers son miroir (grossissant). Une journée commence. Une longue journée. Un jour sans fin. Un jour de confinement COVID.
Luciano Rosso (qui n’est pas, comme pourrait le faire croire son nom, italien mais argentin, vivant en France) a dû s’ennuyer pas mal pendant le confinement. Pour ne pas devenir fou, il a choisi de transformer en spectacle fou ce quotidien qui ne l’était pas moins. Sur une durée d’une heure, il nous fait revivre ses semaines de confinement, mais avec jubilation cette fois ! Tout y passe, des cours de gym qu’on n’arrive pas à suivre jusqu’à la communication officielle, sans oublier la glande devant la télé.
Le performer est un spécialiste du lipsync (la synchronisation labiale, ça ressemble à du playback, mais pas que sur du Mariah Carey !). Sur scène, c’est comme si tous les bruits prenaient possession de son corps (au sens diabolique du terme). Luciano Rosso incarne tous les sons parasites qu’il entend : le chien des voisins, les voisins eux-mêmes, les médias, tout un bestiaire désopilant etc. Coincé dans son appartement carcéral, Luciano Rosso est comme à un hyper-acousique qui deviendrait prisonnier de tous les sons parvenant à ses oreilles.
Ce spectacle atteint un niveau jamais vu au plan de l’expressivité presque brute et de la synchronisation avec la bande son. Mais Luciano Rosso n’est pas seulement un athlète des zygomatiques, il ajoute aux grimaces un engagement corporel complet. C’est l’ensemble de ses muscles qui sont mobilisés dans ce show qui fait parfois penser au Ministry of Silly Walk des Monthy Pythons. Il est d’ailleurs présenté comme acrobate et danseur, quand lui se définit tout simplement comme quelqu'un de curieux.
Tout repose sur le talent de l’artiste. Avec un rideau de douche géant et un siège gonflable pour tout décor, ce spectacle tient dans une valise ! D’ailleurs, il traversera bientôt les frontières car il est en cours d’adaptation en italien et en anglais.
J’imagine que la vocation de Luciano Rosso, qui est autodidacte, a démarré un peu comme un blague quand, alors qu’il n’était encore qu’un gamin espiègle, il faisait des grimaces devant sa glace ou jouait à faire du doublage décalé et sauvage sur les feuilletons. Sauf que chez lui, la grimace et l’expression du visage prennent une dimension dingue et sont élevées au rang d’art.
L’ambition de Luciano Rosso est de nous remonter le moral, ce qui n’est pas une mince ambition en ce moment. Il y parvient parfaitement. Il nous rend heureux pendant une heure. Jim Carrey peut bien aller se rhabiller !
Jusqu'au 02 avril 2023 à 18h30
Théâtre du Rond-Point, Paris 9ème
durée 1h00
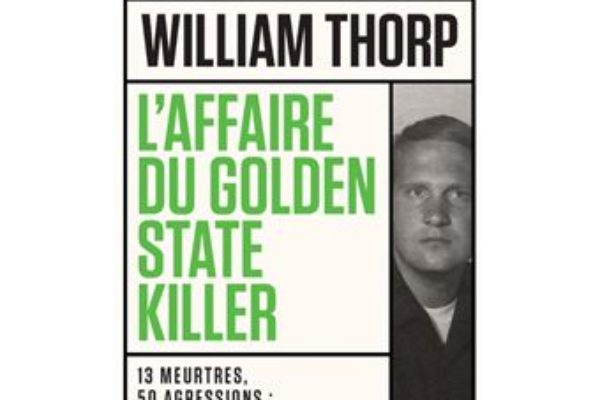
L’affaire du Golden State Killer, William Thorp, Society 10/18
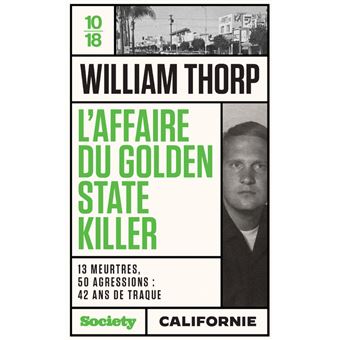
En créant la collection True Crime, les éditions 10/18 ont la bonne idée d'éditer au format Poche des enquêtes criminelles écrites par des journalistes du magazine Society, magazine dont la notoriété en matière de serial killer n'est plus à faire depuis la publication à l'été 2020 d'une série d'articles sur Xavier Dupont de Ligonnès.
Dans l'opus intitulé L'affaire du Golden State Killer, William Thorp s'intéresse à un effrayant violeur et tueur en série qui sévit en Californie pendant plus de 10 ans dans les années 1970-80.
Lorsqu'au cinéma, un film se revendique comme étant "basé sur une histoire vraie", on peut craindre le pire tant Hollywood prend de libertés avec les faits. Ici au contraire, William Thorp mène une enquête rigoureuse et précise sur L'affaire du Golden State Killer, l'histoire incroyable d'un violeur et tueur en série qui commence par battre des chiens à mort avant de monter crescendo dans la violence. Et lorsqu'un journal prétend qu'il ne s'en prend qu'à des femmes seules, il se met à attaquer des couples, comme pour montrer qu'il ne craint rien ni personne.
"Les témoignages des victimes ont permis de dresser un portrait-robot du violeur à la cagoule : il a la vingtaine, mesure un mètre quatre-vingts, affiche une corpulence moyenne. Signes distinctifs : des jambes aux mollets très musclés et velus, et un sexe de petite taille. (…) Son mode opératoire est identique depuis le début : il attaque ses victimes lorsqu'elles sont endormies, une cagoule sur le visage, et leur attache les mains. Il saccage la maison et se confectionne, après les viols, quelques plats en vidant les placards de la cuisine. Il descend aussi des bières, parfois" (page 37).
Cette enquête impeccable se lit comme un bon roman et vaut bien les meilleurs polars. Car, c'est bien connu, la réalité dépasse la fiction ! William Thorp nous raconte comment les flics suivent patiemment des dizaines de pistes et épluchent des milliers de documents. Une task force de quarante personnes est mise en place et des policiers endossent même le rôle d'un couple tranquille dans un pavillon de banlieue pour tenter d’appâter le malfaiteur. Oui mais voilà, même lorsqu'il bouclent un quartier complet, le tueur parvient à leur échapper. Il est insaisissable. Un vrai chat de gouttière.
Malgré ses efforts, la police faire chou-blanc pendant plus de quarante ans ! William Thorp manie le suspense avec dextérité et ne nous livre l'identité du tueur qu'après nous avoir fait tourner bourrique pendant cent pages. L'auteur réalise une enquête minutieuse sur le travail des enquêteurs et restitue avec maestria leur acharnement (leur dévotion !) à mettre hors d'état de nuire un fou qui leur échappe de façon injuste et désespérante, jusqu'à l'obsession.
Pour ceux que l'histoire aura passionné, 10/18 propose à la fin du livre un lien vers des podcasts et du contenu numérique, notamment une vidéo impressionnante du tueur après son arrestation.
Parution le 3 mars 2023
10/18 True Crime Society
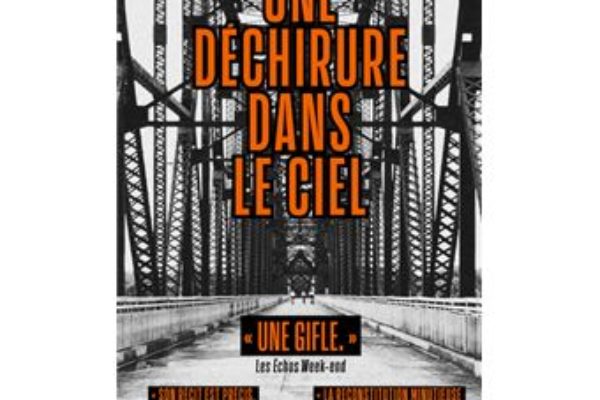
Une déchirure dans le ciel, Jeanine Cummins, 10/18
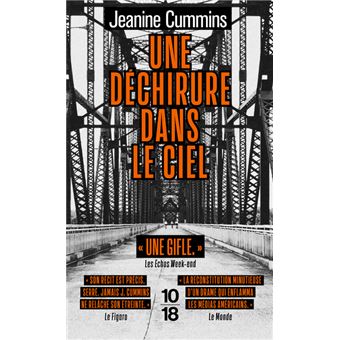
Jeanine Cummins, l'autrice de l'impeccable American Dirt, écrit le récit d'un drame qui a frappé sa famille en 1991. Voilà qui promet un bon moment de lecture !
La famille de Jeanine Cummins a été frappée de plein fouet par l'horreur, à la fin des vacances d'été 1991, quand ses deux cousines, Julie et Robin, furent violés par quatre jeunes inconnus avant d'être balancées du haut d'un pont, avec leur cousin Tom (le frère de Jeanine), dans les eaux tumultueuses du Mississippi.
"Je les ai balancés sans mollir", annonça joyeusement Richardson, quêtant du regard un geste de félicitations de la part de Gray. Celui-ci hocha la tête en souriant, puis lui donna une tape dans le dos comme s'il venait d'accomplir une sorte de rite de passage" (page 94)
J'avais été impressionné par American Dirt qui décrivait avec acuité et sensibilité le sort des migrants mexicains (bien que l'autrice ne soit pas elle-même latino, ce qui valut à l'époque de faire l'objet d'une pathétique polémique sur le thème de l'appropriation culturelle, mais passons...). Peut-être attendais-je donc trop de ce nouveau récit ?
En tout cas je n'ai pas été convaincu. Certes, l'histoire est bouleversante et les faits relatés sont insoutenables. Mais littérairement parlant, le compte n'y est pas. Jeanine Cummins se lance dans des descriptions minutieuses mais laborieuses. Ainsi, page 120 : "Elle tira sur la cordelette pendue au mur pour allumer l'ampoule électrique au dessus du reflet de son visage malheureux dans le miroir propre. Cette pièce était si grande que Tink pensait qu'il devait s'agir d'une ancienne chambre d'amis transformée en salle de bains, et que, dans une vie antérieure, la douche avait été un dressing."
Et page 129: "Ghrist et Tom empruntèrent côte à côte le long couloir en linoléum, et l'un d'entre eux appuya sur le bouton 4 du vieil ascenseur déglingué." Tant qu'elle y est, pourquoi Jeanine Cummins ne nous précise pas qui des deux a appelé l'ascenseur ? Et pourquoi ne pas en préciser la marque ?! Thyssen-Krupp ? Koné ? Otis, peut-être ?
Je m'interroge aussi sur la traduction. Est-il pertinent de traduire "I am drowning" par "Je suis en train de me noyer" (page 87) ? N'aurait-il pas été plus simple, et plus efficace, de dire tout simplement "Je me noie !" ?
A mon goût, Jeanine Cummins donne trop de détails inutiles, sans doute pour apporter de la crédibilité à son récit. Elle prétend se tenir à distance en parlant d'elle-même à la troisième personne et en se désignant par son surnom, Tink. Mais dans le même temps, elle désigne les autres protagonistes par des sobriquets familiers ("Tante Ginna", "Grand-père Art" etc). De la même manière, elle se livre à une description très américaine (c'est-à-dire aussi lyrique que mièvre...) de ses deux cousines, tout en reprochant aux médias de les présenter sous leur meilleur jour. On a en définitive l'impression que l'autrice ne sait pas si elle doit parler d'abord en tant que cousine et sœur des victimes, ou comme une narratrice objective.
On conçoit bien que les sentiments de l'autrice envers les victimes, sa proximité avec elles, puisse perturber le processus d'écriture. C'est dommage car, avec ces quatre jeunes types qui franchisent brutalement la frontière du crime, cette histoire recelait un potentiel narratif explosif !
Paru le 02 février 2023
chez 10/18
Éditions Philippe Rey
Traduit de l'anglais (américain) par Christine Auché
408 pages / 8,90 €

Heï Maï Li et ses ciseaux d’argent, Cie du Chameau, Funambule Montmartre

Un conte chinois tout en ombres et en papier, avec Sophie Piégelin et Béatrice Vincent.
Les spectacles pour enfants jouent souvent sur le côté vitaminé, comme s'il fallait pour intéresser les petits dynamiser l'action jusqu'à l'outrance. Ce n'est pas le cas du spectacle Haï Maï Li ! Ici, pas d'acteurs qui dansent chantent ou font des vannes ; tout est calme et paisible.
Un drap blanc en arc de cercle où sont projetées des ombres chinoises, une narratrice avec un carillon et un petit gong, il n'en faut pas plus pour transporter les enfants dans une lointaine province chinoise. C'est tout simple et assez poétique.

Une narratrice installée en front de scène nous raconte l'histoire de Haï Maï Li. Avec ses ciseaux d'argent et du papier, on raconte que cette jeune chinoise sait tout faire. La rumeur enfle jusqu'à parvenir aux oreilles de l'empereur, "cupide et cruel", qui lui ordonne de lui fabriquer des diamants.
Sur l'écran apparaissent des figures de papier dont certaines sont découpées en direct. Petit-à-petit apparaissent ainsi des formes que les enfants ont plaisir à reconnaître: "un escargot !", "un papillon!", "un nuage !", "un mouton !".
Ce spectacle, court et calme, conviendra aux tout-petits et pourrait même presque les endormir, si les représentations n'avaient pas lieu à 10h30 du matin !
Jusqu'au 19 mars 2023
les mercredis à 16h et les samedis et dimanches à 11h jusqu’au 19 février. A partir du 21 février, du mardi au vendredi à 10h30 et les samedis et dimanches à 11h.
Au Funambule Montmartre, Paris XVIIIème
Jeune public, de 3 à 6 ans (Durée 35 minutes)

Il n’y a pas de Ajar, Delphine Horvilleur, Johanna Nizard

Je suis allé au théâtre des centaines de fois mais j'ai rarement vu ça, pour ne pas dire jamais. Une performance d'actrice époustouflante au service d'un texte (exigeant mais aussi très drôle !) sur l'identité et la religion.
Romain Gary, que "personne n'est foutu de mettre dans une case", était un homme complexe aux multiples vies. Lituanien compagnon de la Libération, juif goyophile, écrivain diplomate, réalisateur de cinéma au physique d'acteur hollywoodien…. Ce type inclassable - qui n'aimait rien tant que brouiller les pistes - avait inventé de toutes pièces l'écrivain Émile Ajar. Une mystification qui lui permit de gagner en liberté, de semer les critiques littéraires et de remporter un deuxième Prix Goncourt.
En se donnant la mort en 1980, Romain Gary "s'est fait un suicide collectif à lui tout seul !" puisqu'en mourant, il a aussi tué son double. Oui, mais voici que Delphine Horvilleur lui invente un fils, Abraham Ajar. C'est lui que nous retrouvons dans "une cave toute noire qui sent le livre moisi", son "trou juif" depuis lequel il nous explique à quel point son père était réel.
Dans Il n'y a pas de Ajar (texte ici mis en scène et interprété par Johanna Nizard), Delphine Horvilleur réfléchit sur la religion et sur ce que c'est qu'être soi. Il faut dire que Gary/Ajar, l'homme aux mille vies, est idéal pour questionner la notion d'identité, au point que Delphine Horvilleur en ferait presque un dieu !
"L'identité (...) qui vous empêche définitivement d'être autre chose que vous-même!" | "L'identité qui te rend con, muet, antisémite, et parfois les trois à la fois !" | "L'identité aujourd'hui restreinte, quand "chacun n'est plus qu'un seul truc : catho, gay, végan !"
Seule en scène pendant une heure et demie, Johanna Nizard change à plusieurs reprises de personnage, extirpant maquillage et accessoires de la grande bâche noire (genre sac poubelle industriel) qui recouvre le sol de la scène. Ces changements à vue assez fascinants à regarder renforcent le propos du texte sur la multiplicité des identités, sur la difficulté à savoir qui l'on est et qui l'on a en face de soi. Ce texte diablement érudit, hilarant, irrévérencieux et provocateur questionne avec humour l'absence de Dieu pendant la Shoah, ce qui est d'autant plus culotté qu'il a été écrit par une rabbine.
En regardant la comédienne Johanna Nizard, je me disais que cela doit être génial pour un auteur de voir son texte interprété avec une force aussi peu commune. Ce n'est même pas que Johanna Nizard joue bien, c'est autre chose encore. Par son engagement total, elle incarne le texte, elle lui donne vie. Par sa mise en scène et son interprétation exceptionnelle, la comédienne transforme la réflexion philosophique et théologique en une véritable folie théâtrale. Or cela résonne parfaitement avec l'histoire de ce personnage aussi vivant que fictif. C'est de la réalité littéraire augmentée !
Les 3 & 4 février 2023
Théâtre Montansier Versailles (coproduction)
texte de Delphine Horvilleur, mise en scène Johanna Nizard et Arnaud Aldigé
avec Johanna Nizard
son Xavier Jacquot, lumières et scénographie François Menou, maquillage Cécile Kretschmar, costumes Marie-Frédérique Fillion, conseiller dramaturgique Stéphane Habib, collaborateur artistique Frédéric Arp, regard extérieur Audrey Bonnet
texte édité chez Grasset
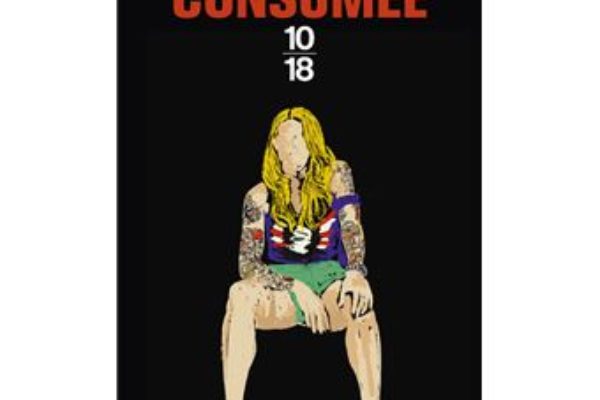
Consumée, Antonia Crane, 10/18
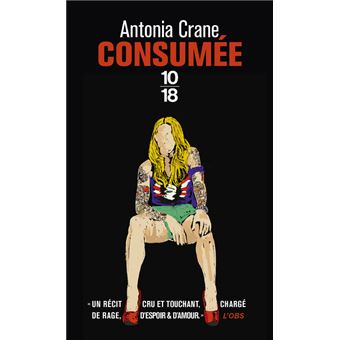
Ce livre aurait pu s'appeler Mémoires d'une strip-teaseuse.
Antonia Crane est droguée dans l'âme ; la dépendance est son moteur et la conduit tour à tour à la boulimie, aux stupéfiants, au sexe (personnes prudes d'abstenir, ce récit autobiographique comporte quelques scènes assez crues !).
Un beau jour, elle se déshabille sur la scène d'un club. Sa vocation de stripteaseuse est née ! Un métier qui lui apporte sa dose quotidienne d'adrénaline, d'argent et désir dans les yeux des hommes.
"Dans quelles autres circonstances pourrais-je me faire cinq ou six cents dollars un vendredi soir, ailleurs qu'ici? Où des inconnus me diraient que j'étais intelligente et merveilleuse, ailleurs qu'ici ? Comment pourrais-je ne pas pratiquer le striptease?" (page 270)
Antonia Crane revendique son métier dont elle parle avec talent sans faire l'impasse sur le côté glauque de l'affaire. Car il s'agit d'argent rapide mais certainement pas facile ! Le travail est dur, moralement et physiquement (elle souffre régulièrement du "coaltar de la stripteaseuse" et se retrouve percluse de douleurs à force de se cambrer sur scène (page 265).
Être stripteaseuse, ce n'est pas rose tous les jours. Mais que faire d'autre ? "Quand on cherchait du boulot, stripteaseuse n'était pas une expérience à mettre en tête d'un CV" (page 130)
L'autrice défend avec fougue la condition des travailleurs du sexe, elle décrit sans fard la dureté de ces métiers précaires et dangereux où il faut se méfier des clients, mais aussi des employeurs et de la loi qui est contre vous. La vie d'Antonia Crane est un combat sans cesse renouvelé, contre la dépendance, la dèche économique, pour finir ses études, pour faire valoir ses droits (elle participe à la création du premier syndicat des effeuilleuses, "l'Union des danseuses exotiques").
Mais, même si se mettre nue devant les choses l'interpelle en tant que féministe, elle est de toutes façons accro !
" J'ai dû reprendre le striptease. Chaque fois que je croyais avoir décroché, je finissais inéluctablement par replonger. C’était la cinquième fois. Lorsqu'elles ont le cœur en miettes ou qu'elles souffrent, les filles que je connais se bourrent de sucreries et de cocaïne, ou noient leur chagrin dans le shopping. Moi je retournais dans les stripclubs, les casinos, les hôtels, et j'offrais mon corps à des inconnus contre de l'argent" (page 15)
Au plan strictement strictement littéraire, j'ai préféré La Maison (livre dans lequel Emma Becker raconte son expérience de prostituée dans un bordel en Allemagne) ; Consumée est néanmoins un récit bien mené et décoiffant, qui mérite d'être découvert.
Parution le 02 février 2023
chez 10/18 Littérature étrangère
312 pages, 8,60€
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Michael Belano

Les Fourberies de Scapin, Molière, Porras, Montansier Versailles

Encore une pièce de Molière au Théâtre Montansier ?! Si les scolaires s'attendent à une séance ennuyeuse, ils vont être déçus... en bien, comme disent les suisses !
L'histoire en quelques mots : profitant de l'absence de leurs parents respectifs, Léandre et Octave se sont engagés auprès de deux filles inconnues et désargentées. Afin d'entourlouper leurs parents et leur arracher consentement et argent, les deux compères font appel à Scapin, un valet talentueux aux allures de Maître Renard qui excelle dans la roublardise et les fourberies.
Le décor de bistrot-guinguette et les costumes aux couleurs criardes sont outrageusement kitsch, ce qui leur confère un aspect à la fois laid et merveilleux, un peu comme un manège de fête foraine. On est ici hors du temps, et l'on comprend vite que tout sera hyperbolique, la scénographie comme le jeu des comédiens.
Autant vous le dire tout de suite, il m'a fallu quarante-cinq bonnes minutes avant rentrer dans ce spectacle dont je ne voyais au départ que les défauts. Les comédiens du premier acte ne m'ont pas convaincus. Leur talent n'est pas en cause ; simplement, la rencontre n'a pas eu lieu. Ils ne m'ont pas plu. Je n'ai pas aimé le jeu de Pascal Hunkiker (Octave), avec sa diction appliquée et son air de garçons sage. Le comédien qui incarne Sylvestre (Omar Porras?), lui, en fait des caisses dans la grimace tandis que son accent espagnol à couper au couteau le rend difficilement compréhensible. Ma fille de neuf ans n'a pas non plus aimé ce premier acte auquel elle n'a pas tout compris. Quant à Laurent Natrella (ex Sociétaire de la Comédie Française), il cabotine un peu trop à mon goût et donne l'impression de trop se regarder.
Heureusement, les choses s'améliorent nettement avec l'arrivée de Karl Eberhard, dans le rôle de Léandre ; il a un véritable talent comique et donne de sa personne ("Papa, c'est un cascadeur le comédien !" me souffle ma fille). Quant à Olivia Dalric, qui incarne Géronde, la mère de Léandre (hé oui, le rôle de Géronte a été féminisé), elle se fait visiblement plaisir dans ce rôle de rombière acariâtre et pingre.
L'engagement physique de la comédienne Peggy Dias m'a époustouflé (les longues minutes qu'elle passe à faire du jumping jack devant un jukebox en témoignent !). Tout comme Karl Eberhard, on la sent totalement prise dans le délire de la pièce. Elle incarne un Argante sémillant digne d'Agecanonix. Et même lorsqu'elle joue les servantes de bar, elle attire notre regard vers l'arrière plan comme un aimant.
La pièce - écrite dans l'urgence par Molière - est d'une bouffonnerie assumée et se termine sur un Happy end improbable et assez ridicule. Omar Porras, le metteur en scène, tire le trait encore un peu plus loin dans un final digne d'un carnaval.
D'une façon générale, Omar Porras utilise tous les (vieux) trucs pour interagir avec un public qui en redemande. Les références sont nombreuses : Commedia dell'Arte (prothèses nasales et dentiers), cirque (Monsieur Loyale et clowneries...), théâtre de boulevard (portes qui claquent), carnaval (serpentins et cotillons), comédie musicale, stand-up etc.
Bien sûr, les ronchons comme moi trouveront que la mise en scène est un peu too much et qu'on en voit trop les ficelles. Je mets cependant au crédit d'Omar Porras de proposer un Molière qui n'est ni ampoulé ni confit dans les conventions bourgeoises. Ici, tout est permis, et plus c'est outrageux mieux c'est ! Omar Porras s'autorise même à ajouter des chansons au texte originel. Ma fille a beaucoup apprécié ces moments de comédie musicale, que je n'ai pour ma part pas du tout trouvés à mon goût. Comme quoi tout est relatif.
Ce qui est sûr, c’est que cette pièce vitaminée, pétaradante et joyeuse enchante le public. La salle était aussi euphorique que comble, et c'est mérité !
Jusqu'au 28 janvier 2023
Théâtre Montansier Versailles
Tout public à partir de 10 ans - Durée 2h15
d’après Molière, mise en scène Omar Porras assisté de Marie Robert
adaptation et dramaturgie Omar Porras et Marco Sabbatini, collaboration artistique Alexandre Ethève, scénographie et masques Fredy Porras, musique Erick Bongcam et Omar Porras
avec la collaboration de Christophe Fossemalle, lumières Omar Porras et Matthias Roche, costumes Bruno Fatalot (d’après les costumes de Coralie Sanvoisin), postiches, perruques, maquillages Véronique Soulier-Nguyen, accessoires Laurent Boulanger
avec Olivia Dalric, Peggy Dias, Karl Eberhard, Omar Porras, Caroline Fouilhoux, Pascal Hunziker, Laurent Natrella, Marie-Evane Schallenberger

Le Voyage de Gulliver, Jonathan Swift, Valérie Lesort, Christian Hecq, Montansier Versailles

Valérie Lesort a eu la bonne idée d'adapter pour le théâtre Le voyage de Gulliver, une histoire fantastique - celle d'un médecin de Marine dont le navire s'échoue et qui découvre un monde où il est un géant et un autre où il est minuscule - une histoire dont on s'étonne qu'elle n'inspire pas davantage les dramaturges et les cinéastes.
Par la magie des marionnettes, les metteurs en scène Christian Hecq et Valérie Lesort nous transportent dans le monde des Lilliputiens, des êtres aussi teigneux, prétentieux et ridicules qu'ils sont petits. D'abord méfiants à l'égard de cet homme gigantesque, ce monstre, qui s'échoue sur leurs côtes, nos petits amis vont vite s'allier à Gulliver. Il faut dire qu'il représente un avantage de taille dans la guerre impitoyable qu'ils mènent contre le royaume de Blefuscu (dont les habitants ont l'outrecuidance de manger leurs œufs du mauvais côté).
Dans cette pièce, tout est mobile et plein de surprises. Les décors et les marionnettes (où les comédiens passent la tête) nous emportent dans cette aventure extraordinaire. Les lumières, signées Pascal Laajili, sont impeccables ; les clair-obscurs sont magnifiques, avec ce fond noir qui dissimule les marionnettistes et met en valeur les costumes aux couleurs chatoyantes (créés par Vanessa Sannino).
Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce spectacle. Des trappes, des arrêts sur image, des cabrioles... J'ai beaucoup aimé la bataille navale, aussi comique que poétique, au cours de laquelle Gulliver détruit l'armada ennemie. J'ai aussi aimé la chaloupe sur la mer. Le tout sur fond noir, sans décor. C'est simple et beau.
Le spectacle est très amusant ; les rires des enfants comme ceux des adultes fusent ! J'ai juste une petite réserve sur les morceaux de musique, pas toujours réussis. C'est surtout le cas de la deuxième chanson de la Reine ; deux à la suite, c'est un peu trop.
C'est, pour conclure, un spectacle beau et drôle qui mérite d'être vu par les grands et les petits, à partir de 7 ans. Après le magnifique Pinocchio proposé le mois dernier (en décembre 2022), le théâtre Montansier de Versailles confirme la qualité de sa programmation en matière de spectacle tout public.
Jusqu'au 22 janvier 2023
Théâtre Montansier Versailles
Tout public à partir de 7 ans
Libre adaptation du roman de Jonathan Swift Valérie Lesort
Mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort assistés de Florimond Plantier
Marionnettes Carole Allemand et Fabienne Touzi dit Terzi, scénographie Audrey Vuong, costumes Vanessa Sannino, lumières Pascal Laajili, musique Mich Ochowiak et Dominique Bataille, accessoires Sophie Coeffic et Juliette Nozières collaboration artistique Sami Adjali, création maquillage Hugo Bardin
Avec David Alexis, Emmanuelle Bougerol, Renan Carteau, Laurent Montel, Caroline Mounier, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin
production C.I.C.T/ Théâtre des Bouffes du Nord, Cie Point Fixe

Nos vies en flammes, David Joy, 10/18
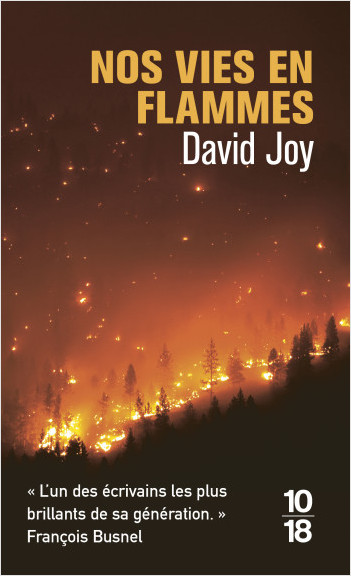
Est-ce à cause du titre ? (Nos vies en flammes.) Est-ce à cause de l'illustration sur la couverture ? (Des arbres en feu.) Est-ce parce que je venais de terminer Il pleuvait des oiseaux, de Jocelyne Saucier? (Un livre dans lequel où l'autrice évoque les grands incendies dans l'Ontario au début du XXème siècle.)
Toujours est-il que je m'attendais à une épopée sur fond de grands incendies aux États-Unis, et que j'ai été un peu déçu de constater que Nos vies en flammes (n') était (qu')un polar, même si le livre comporte d'intéressants passages sur la dépendance à la drogue, sur la mécanique biaisée des junkies, sur la spirale qui conduit un pauvre bougre des antidouleurs aux drogues illégales.
Comme pour montrer qu'il sait de quoi il parle et insister sur la véracité de son roman, David Joy prend à plusieurs reprises ses distances avec la fiction : "Ce n'est pas comme au cinéma, Denny" (page 267), "De fait, les choses se déroulaient rarement comme dans les films." (page 293). Mais ces passages qui sonnent juste n'empêche malheureusement pas l'auteur de recourir à des personnages assez stéréotypés (le méchant trafiquant sans scrupules ni empathie, le papy vengeur...), ni de bâtir un scénario assez artificiel.
David Joy aime les aphorismes. "Une vie n'est rien que la somme de ses hiers." (page 79) ; "Parfois, quand tout le monde pointait du doigt dans la même direction, la chose la plus intelligente à faire était de regarder." (page149) ; "C'était étrange comme dans ce monde tout partait parfois en couilles, alors qu'à d'autres moments les étoiles s'alignaient comme si vous étiez né avec un fer à cheval dans le cul." (page 190) ; "Des empires étaient bâtis et détruits par l'arrogance. L'amour propre suffisait à rendre les hommes aveugles" (page 293) ; "Les dilemmes moraux n'avaient jamais aucune chance face à un shoot." (page 101)
Comme d'autres auteurs américains (Pete Fromm, par exemple) David Joy revendique un lien fort, viscéral, avec son environnement, ses montagnes, son patelin. Mais c'est, comment dire, une relation un peu brute aux choses, comme si tout relevait du rapport de force. David Joy s'en explique d'ailleurs de façon très intéressante dans l'article qui sert de postface au livre : "Aujourd'hui, je gagne ma vie en tant que romancier. J'écris des histoires pleines de drogue, de violence, de pauvreté, enracinées dans l'atmosphère qui va avec. Et si je parle de ça, c'est parce que je ne connais rien d'autre." Certes. Mais d'aucunes parlent de sujets violents d'une autre façon (Jeanine Cummins dans American Dirt, par exemple).
J'ai une amie très chère et féministe qui ne lit plus que des romans écrits par des femmes, car elle affirme avoir lu assez de livres commis par des hommes. Je ne me rendrai pas à cette extrémité mais, à la lecture de David Joy, je comprends assez bien la position de mon amie. Car il s'agit ici d'un livre de mec, de bonhomme, où les femmes ne jouent aucun rôle. Il y a deux personnages féminins, l'une qui se contente de sa petite vie sans histoires et l'autre, fliquette, à qui l'on fait ce drôle de compliment: "je crois pas que t'aies besoin d'un homme pour quoi que ce soit" (page 137). Il est également assez troublant de voir qu'à la fin du livre, l'auteur remercie son chien avant sa femme…
Si vous êtes un mec, un vrai, ce livre est pour vous.
Parution le 19 janvier 2023
chez 10/18 Collection Littérature étrangère
336 pages / 8,50€
Fabrice Pointeau (traduit par)

Pinocchio, Thomas Bellorini, Montansier
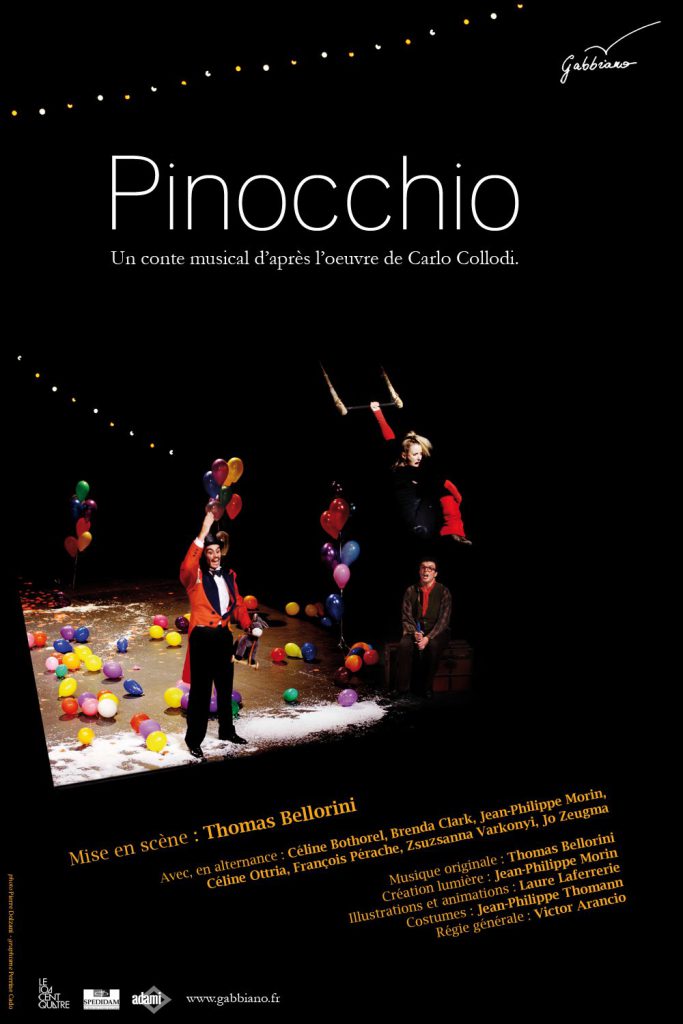
Ici, on est au théâtre. On va faire marcher son imaginaire à fond ! Le Pinocchio proposé par Thomas Bellorini est une petite merveille à ne louper sous aucun prétexte.
Des tourets de câbles et des barils métalliques pour l'ambiance industrielle. Une échelle de corde et un trapèze qui descendent du ciel pour l'inspiration circassienne. Le décor est minimaliste mais le metteur en scène, Thomas Bellorini, n'a pas besoin de plus pour nous emporter dans une aventure extraordinaire. Du cordage et quelques bulles de savon suffisent à nous faire entrer dans le ventre de la baleine.
L'entrée en matière est musicale : une guitare basse, un piano et un accordéon. C'est doux. C'est beau. Puis, "Il y avait une fois..." arrive le conteur. Car ce Pinocchio est un conte, avec un narrateur qui ne quitte jamais la scène (quelle performance d'acteur!), qui donne voix à quasiment tous les personnages, y compris parfois Pinocchio qui-même. Cette histoire magnifique qui semble a priori prôner les vertus de l'obéissance pour les enfants mais qui, en filigrane, leur dit qu'il faut faire sa propre expérience pour devenir un Homme. Un conte qui, surtout, parle de l'amour incommensurable d'un père pour son fils.
Le traitement de l'histoire, la qualité de la scénographie, de la mise en scène, de l'interprétation m'ont ému presque aux larmes tellement le charme opère. C'est tellement émouvant quand Pinocchio fait ses premiers pas, pantin chancelant dont l'équilibre ne tient qu'à un fil (au sens propre, car Pinocchio est incarné par une trapéziste qui épatera même les plus blasés !)
" J'ai adoré la trapéziste !" (Norma, 9 ans)
"D'habitude, j'aime pas le théâtre, mais là c'était vraiment bien" m'a confié Abel (9 ans), en sortant de la représentation.
Les enfants sont emportés par le spectacle. Ils sont émerveillés par la neige qui surgit sur scène ; "C'est de la vraie ?" demande une petite fille à sa maman. Ils veulent tous renvoyer les ballons qui sont lancés dans la salle. Les gags fonctionnent, les rires fusent à l'unisson. C'est un très beau moment de vie et de théâtre. C'est magique.
Spectacle vu le 17 décembre 2022 au Théâtre Montansier Versailles
A partir de 5 ans
d’après le conte de Carlo Collodi
adaptation, musique et mise en scène Thomas Bellorini, Compagnie Gabbiano
lumières Jean-Philippe Morin, costumes Jean-Philippe Thomann, illustrations & animations Laure Laferrerie
avec François Pérache, Adrien Noblet ou Samy Azzabi, Zsuzsanna Varkonyi, Brenda Clark, Céline Ottria, Jo Zeugma ou Edouard Demanche
production Compagnie Gabbiano

Walter Richard Sickert, Peindre et transgresser, Petit Palais

Tour à tour suiveur et précurseur, Walter Richard Sickert (1860-1942) ne se laisse pas facilement résumer ! Le Petit Palais nous donne l'occasion de découvrir ce peintre étonnant jusqu'au 29 janvier 2023. Foncez-y !
Dans cette exposition, les œuvres sont présentées dans un ordre chronologique, tout simplement. La scénographie - signée Cécile Degos - est très soignée et belle. Les salles sont assez grandes pour qu'on puisse regarder les œuvres sans se bousculer, et les couleurs des murs créent une ambiance cosy très agréable. Je regrette juste que de la musique soit diffusée dans la salle consacrée à la période music-hall ; de mon point de vue, cela n'apporte rien et, au contraire, "pollue" la concentration.
Sickert tire parfois le diable par la queue financièrement, surtout lorsque sa femme - qui l'entretenait - décide de le quitter après avoir découvert son énième infidélité. Il se lance alors dans une peinture qu'il souhaite rémunératrice, se mettant dans la roue de Monet, Pissaro ou de Bonnard. Pour tenter de séduire une clientèle aisée, il se fait portraitiste et peint des lieux de villégiatures bourgeois. Les vues de Venise ou de Dieppe sont belles, certaines saisissantes d'intensité et de contraste dans les couleurs.
Cette période qu'on peut juger aujourd'hui relativement conventionnelle n'est pas du tout dénuée d'intérêt. Par exemple, quelle beauté et quelle force dans la toile "Rehearsal, The End of the Act. The Acting Manager." !

Après cette période d'apprentissage où il s'inspire notamment des impressionnistes, Docteur Jekyll-Sickert laisse place à Mister Sickert-Hyde, un homme fasciné par le théâtre, le cirque et les bas-fonds. Le peintre se fait avant-gardiste. Il signe une étonnante série sur les prostituées restituant la chair crument, sans recourir au prétexte des sujets mythologiques ni verser dans l'érotisme. Ces peintures inspireront Lucian Freud, l'un des plus grands peintres figuratifs du XXème siècle, excusez du peu.

Grinçant, Sickert peint aussi des scènes de la vie populaire et quotidienne, restituant sans filtre l'ennui conjugal. Ancien comédien, Sickert s'intéresse au théâtre et au music-hall. Par la singularité de ses sujets et de leur traitement, Sickert est résolument anticonformiste et moderne ; il est donc bien plus qu'un peintre de station balnéaire !
Enfin, dans la dernière partie de sa vie, dans sa période "Transposition", le peintre trouve "le meilleur moyen du monde de faire un tableau" en développant le procédé de la lanterne de projection. Concrètement, il projette des images d'actualité sur un toile et les peint. Il est alors précurseur d'Andy Warhol et préfigure carrément le Pop-art.
De l'impressionnisme au pop-art, on comprend en suivant les influences de Richard Sickert (qu'elles soient subies ou exercées) à quel point ce peintre était ancré dans le XXème siècle. Une belle découverte.

Jusqu'au 29 janvier 2023
Petit Palais, Paris VIII
Plein tarif : 15 euros
Tarif réduit : 13 euros
Gratuit : - 18 ans

Ernest et Célestine, voyage en Charabie, StudioCanal
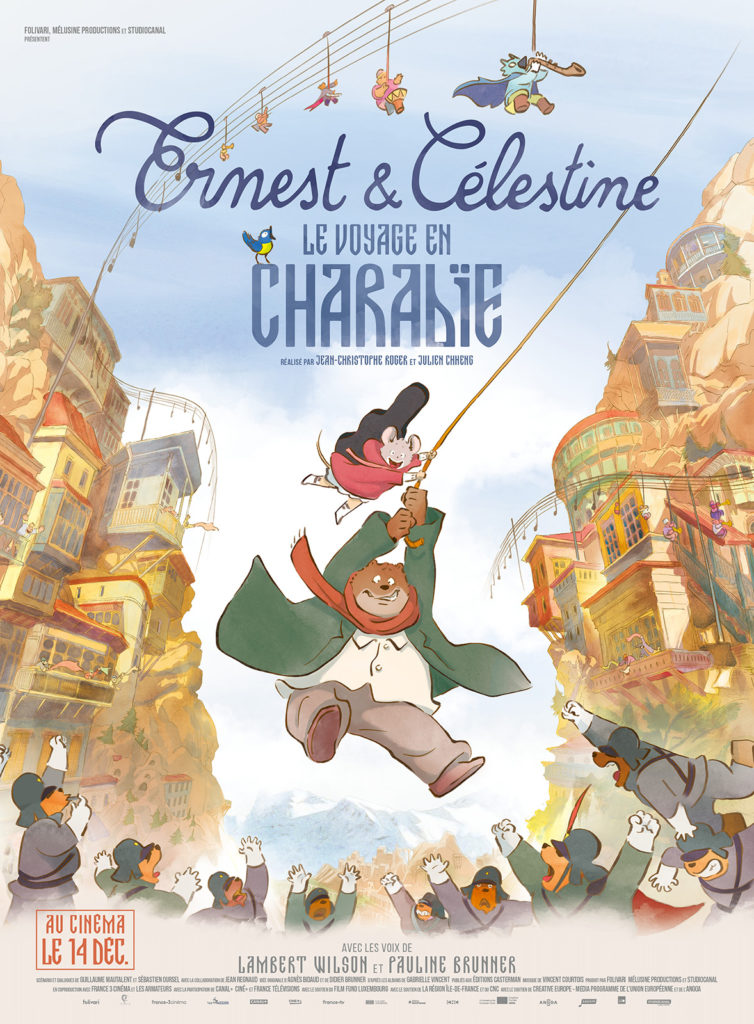
Offrez à vos enfants (de 3 à 9 ans) un magnifique séjour en Charabie, en compagnie des irrésistibles
Ernest & Célestine. Un voyage d'autant plus beau qu'il se fait sur grand écran et avec un public qui vibre à l'unisson !
Ernest, l'ours mal-léché vit avec son amie la petite souris Célestine, qui est pratiquement sa fille adoptive. Dans ce nouvel épisode de leurs aventures, ce duo tendre et bienveillant part dans le pays natal d'Ernest : la Charabie. Un pays dont tous les habitants aiment et pratiquent la musique. Sauf qu'après un voyage épique, ils découvrent que ce n'est pas la joie au pays !
Dans cette nation dont la devise est "C'est comme ça et pas autrement" et dont le symbole est le Marteau, des juges aussi bornés que sinistres dictent la loi. Et ils ont décrété que seule la note do était autorisée dans le pays. Consternation.
Face à cet autoritarisme manifeste, la résistance s'organise, menée par le musicien masqué Mifasol. Violoniste émérite, Ernest jouera bien sûr un rôle déterminant pour faire ressusciter la musique.
Servi par une jolie bande-son acoustique, ce film restitue toute l'élégante des célèbres albums de Gabrielle Vincent. C'est à la fois émouvant et comique. La douceur "aquarellée" du trait de dessin est respectée, c'est visuellement très réussi et ça nous change des horribles couleurs de certains dessins animés ("les Chiens Mousquetaires, par exemple). Et je parie que vous ne résisterez pas à la tendresse infinie qui lie Célestine et Ernest.
Un tout petit avertissement cependant : le précédent opus (Ernest et Célestine en hiver, sorti à l'hiver 2016) me paraissait mieux adapté aux tout-petits. L'histoire du nouveau film est un tout petit peu longue, et puis le rythme effréné des poursuites pourra parfois impressionner les plus jeunes, même s'il faut dire que l'ensemble est tout de même beaucoup moins speed que les films pour enfants habituels.
"Ça m'a fait peur parce que j'ai eu peur des policiers qui voulaient les mettre en prison." (Ethel, 3 ans 1/2)
Au cinéma le 14 décembre 2022
De Julien Chheng & Jean-Christophe Roger
Par Guillaume Mautalent & Gabrielle Vincent
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau
1h 19min

American Predator, Maureen Callahan, 10/18
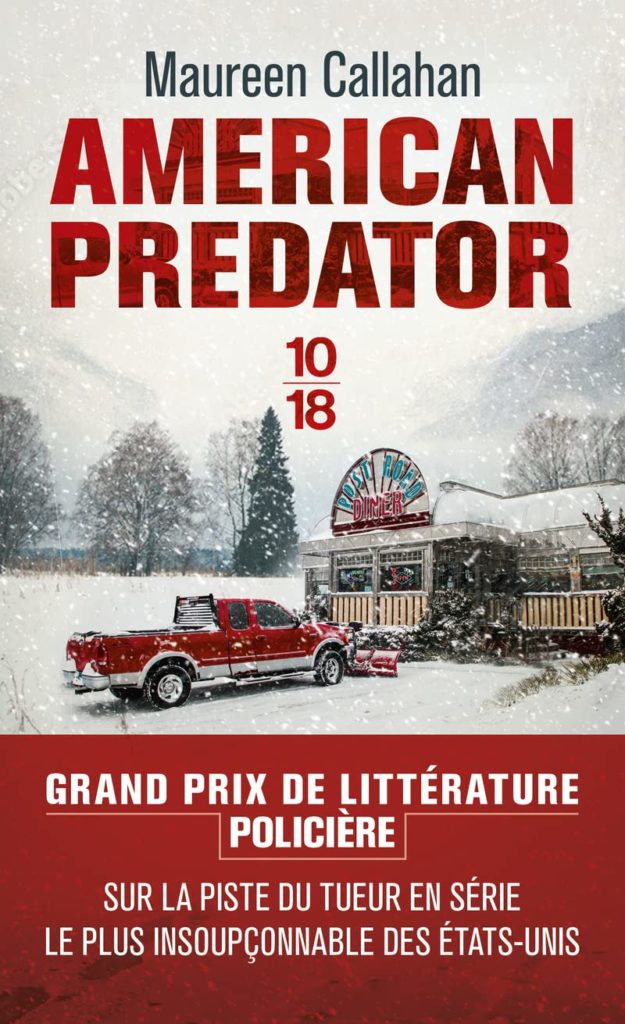
La journaliste d'investigation Maureen Callahan signe un livre sur le tueur en série américain Israël Keyes. Cette enquête qui se lit comme un (bon) roman est aussi passionnante que glaçante. Ce livre remarquable se lit d'une traite !
En février 2012, à Anchorage (Alaska), disparait une jeune femme qui travaille dans une minuscule cafétéria de bord de route. Au départ, la police pense à une banale fugue...
A cette erreur d'appréciation s'ajoutent - comme c'est souvent dans les faits divers états-uniens - des querelles de chapelles entre les différents corps de police impliqués (FBI, Criminelle locale, police de la route…). Tout cela sans compter ce Procureur à l'égo démesuré qui abuse de son pouvoir pour mener lui-même les interrogatoires du suspect, au risque d'invalider toute la procédure.
En dépit de ces vicissitudes, Maureen Callahan rend un hommage sensible aux flics de toutes sortes qui se prennent cette affaire traumatisante en pleine poire. Car il y a des perles d'humanité dans cette histoire, comme ce plongeur du FBI dont la vie consiste à côtoyer les morts, comme cette enquêtrice qui n'aime rien tant que décortiquer des données pour en faire émerger un récit, ou encore comme ce brave Texas Ranger qui arrive à tirer quelque chose d'un avis de recherche particulièrement flou et imprécis, ce qui mènera à l'arrestation d'un suspect. Une interpellation qui tient à peu près du miracle.
Alors qu'ils pensent avoir bouclé une "simple" affaire de kidnapping, les flics comprennent qu'ils n'en sont en réalité qu'aux prémices d'une enquête vertigineuse sur les agissements d'un tueur en série méthodique et impitoyable.
Un tueur assez cynique pour poser des "congés décès" lorsqu'il part en randonnée meurtrière, et assez froid pour assister tranquillement à une réunion parents-profs à l'école de sa fille... alors qu'il vient tout juste de se débarrasser d'un cadavre ! (page 173)
Israël Keyes n'est pas un tueur de masse du genre bourrin. Au contraire, ce type méticuleux, documenté et ingénieux déroute même les meilleurs profilers du FBI. Ayant étudié les biographies d'autres tueurs, il s'en inspire pour mieux brouiller les pistes et faire disparaitre les preuves. Doté d'une mémoire d'éléphant, il se souvient précisément de chacun de ses crimes, mais ne livre que ce qu'il veut.
Comme les livres de Tara Westover ou de Mikal Gilmore, le récit proposé par Maureen Callahan illustre tout le poids que la religiosité des parents peut avoir sur leurs enfants. Sans chercher d'excuses à Israël Keyes, on perçoit qu'il n'a pas été aidé par l'éducation que lui ont donnée ses parents, eux-mêmes assez mal barrés et passés du mormonisme au suprémacisme blanc.
" Paradoxalement, ce sont ces actes qui lui permettent de se prendre pour le Dieu en lequel il ne croit pas." (page 249)
Heureusement, le talent et la rigueur journalistique de l'autrice rendent l'enquête fascinante et nous permettent de supporter la description des faits indicibles commis par ce grand manipulateur qui aime jouer avec les nerfs des enquêteurs comme avec ceux de ses victimes.
Parution le 03 novembre 2022
chez 10/18,
384 pages / 8,50€
Traduit de l'anglais par Corinne Daniellot
Prix de littérature policière 2022 - Grand prix - Étrangère

Arnaud Adami, Espace Richaud Versailles

Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir la belle exposition de peintures d'Arnaud Adami, à l'Espace Richaud de Versailles. Ne la manquez pas ! (L'entrée est libre, vous n'avez vraiment aucune excuse.)
S'il n'a pas encore terminé son parcours académique - Arnaud Adami est actuellement étudiant aux Beaux-Arts de Paris - le jeune homme de 27 ans fait déjà preuve d'une impressionnante maîtrise des techniques picturales. La filiation avec la peinture classique est assumée, si ce n'est revendiquée. Dans ses œuvres, Arnaud Adami rend hommage aux Primitifs italiens comme aux peintres de la Renaissance. Un réalisme tel qu'on pourrait presque se croire devant des photographies.
De la peinture figurative ? C'est du déjà vu me direz-vous, c'est ringard, pour ne pas dire kitsch.
Pourtant, Arnaud Adami est bel et bien moderne. Sa peinture est en prise directe avec le réel de notre époque. Les thèmes abordés sont résolument modernes. L'artiste portraiture les forçats de notre Société : les livreurs, les soignants, les ouvriers d'abattoirs, ces premiers de corvée qu'on a oubliés à peine passée la crise Covid. Il les peint avec précision et respect. Avec lui, vous ne serez pas étonné qu'un livreur se transforme en prince.
Le travail d'Arnaud Adami m'évoqué les « Raboteurs de parquet » de Gustave Caillebotte. Quant à son portrait d'un réanimateur du SMUR en train d'intuber un patient, il m'a fait penser au portrait de Louis Pasteur, du peintre Albert Edelfelt que j'aime tant.
De sacrés références pour un jeune peintre prometteur !
Jusqu'au 20 novembre 2022
Espace Richaud, Versailles
http://arnaudadami.fr/
Entrée libre

Les Odyssées, Laure Grandbesançon, Théâtre Libre

En ce samedi après-midi, la salle du Théâtre Libre fourmille d'enfants tout excités à l'idée de rencontrer leur idole: la pétillante Laure Grandbesançon, l'autrice et l'interprète des Odyssées, le fameux et fantastique podcast de France Inter.
Si vous avez des enfants de sept à douze ans et que vous ne connaissez pas encore les Odyssées de France Inter, alors remerciez-moi car cette série d'émissions devrait occuper vos bambins pendant un bon moment ! Dans chacun des plus de quatre-vingt-dix épisodes, il s'agit de se plonger durant un quart d'heure, gros ou petit, dans la vie aventurière d'une grande figure historique. C'est totalement déjanté et bigrement intéressant. On pourrait qualifier cela d'aventurire !
Au théâtre, Charlotte Saliou met en scène quatre de ces récits : l'exploration de l'Amérique du Sud au XVIIIème siècle par Jeanne Barrot, une femme qui brave les interdits pour prendre la mer ; la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, un archéologue anglais et pugnace ; la vie romanesque de Jin, la grand-mère de Laure Granbesançon et, enfin, l'imprévu voyage dans l'inconnu de l'équipage de la fusée Apollo 11.
Je n'ai pas vraiment gouté la scène d'introduction survitaminée et bruyante, façon parodie de film d'espionnage. "Je n'aimais pas trop quand ils faisaient semblant de courir" (dixit Norma, 8 ans et demi). En revanche, j'ai beaucoup apprécié la scénographie et le décor que les deux comédiens (Laure Granbesançon et Baptiste Belaïd) font évoluer en un tournemain et qui les transporte en un instant d'un galion à une navette spatiale. "Le décor était impressionnant parce qu'il y avait plein de trappes" (dixit Norma, 8 ans et demi). Le spectacle vaut le détour rien que pour ça. Quelle beauté, c'est comme dans un rêve !
Bien sûr, il est difficile pour la pièce de se hisser au niveau de la création radiophonique. "J'ai bien aimé ce spectacle, même si je n'ai pas vraiment retrouvé l'esprit humoristique du podcast" (dixit Norma, 8 ans et demi). On a l'impression que la metteuse en scène a voulu rendre le spectacle accessibles aux plus petits ; et ça marche ! Les jeunes réagissent volontiers aux gags visuels et sont morts de rire.
Si vous êtes déjà fans du podcast, alors vous regretterez peut-être comme moi que Laure Grandbesançon joue les personnages plutôt que d'endosser le rôle de narratrice qui lui va si bien. Ses exclamations et ses jurons polis ("Pétard ! Mamma mia ! Mazette !" nous ont manqué, à ma fille et à moi).
Si vous découvrez les Odyssées par le biais de ce spectacle, je parie que vous serez conquis sans réserve car l'ensemble ne manque pas de charme ni de qualités malgré quelques tout petits ajustements à faire, (je précise que j'ai assisté à la première, ce qui a son importance).
En tout état de cause, Les Odyssées sont un spectacle intelligent, drôle et beau, qui ne prend pas les enfants pour des nouilles. C'est génial de voir une salle remplie de gamins enthousiasmés par un spectacle bien vivant !
du 22 octobre 2022 au 1er janvier 2023
(samedi et dimanche à 14h, et tous les jours à 14h durant les vacances de Noël)
Spectacle-enquête à partir de 6 ans - durée prévue 1h
Avec Laure Grandbesançon et Baptiste Belaïd
Mise en scène : Charlotte Saliou
Scénographie : Cirque Le Roux
Théâtre Libre, Paris Xème
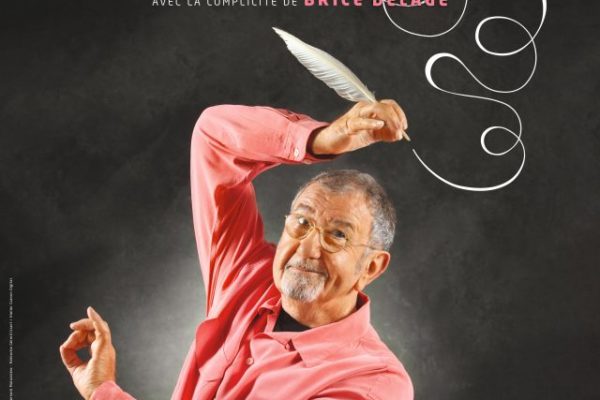
Gotainer ramène sa phrase, Richard Gotainer , Lucernaire
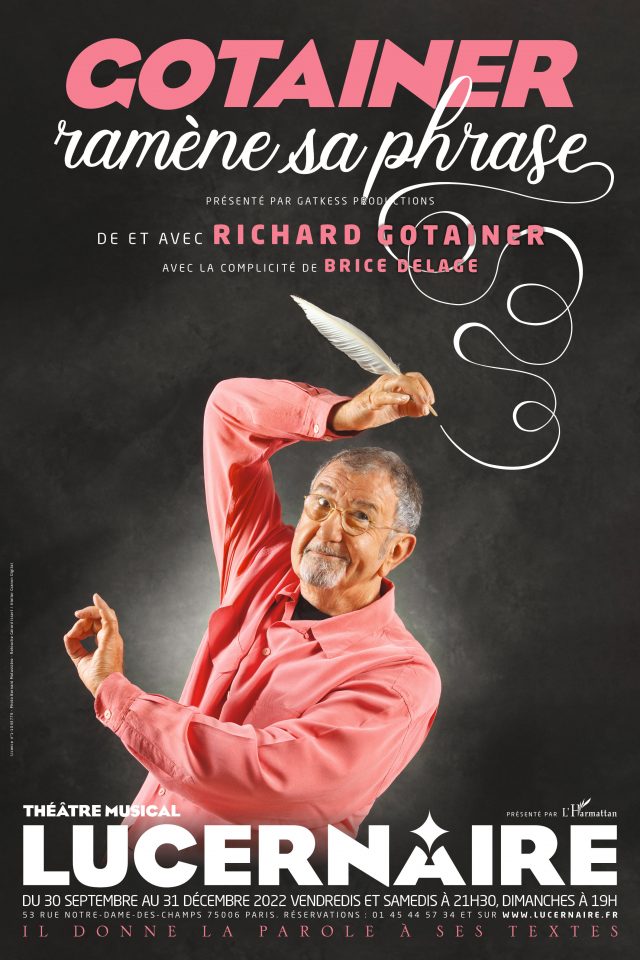
S’il a pris un peu de bide, l’ami Gotainer n’a pas pris une ride ! Sa gouaille érayée et son accent reconnaissables entre mille n’ont pas changé, ni la qualité de sa plume. Car c’est qu’il écrit mieux qu’il n’y parait, ce grand gamin aux airs d’éternel chenapan !
Avec la complicité de Brice Delage, guitariste talentueux, Richard Gotainer ne chante plus mais récite les textes de ses chansons dont on réalise (si on ne l’avait pas déjà fait dans les années 80-90) qu’elles constituent autant de jolies petites histoires où pointe l’amour des mots et des sons.
Gotainer a un talent de nouvelliste. Il croque en quelques mots notre bêtise ordinaire et nous tourne gentiment en dérision lorsque nous nous transformons en gros con-ducteurs ou quand nous sommes gagas de notre chien.
Derrière la blague pointe parfois le sérieux. Certains textes vieux de trente ans sont encore d’une actualité étonnante : « Quéquette blues » (« je suis sa chose, elle dicte et j’obéis (…) depuis tout petit, je suis son obligé »), « Rupture de stock » (« On en a eu, y en a eu plein, de l’eau, on en a eu à l’époque. Mais là, rupture de stock, walou, tintin, on n’en a plus en magasin, de l’eau »).
En n’étant pas chantés mais dits, ses tubes de jadis se réincarnent en véritables fables. Revenir à l’épure permet de se focaliser sur la qualité des textes, qualité souvent dissimulée sous le fard de la farce. Allez, soyons honnêtes, ce n’est ni Ronsard ni Baudelaire, mais enfin il y a du Trenet dans la façon de jouer avec les sonorités, les allitérations ou autres virelangues.
Gotainer a indéniablement un amour des mots, y compris les gros, pour autant que le vocabulaire soit varié à défaut d’être châtié. Et c’est là que la grossièreté prend une forme d’élégance. La danse des gros mots est, à ce titre, assez irrésistible.
« Ne lâchons pas la main du gamin en nous », nous exhorte Gotainer, cet hurluberlu qui – en bon disciple de Marcel Gotlib - m’a fait retrouver mes dix ans le temps d’un spectacle. Qu’il en soit ici remercié !
Jusqu'au 31 décembre 2022
au Lucernaire, Paris
De et avec Richard Gotainer
Avec la complicité de Brice Delage
Durée 1h15
de 10€ à 28€

DEM, William Melvin Kelley, 10/18
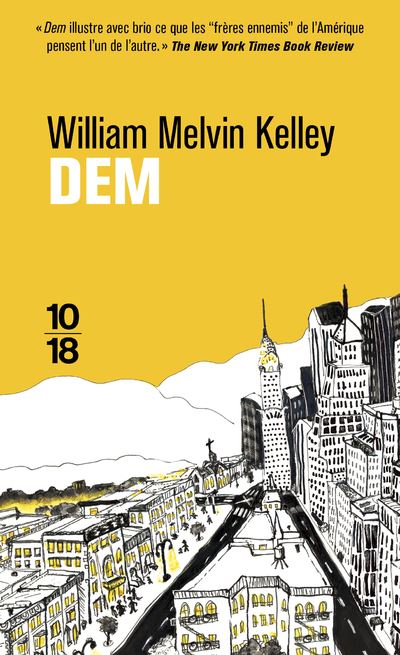
Je vais essayer de ne pas trop vous en dire sur DEM, le livre de William Melvin Kelley, tout en tâchant de vous donner envie de le lire.
Il semble assez délicat de parler de ce roman sans divulgâcher l'histoire ; peut-être est-ce pour cela
que la quatrième de couverture révèle sans vergogne l'intrigue du chapitre intitulé "Les jumeaux", ruinant ainsi une bonne partie du bouquin...
DEM s'apparente davantage à un recueil de nouvelles qu'à un roman. Plusieurs histoires courtes se succèdent avec vivacité et énergie, avec pour nominateur commun Mitchell, un publicitaire qui lutte pour maintenir l'illusion de sa vie de famille alors qu'il vit une succession de mauvais rêves, mauvais rêves qui se transforment par moment en véritable cauchemar, comme par exemple dans la première partie ("Quand Johnny revient de guerre").
Le livre est assez étrange et il n'est pas toujours évident de distinguer la réalité des hallucinations de ce type blanc, plus blanc que blanc, dont "l'arrière-arrière... comment appelle-t-on ça... était l'un des trois cents hommes qui ont pris New Amsterdam aux Hollandais avec le colonel Nicolls" en 1664 (page 129). Toujours est-il que ces mésaventures - vécues ou fantasmées - vont faire toucher du doigt au personnage la réalité de la vie des noirs de son pays.
Car, en bon homme blanc des années 1960, Mitchell est ordinairement raciste et se rêve en bon maître chez lui. Mais ses ambitions de domination raciale et patriarcale vont se fracasser sur l'émancipation des femmes et des afro-américains dont certains ont "de vieux compte à régler" avec lui, "des comptes vieux d'il y a quatre-cents ans, du temps de son grand-père, de son arrière-grand-père." (page 228)
Parution le 18 août 2022
chez 10/18, Littérature étrangère
Traduit de l'anglais (USA) par Michelle Herpe-Voslinsky
240 pages / 7,90€

Drum Brothers, les Frères Colle, Eric Bouvron, Bobino

De façon très habile, les Drum Brothers - alias les frères Colle - recyclent quelques techniques traditionnelles du cirque pour proposer un spectacle familial comme vous n'en avez jamais vu. Étonnant !
Grâce à numéro rendant hommage à la fois aux Daft Punk et à Matrix, les Drums Brothers se sont fait connaître du grand public lorsqu'ils ont accédé à la demi-finale du télé-crochet La France a un incroyable talent. Curieusement, ce n'est pas ce numéro, très (télé)visuel, qui passe le mieux sur scène, même s'il reste impressionnant par la maîtrise impeccable et la coordination parfaite qu'il suppose.

Comme dans la musique rock, la batterie sert de colonne vertébrale au spectacle ; ce qui n'interdit pas les solos des autres membres du groupe. Car les frères Colle cumulent les talents et leur entente artistique est parfaite ; leurs parents peuvent être fiers d'eux. Clément est un virtuose de la batterie, Cyril un flutiste reconnu doublé d'un jongleur talentueux et Stéphane, en véritable clown, un touche à tout de génie.
Ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont ces showmen transcendent leurs disciplines respectives en les mettant en commun. Leur travail en commun me semble bien plus intéressant qu'une simple démonstration de percussion ou de cirque. Ils ont su réinventer leur travail pour jongler littéralement avec les sons.
C'est un joli spectacle familial qui ravit les (grands) parents comme les enfants, en France comme à l'étranger. Les plus jeunes sont conquis par le numéro de clown de Stéphane Colle et ne peuvent s'empêcher d'éclater de rire. Ma fille de bientôt neuf ans avait des étoiles plein les yeux et s'est bien amusée.
Les séquences s'enchaînent à un rythme endiablé qui vous donnera envie de frapper dans les mains et de vous lever pour vous trémousser; d'ailleurs, le public ne peut s'empêcher de se lever pour une belle standing ovation à la fin du spectacle.
du 1er au 29 octobre 2022
Théâtre musical, percussions et jonglerie
à partir de 6 ans - durée 1h10
Avec Clément Colle, Cyril Colle et Stéphane Colle.
Mise en scène Eric Bouvron
du jeudi au samedi à 19h - dimanche à 15h
A Bobino

C’est moi le plus fort, et autres histoires de loup, Mario Ramos, Philippe Calmon, Lucernaire

Philippe Calmon a eu l'excellente idée d'adapter au théâtre les albums de Mario Ramos. Au son délicat et chaleureux de la contrebasse, les deux comédiens Philippe Calmon et Eveline Houssin donnent vie aux personnages créés par Mario Ramos, pour le plus grand plaisir des enfants.
Le Grand méchant loup, imbu de sa personne, réalise auprès des habitants de la forêts un sondage pour savoir s'il est, réponse A, le plus fort ou, réponse B, le plus beau. Les Trois petits cochons, le lièvre, le Petit Chaperon rouge, Blanche Neige et les Sept nains ("les zinzins du boulot" !), tous apportent leur réponse empreinte d'une certaine crainte, jusqu'à ce qu'un petit invité impertinent et facétieux vienne déstabiliser notre loup qui se montrera aussi pathétiquement drôle que prétentieux.
A peine la pièce a-t-elle commencé que la glace est brisée. Les enfants sont fascinés par ces ravissantes marionnettes (et leur marionnettistes à la fois très présents et parfaitement transparents) ; ils répondent, commentent, et chantent avant que de glousser de rire et de joie.
La mise en scène est à l'épure. Les éléments de décors sont mobiles et regorgent de surprises. C'est faussement simple mais très efficace. En un mot: élégant.
La durée du spectacle, 45 minutes, est idéale pour les petits qui restent scotchés jusqu'à la fin. Croyez-moi, c'est autre chose que la fascination des petits pour les écrans !
Au-delà du spectacle qui est un enchantement, c'est pour un parent une expérience magnifique que de voir un enfant enthousiasmé et transporté par un spectacle (plus que) vivant.
Jusqu'au 13 novembre 2022
Théâtre Lucernaire
A partir de 3 ans, durée 45 minutes
12€ T.R / 15€ T.P.
Du mardi au samedi à 15h et le dimanche à 11h pendant les vacances scolaires
- De Mario Ramos
- Adaptation et mise en scène Philippe Calmon
- Avec Eveline Houssin et Philippe Calmon
- Musique Alexandre Perrot
- Décor, Scénographie et Marionnettes Philippe Calmon
- Production Compagnie Métaphore
- Partenaires Sud-Est Théâtre À Villeneuve Saint-Georges, Le Crea À Alfortville, Le Théâtre Des Roches À Montreuil et L’espace Paris Plaine

Fuir et revenir, Prajwal Parajuly, 10/18

Après Le temps de l’indulgence de Madhuri Vijayun, je continue d'explorer la littérature indienne contemporaine avec Fuir et Revenir, de Prajwal Parajuly. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas été particulièrement emballé par ce roman.
L'histoire est simple. A l'occasion de son quatre-vingt-quatrième anniversaire (une célébration particulièrement importante en Inde, Chitralekha, une vieille dame à la poigne de fer reçoit chez elle ses quatre petits-enfants qu'elle a élevés. Chacun d'eux a quitté le pays à l'âge adulte, et tourné le dos aux traditions du Sikkim, l'état indien situé au cœur de l'Himalaya, dont ils étaient originaires.
" La vieille femme (a) des comptes à régler avec tout le monde." (page 134)
Chacun a un secret honteux qu'il veut cacher aux autres, par peur de leur jugement. Bhagwati - qui s'est mariée avec un homme d'une caste inférieure - n'a pas trouvé la fortune aux États-Unis d'Amérique où elle est réfugiée. S'il a réussi professionnellement aux USA, Agastaya, lui, n'assume pas son homosexualité. Manasa a fait de brillantes études et un beau mariage, mais elle a dû renoncer à sa carrière à Londres pour jouer la garde malade auprès de son beau-père. Ruthwa, quant à lui, a commis un acte impardonnable en écrivant un roman où il a dévoilé un secret de famille.
Seule Prasanti, la "domestique demi-genre (…) persécutrice née " (page 109), est restée auprès de la matriarche dont elle fait figure de fille adoptive loyale mais irrévérencieuse.
Dans ce livre, tout semble à la fois survolé et très long. L'auteur, Prajwal Parajuly, se lance dans des pistes prometteuses qui n'aboutissent jamais réellement. Par exemple, le dévoilement du secret révélé par Ruthwa dans son livre tombe totalement à plat ; peut-être parce qu'on l'a trop attendu...
La lecture de ce livre n'est pas inintéressante en ce que le roman est exotique et dépaysant. Ainsi, j'ai appris quelques choses sur les dissensions qui traversent l'Inde, et sur le poids des traditions et des religions. Oui mais voilà, je n'ai pas été touché par l'histoire. Les parcours de vie des protagonistes, leurs états d'âmes, ne m'ont pas ému, ne m'ont pas touché. Surtout, je ne me suis jamais attaché aux personnages qui ne sont ni sympathiques ni pour autant le genre d'anti-héros qu'on adore.
Parution le 18 août 2022
en poche chez 10/18
Éditeur originel: Emmanuelle Collas Éditions
Traduction Benoîte Dauvergne (Anglais, Inde)
384 pages / 8,50€
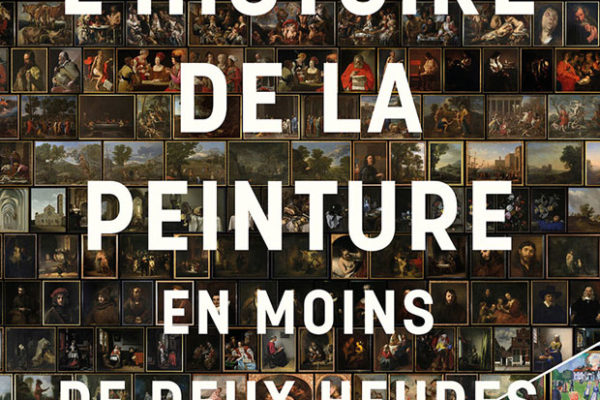
Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures, Hector Obalk, Théâtre de l’Atelier
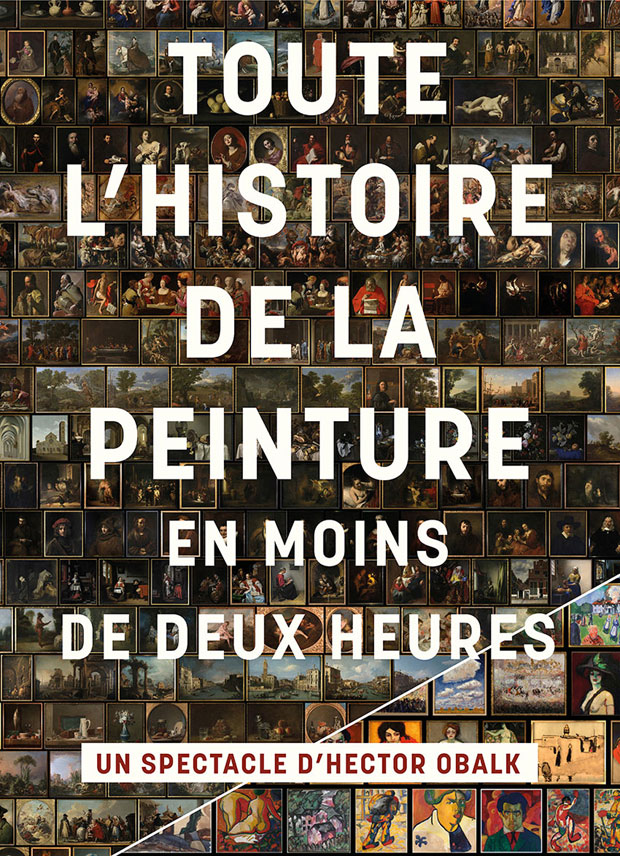
Voilà un petit moment que je n'étais allé à Montmartre. Quelle laideur et quelle désolation ont apporté dans leurs valises les touristes de masse ! Heureusement, certaines choses du quartier des Abbesses sont immuables, comme le Théâtre de l'Atelier qui trône si joliment sur une petite place arborée.
La laideur environnante sera totalement oubliée dès que vous franchirez la porte du théâtre pour assister à une représentation de Toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures, d'Hector Obalk. Car j'espère bien vous convaincre de ne pas passer à côté de ce spectacle aussi drôle qu'édifiant.
Le critique d'art Hector Obalk s'est lancé le défi de nous expliquer en moins de deux heures toute la peinture, du XIIIème au XXème siècle. Dès le départ, il désamorce les bombes sexiste et wokiste ; oui, il ne parlera que de peintres mâles et occidentaux, non par choix mais parce que c'est là que cela se passe.
Pendant (un peu moins de) deux heures, Hector Obalk évoquera avec le même entrain les primitifs italiens (qui "ne savent pas faire les décors, alors (qui) font des fonds or" !) jusqu'aux contemporains qui ont déconstruit la peinture. Il isolera quelques œuvres, les agrandira, les comparera et les disséquera grâce à un mur d'images allant de Giotto à Yves Klein, une mosaïque de chefs d’œuvres picturaux projetée sur le fond de la scène.
Hector Obalk laisse une large part à l'improvisation et adopte un ton léger (voire parfois grossier), ce qui nous met à l'aise. Ma fille de bientôt neuf ans était morte de rire, comme le reste du public. Parfois, cet érudit décontracté a même l'élégance de faire semblant d'hésiter sur certains noms de peintres, comme pour se mettre à notre niveau. Il est très agréable de ne pas avoir l'impression d'être écrasé sous le poids des connaissances du conférencier ; c'est comme une discussion de bistrot.
A un rythme effréné seront évoqués Giotto, Corègge, Parmigianino, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Le Greco, Bronzino, Rubens, van Ruisdael, Le Caravage (un immense merci à Monsieur Obalk de me l'avoir fait découvrir !) et tant d'autres... sans que cela soit pesant.
Hector Obalk ne cherche pas le sens de l’œuvre, il ne s'attarde pas sur sa place dans l'Histoire mais, sans faire montre d'autorité, il cherche à nous donner envie d'ouvrir les yeux et nos cœurs à la poésie d'une œuvre. Il nous donne des clefs pour regarder attentivement, analyser et apprécier un tableau. En osant dénigrer certains grands peintres, le conférencier (ou devrais-je plutôt dire le showman!) désacralise la Peinture en même temps qu'il la célèbre. En affirmant qu'on a même le droit de ne pas trouver Van Gogh génial, il rend l'Art (avec un grand A) beaucoup moins intimidant pour le profane. Cela me touche car, pour moi, une œuvre doit pouvoir se suffire à elle-même - vous prendre aux tripes ! - sans avoir besoin d'explications.
Toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures est un spectacle que l'on aimerait revoir (ce que l'on pourra faire aisément car il se décline en deux versions, A comme Alpha, et B comme Bravo). Surtout, c'est un moment que l'on a envie de partager avec ceux qu'on aime, c'est pourquoi je vous le recommande chaudement !
Spectacle vu le 18 septembre 2022
au Théâtre de l'Atelier, Paris 18
Retrouvez toutes les informations sur les différents spectacle en cliquant ici
Le parcours A (comme ALPHA)
PRIMITIFS ITALIENS (Dormition de la Vierge de Giotto)• ANGELICO (Dormition de St François) • VAN EYCK (Vierge au Chevalier Rolin) • LÉONARD (Annonciation) • MICHEL-ANGE (Le Serpent d'Airain) • CORRÈGE (Léda et le cygne) • BRONZINO (Triomphe de Vénus) • CARAVAGE (L'Amour vainqueur) • RUISDAEL (Paysages hollandais) • VERMEER (Dame écrivant une lettre) • WATTEAU (Voulez-vous triompher des belles) • CHARDIN (Le Gobelet d'argent) • CÉZANNE (Allée du Jas de Bouffan)… et enfin un peintre contemporain (surprise du jour).

Kompromat, Jérôme Salle, SND

Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) est directeur de l'Alliance Française à Irkoutsk, en Sibérie. Tout va (presque) bien dans sa vie, jusqu'à ce qu'il soit brutalement arrêté par les services secrets russes et jeté en prison au prétexte d'une accusation bidonnée (un "Kompromat"). Pendant tout le film, le héros tentera d'échapper au FSB qui le poursuit après qu'il a réussi à s'enfuir.
Gilles Lellouche met toute son énergie dans ce film et c'est toujours un plaisir de voir cette bête de cinéma évoluer à l'écran. L'acteur n'a pas ménagé sa peine, que ce soit en apprenant de longues phrases en russe ou en s'en prenant plein la gueule dans les prisons russes ou dans les forêts glacées.
Les paysages de Sibérie sont beaux et il y a des choses assez réussies dans ce film épique. J'ai, par exemple, bien aimé les noms de ville qui apparaissent sur un plan aérien, transformant l'écran en une grande carte routière. Tout le monde joue bien, avec une mention spéciale pour Louis-Do de Lencquesaing qui excelle en ambassadeur écœurant d'ambition et de veulerie.
Mais, malgré ses qualités, le film multiplie les défauts. On s'y vautre assez volontiers dans le cliché (les brutes russes sont un peu caricaturales...), les décors sonnent globalement faux et vous rappelleront furieusement la quatrième saison du Bureau des Légendes, et il y a de grosses invraisemblances, notamment téléphoniques. Il faut dire que le réalisateur/scénariste Jérôme Salle n'est pas connu pour sa finesse: on lui doit l'improbable série des Largo Winch avec Tomer Sisley, c'est dire...
Le vrai gros défaut du film tient à son scénario. A trop vouloir créer du suspense et incorporer au forceps une romance dans le drame, les scénaristes Jérôme Salle et Caryl Ferey décrédibilisent totalement cette histoire qui est pourtant inspiré de faits réels.
Sortie le 07 septembre 2022
Production Super 8 et SND
127 minutes
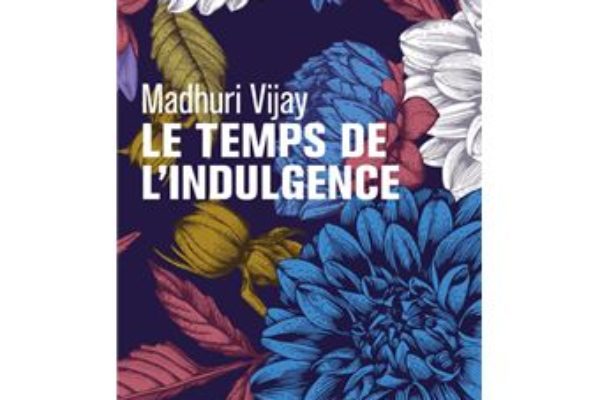
Le temps de l’indulgence, Madhuri Vijay, 10/18
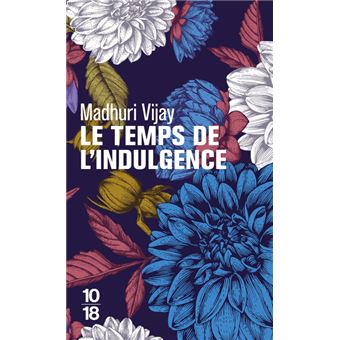
Quand Shalini était petite, sa mère - une femme peu commode à l'humour corrosif, "qui passait de la joie à la méchanceté d'une minute à l'autre (page 169) - ne faisait aucun effort pour se lier aux autres. Seul trouvait grâce à ses yeux Bashir Ahmed, un vendeur ambulant cachemiri, un brin flagorneur et à qui elle n'achetait jamais rien, malgré ses visites rituelles et régulières.
"Je voyais qu'il parlait, et qu'elle lui répondait comme elle ne répondait à personne d'autre. Je voyais qu'une lumière et une joie grandissaient en elle quand il était dans la pièce, et s'éteignaient quand il repartait. Et pour moi, c'était suffisant pour commencer à l'aimer." (page 142)
Shalini n'a qu'une vingtaine d'années lorsque meurt sa mère. Elle décide alors sur un coup de tête de quitter Bangalore pour partir à la recherche de Bashir Ahmed, le cachemiri qu'elle n'a pas revu depuis six ans. Peut-être sera-t-il capable de lui donner quelques clefs pour mieux comprendre sa mère ? Et peut-être trouvera-t-elle auprès de lui un peu de réconfort ?
Vous l'aurez compris, Le temps de l'indulgence est un roman initiatique. La narratrice - en héroïne à la Françoise Sagan - est une jeune femme privilégiée qui ne sait pas trop où elle en est. Elle va se chercher (et se trouver?) en quittant son cocon pour partir à la découverte de son propre pays.
L'autrice passe assez vite sur le voyage en lui-même, pour mieux se concentrer sur les points de départ et d'arrivée, sur le contraste qui existe entre Bangalore et le Cachemire indien. A Bangalore, grande ville hindouiste, Shalini traine son spleen et vit à l'occidentale. Au Cachemire, elle découvre la vie pauvre et rude des paysans des montagnes de l'Himalaya, dont elle ne partage ni la langue ni la religion. Elle aborde les personnes qu'elle rencontre assez naturellement, sans préjugés, et comprend peu à peu combien l'armée joue un rôle trouble dans leur vie.
A l'image de son héroïne un peu naïve, la jeune autrice indienne Madhuri Vijay aborde des sujets graves sans avoir l'air d'y toucher. En évoquant la vie quotidienne des cachemiris, elle met le doigt sur la situation générale dans la région - située au croisement de l'Inde, du Pakistan et de la Chine - où l'armée indienne fait disparaitre des musulmans pour des broutilles, sans que le reste du pays ne s'en émeuve.
Sans prétendre donner de clefs de compréhension, Madhuri Vijay ramène une problématique géopolitique à l'échelle de l'individu, à taille humaine. Elle décrit des situations choquantes qui interpellent et nous donne subtilement envie de nous renseigner sur la situation de cette région.
Si le voyage est parfois éprouvant, c'est un réel plaisir de partir à l'aventure en compagnie de Shalini !
Paru le 18 août 2022
en poche chez 10-18 (éditeur originel: Faubourg Marigny)
552 pages / 9,60€
Traduction Typhaine Ducellier (anglais)

Mots et illusions, quand la langue du management nous gouverne, Agnès Vandevelde-Rougale

Peut-être, comme moi, travaillez-vous dans une entreprise moderne et performante où l'on vous bassine avec la bienveillance, l'agilité, le leadership emphatique et ce genre de joyeusetés ? Peut-être, parfois, vous dites-vous que les entreprises font exactement le contraire de ce qu'elles disent (par exemple lorsqu'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi vise en réalité à virer des gens, lorsqu'on confond qualité et Respect des procédures ou encore lorsque des sociétés aux actions délétères se targuent de Responsabilité Sociale et Environnementale). Peut-être aimez-vous les mots et avez-vous remarqué qu'un vocabulaire particulier fleurit chez certains de vos collègues ? Peut-être vous-mêmes utilisez-vous ce sabir, sans vous en rendre compte, en y croyant à moitié (le "demi-croire", page 39) ou encore sciemment voire cyniquement.
Quoi qu'il en soit, je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce passionnant petit ouvrage rédigé par Agnès Vandevelde-Rougale (Docteure en anthropologie et sociologie), qui traite de la novlangue maniée par les managers du privé comme des administrations.
Lorsque j'observe la vie en entreprise, j'ai parfois l'impression d'avoir la berlue, de me faire des idées ou d'avoir décidément trop mauvais esprit. Aussi trouvé-je salvateur de m'en remettre à des personnes sérieuses qui analysent, décortiquent et étudient la sociologie du travail. Malheureusement, la rigueur scientifique rend parfois les ouvrages assez indigestes pour qui n'est ni un chercheur, ni un intellectuel.
A l'inverse, ce court livre se dévore rapidement et est d'une clarté remarquable, chaque idée force étant mise en exergue visuellement. En lisant cet essai, vous n'aurez plus de doute sur le fait que l'utilisation du vocabulaire "corporate" est loin d'être innocente, que "le prêt à parler accompagne le prêt à penser" (page 15) et que "le langage managérial est indissociable de l'idéologie de la gestion et de la croissance qui a accompagné le développement du capitalisme industriel puis financier et néolibéral" (page 19).
Ainsi, en mettant l'accent sur la responsabilité (et la réussite) individuelle, on rend les personnes comptables de ce qui ne fonctionne pas, ou mal, quand il faudrait plutôt interroger les failles du système organisationnel (notamment en cas de harcèlement au travail). Or, il n'y a "pas de bien-être sans bien faire", et ce ne sont pas les massages, cours de yoga et autre babyfoot qui changeront cette vérité, pas plus que d'appeler un chat un chien !
"Nous avons tendance à parler avec les mots qui nous entourent, qui semblent "couler de source", ce qui renforce le pouvoir des discours dominants. Ainsi, nous "optimisons" nos vacances, nous "gérons" notre temps, nos émotions et nos enfants, nous "investissons" dans des relations ou des apprentissages..." (page 82).
Il est grand temps de reprendre la parole !
Parution le 15 septembre 2022
chez 10/18 Grands reporters
112 pages / 6€

L’écume des jours, Boris Vian, Claudie Russo-Pelosi, Lucernaire

Si vous aimez l’Écume des jours de Boris Vian, vous devriez être conquis par cette sympathique et dynamique adaptation théâtrale (et musicale) proposée par Claudie Russo-Pelosi au Lucernaire.
Dans la file d'attente, un type affirmait adorer ce roman qu'il prétendait avoir lu trente fois. Trente fois ? En ce qui me concerne, une fois aura suffi ! Autant les chansons de Boris Vian me font rire, autant j'ai trouvé ce livre barbant, avec ses faux airs fantastico-délurés. (Les "doublezons", le "pianocktail", le nénuphar dans les poumons et les autres trouvailles futuristes m'ont parues très factices.)
Mais alors, si tu n'aimes pas le bouquin, pourquoi donc es-tu allé voir la pièce, me direz-vous ? Oui, c'est vrai ça, pourquoi ? Sans doute parce que je suis joueur, toujours prêt (et prompt) à me laisser convaincre, et aussi parce que j'ai été séduit par la bande annonce.
Me voici donc en cette fin août, ravi d'aller au théâtre, et surpris de voir que le spectacle affiche complet, oui oui, vous avez bien lu, complet ! Une salle comble, incroyable, je n'avais pas vu cela depuis le monde d'avant. Il faut croire que le bouche à oreille a fonctionné à plein pour cette pièce qui joue les prolongations jusqu'à mi-octobre.
Il faut dire que ce spectacle présente d'indéniables qualités. Les jeunes comédiens (le spectacle est un projet de fin d'étude du Cours Florent) donnent tout ce qu'ils ont : ils chantent, dansent et virevoltent dans un tourbillon d'énergie à la Jim Carrey qui enthousiasme le public... sauf moi.
Pour ma part, j'avoue être passé à côté de la pièce et avoir été quelque peu fatigué par ce débordement de vitalité endiablée (et à mon avis un peu surjouée). Pour autant, je ne regrette pas d'avoir vu ces jeunes comédiens faire leurs premières armes sur scène. Et j'ai vraiment apprécié le personnage du Docteur, que j'ai trouvé assez irrésistible.
Jusqu'au 16 octobre 2022
Théâtre du Lucernaire, Paris VIème
Du mardi au dimanche, à 16 et 19 heures
Durée 1h15

Trois mille ans à t’attendre, George Miller

Georges Miller est le réalisateur de la saga Mad-Max ; on pouvait donc s'attendre à ce que son dernier film soit un tantinet bourrin ; en réalité, il n'en est rien. Au contraire, Trois mille ans à t'attendre est une sympathique bluette sur fond de récit fantastique.
L'histoire : Alithea Binnie ( incarnée par Tilda Swinton) anime des conférences au cours desquelles elle explique que la mythologie et les histoires - qui nous servaient jadis à expliquer l'inexplicable - ne servent plus à rien quand la Science explique à peu près tout. En l'absence de mystère, nous n'avons plus besoin ni de récits fantastiques, ni de croire aux dieux ou autres esprits. Oui mais...
Alors qu'elle débarque à Istanbul, notre conférencière croise des créatures et autres esprits auxquels elle persiste à ne pas vouloir croire. Les choses se compliquent encore un peu lorsque le destin lui fait acheter dans un souk un petit flacon d'où sortira un génie (l'impeccable Idriss Elba) qui, évidemment, lui proposera d'exaucer trois vœux, souhaits qu'elle refusera expressément d'énoncer car, en spécialiste de la mythologie, Alithea sait que les génies peuvent être roublards, et qu'on ne formule pas des vœux impunément.
Qui dit film fantastique dit, en principe, images de synthèse et effets spéciaux à gogo, jusqu'à la saturation. Sauf qu'ici, Georges Miller les manie avec une certaine élégance. Si certaines scènes reconstituées par ordinateur sont impressionnantes, elles ne sont pas là pour elles-mêmes mais au service de l'histoire. George Miller ne cherche pas à impressionner par la forme, mais par le récit ; il ne s'interdit d'ailleurs pas d'user de vieux trucs à la Méliès qui ont un charme désuet. Comme on ne se refait pas, le réalisateur donne volontiers dans le baroque (comme avec ce harem de femmes pour le moins girondes), mais c'est nettement plus regardable que Mad-Max Fury Road par exemple.
Finalement, Trois mille ans à t'attendre est un film est assez simple, il s'agit de deux personnes qui discutent dans une chambre d'hôtel et se racontent leur(s) vie(s). Comme l'une des deux est un génie, un djinn, sa vie fut longue et pleine de rebondissements, ce qui donne l'occasion au réalisateur de ponctuer son récit de fresques baroques, allant de la Reine de Saba et du Roi Salomon jusqu'à nos jours, en passant par Soliman le Magnifique.
Ces Trois mille ans hommage aux Mille et une nuits sont une bluette parfumée à l'eau de rose et à la fleur d'oranger. Comme une pâtisserie orientale, ce n'est pas particulièrement fin, mais ce n'est pas désagréable du tout !
Trois mille ans à t'attendre,
sortie le 24 août 2022.
De George Miller,
avec Tilda Swinton, Idris Elba,
1h48

Bullet Train, David Leitch, Brad Pitt, Sony Pictures

Je l'avoue, j'aime bien Brad Pitt. Aussi, quand je l'ai vu à l'affiche d'un film signé par David Leitch, le réalisateur de Dead Pool, je n'ai pas résisté.
Coccinelle (Brad Pitt), est un tueur en pleine crise de la cinquantaine. Sur les conseils de son analyste à qui il fait sans cesse référence, il est devenu adepte de la non-violence, ce qui ne l'empêche pas d'accepter une mission simple : voler une valise à bord du Shinkansen, le TGV japonais (le Bullet Train, donc). En principe, il doit subtiliser le bagage et descendre à la première station ; mais comme Coccinelle est un poissard de légende, les choses ne vont pas se dérouler aussi simplement que prévu.
Armé de son bob, de ses lunettes et de quelques pétards (non, non, pas des flingues, des pétards), Coccinelle va affronter la foule de tueurs qui peuplent ce train. C'est un réel plaisir de voir Brad Pitt promener sa coolitude légendaire de wagon en wagon, et je ne regrette pas d'avoir fait le voyage avec lui. Les autres personnages sont savoureux et les acteurs font très bien le job, ce qui est plaisant.
Pour le reste, c'est un film américain, pas de doute là-dessus. Les bastons se multiplient, tout le monde meurt (ou peu s'en faut) et l'on n'échappe pas à l'explosion finale tout en images de synthèse. Sous le faux-nez de l'humour, le réalisateur n'en valorise pas moins la vengeance et la violence , comme c'est beaucoup trop souvent le cas dans le cinéma hollywoodien. (Mais quand allons-nous enfin refuser de laisser les américains colporter ainsi leurs valeurs ultra-violentes?)
David Leitch multiplie les hommages et les références, notamment à Tarantino qui lui-même emprunte aux séries B et autres nanards. A un moment donné, le cinéma américain à grand public devrait cesser de s'autocongratuler de la sorte, surtout quand les références n'en valent pas la peine. (Je déteste le cinéma de Tarantino.)
Tout cela est vu et déjà vu. Et en plus, c'est beaucoup trop long. Si vous voulez aller au cinéma cette semaine, je vous conseille plutôt d'aller voir La nuit du 12, de Dominik Moll.
Sortie le 03 août 2022
Durée 127 minutes
Sony Pictures Entertainment

La nuit du 12, Dominik Moll, Haut et Court

Dans le département de l'Isère, Clara, vingt et un ans, est assassinée en rentrant de chez sa meilleure copine. Les enquêteurs de la Police Judiciaire de Grenoble sont dépêchés sur place et commencent sans tarder leur enquête, méticuleuse et ingrate. Clara ayant été brulée vive, les policiers pensent à un crime passionnel. Sauf qu'il apparait assez vite que Clara multipliait les relations intimes, y compris avec des mecs peu fréquentables.
"Il a dit qu'elle était facile?
- Non, il a dit qu'elle était pas compliquée."
Le nombre de témoin, et de suspects potentiels, empêchera les policiers de trouver le coupable (nous sommes prévenus dès l'ouverture du film qu'il s'agit d'une affaire non résolue, il n'y a donc pas de suspense.)
Les interrogatoires sont saisissants. Même lorsque les types paraissent "normaux" de prime abord, leur comportement et leur propos sont hallucinants. L'un d'entre eux, vexé de ne pas avoir l'exclusivité sur Clara, confesse avoir écrit un rap appelant à la "cramer", un autre est pris d'un fou-rire pendant un face à face tendu avec un flic, un troisième se vante de l'avoir "baisée fort".
La clé du meurtre nous est donnée par la meilleure amie de Clara, qui ne comprend pas pourquoi le directeur d'enquête tient absolument à savoir si elle avait, ou non, couché avec un marginal qui ferait un coupable idéal : " Elle s'est fait tuer parce que c'était une fille, voilà, c'est tout". On est alors effrayé de constater que chacun des hommes croisés par Clara pourraient être le meurtrier.
La caméra suit les flics quasiment en temps réel, avec beaucoup de plans-séquence qui ajoutent à la véracité du récit, d'autant que les acteurs sont justes à un point qui impressionne. On connaissait le talent de Bouli Lanners, on est saisi par celui de Bastien Bouillon qui incarne avec profondeur le rôle du jeune chef d'équipe obsédé par cette enquête.
Son obsession est habilement illustrée par ses séances de vélo sur piste, au cours desquelles il tourne en rond, visage fermé et mâchoire serrée. L'affaire Clara lui tourne dans la tête, comme un petit vélo... (et pour une fois que dans un film français, le héros ne va pas à la piscine, on ne va pas s'en plaindre !)
Le film est tourné dans la région de Grenoble, où les paysages peuvent être aussi laids que splendides. Ce contraste colle parfaitement avec l'histoire de ce film où rien n'est simple. Cette fille si jolie et pétillante qui côtoie des mecs repoussants, ces enquêteurs aussi admirables qu'ils peuvent être lourdingues, leur professionnalisme en dépit du manque de moyens, leur implication malgré la lassitude...
"On rédige des rapports, des rapports, des rapports; on combat le mal en écrivant des rapports".
La nuit du 12 est un film sensible, beau et poignant que je vous recommande !
Sortie nationale le 13/07/2022 - En salle depuis le 8 août 2022
Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Johann Dionnet, Théo Cholbi
Durée : 1h54. - Genre : Film noir-policier, thriller

Tout le bonheur du monde, Claire Lombardo, 10-18

Ce roman raconte l'histoire, sur quatre décennies, de la famille Sorenson: David et Marylin, leurs quatre filles et leurs petits enfants. Le premier chapitre est consacré au mariage de Wendy, la fille ainée, en l'an 2000. En quelques pages à peine, on comprend que cette famille est moins parfaite que les apparences pourraient le laisser croire, d'autant que l'arrivée d'un enfant caché va venir encore tout compliquer davantage.
Le livre nous fait allégrement voyager dans le temps, de 1976 à 2016. On passe sans difficulté d'un personnage à l'autre et d'une époque à l'autre. Le récit, bien que non linéaire, est fluide ; la lecture facile grâce à une écriture vive, modeste et drôle.
L'autrice, Claire Lombardo, nous donne une belle leçon sur le couple, et si cet enseignement peut paraitre simpliste voire mièvre, la recette donne envie d'être testée ! Le couple formé par Marylin et David est fondé sur la bienveillance et l'érotisme (ils règlent généralement leurs petits différends à la manière des bonobos).
"Ça peut paraitre étrange (...) mais je pense que le meilleur moyen de faire fonctionner un mariage, c'est de privilégier la bienveillance, même quand on n'en a pas envie. Cela paraît la chose la plus évidente au monde, malgré tout, c'est plus facile à dire qu'à faire, tu ne crois pas?".
Plus généralement, ce roman parle du fait d'être époux, parent, enfant, sœur ou frère. Le récit tire efficacement profit des situations baroques qui ne manquent pas de survenir dans le vase-clos familial.
"Tout le bonheur du monde" parle d'une famille dysfonctionnelle à sa façon ; c'est-à-dire d'une façon assurément sympathique et séduisante.
"Ses parents n'étaient pas normaux, en ce qu'ils semblaient encore terriblement amoureux. Il y avait toujours eu entre eux une adoration réciproque" (page 182) "Il y avait un inconvénient à avoir les parents les plus merveilleux du monde: la culpabilité" (page 381)
On aimerait faire partie de la famille malgré les multiples non-dits, maladresses et autres drames intimes qu'elle recèle. Plus on lit leur histoire et plus on apprécie la compagnie des Sorenson. Ce livre est d'ailleurs très bien fichu, dans la mesure où chaque protagoniste a sa complexité propre et ses parts d'ombre. Alors qu'ils pourraient être horripilants, les personnages sont tous attachants, d'autant qu'ils ne sont jamais caricaturaux..
Sans prétention, ce roman est très agréable à lire et, malgré ses 700 pages, il parait presque trop court !
Paru le 05 mai 2022
chez 10/18 en version Poche (Éditeur originel: Rivages)
716 pages / 10€20
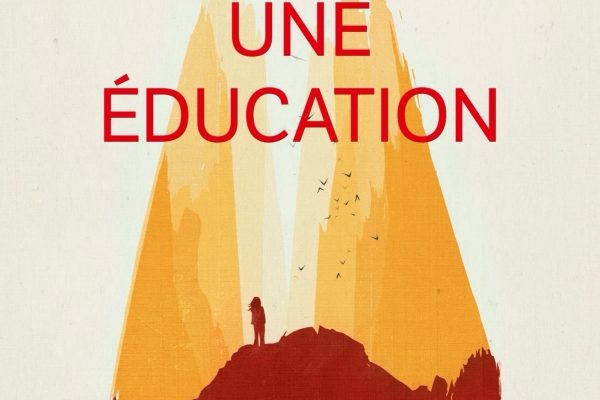
Une éducation, Tara Westover, JC Lattès
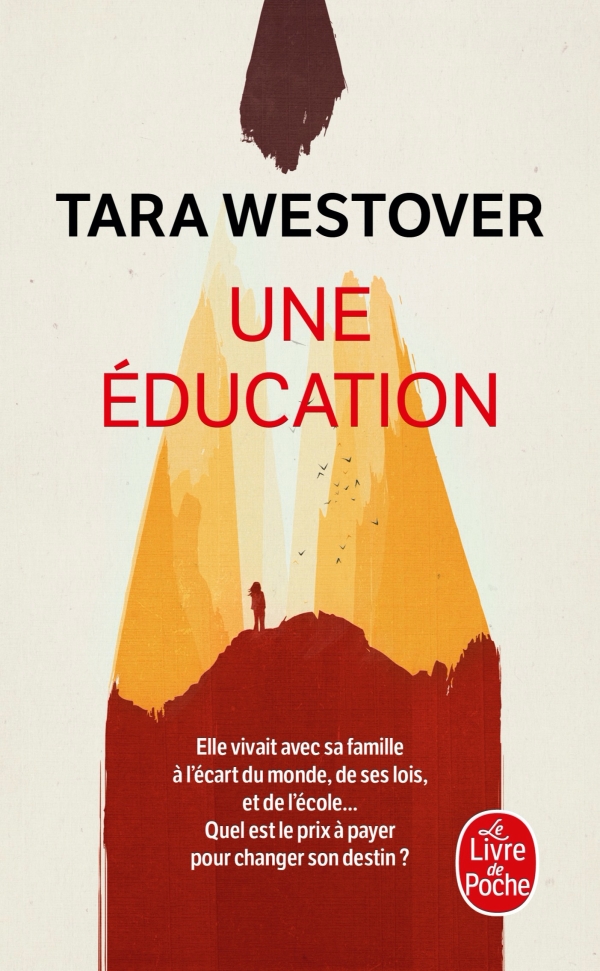
Tara Westover grandit dans une famille de Mormons, dans les années 1990 - 2000. Son père, complotiste et millénariste, refuse catégoriquement que ses enfants fréquentent l'école où leur serait dispensée une éducation socialiste non conforme à ses croyances. La fréquentation des médecins est également proscrite car il mieux vaut s'en remettre à Dieu - qui agit par l'intermédiaire de leur mère, herboriste-guérisseuse et sage-femme. C'est à peine si le patriarche consent à fréquenter le temple et les autres Mormons qui se comportent comme des Gentils.
"Je n'avais jamais appris comment m'adresser aux gens qui n'étaient pas comme nous - ceux qui fréquentaient l'école et consultaient le docteur. Qui ne préparaient pas, tous les jours, à la Fin du Monde. Worm Creek était plein de ces gens-là, des individus dont les propos semblaient venir d'une autre réalité." (page 158)
Peu importe la religion, ce qui importe, c'est le côté dysfonctionnel de la famille Westover et, surtout, l'incroyable façon dont Tara a réussi à prendre le large.
Quelle formidable énergie meut Tara dès l'enfance? Comment elle qui ne sait rien - pas même sa véritable date de naissance (en témoigne cette scène incroyable où sa mère lui soutient qu'elle a vingt ans, alors qu'elle en a à peine seize !)- a pu développer l'envie de tout apprendre?
Tara Westover nous apporte ses réponses, toute en nuance et avec une telle rigueur intellectuelle qu'elle prévient le lecteur lorsque ses souvenirs diffèrent de ceux d'une autre témoin. Car Une éducation n'est pas un roman mais le récit fait par Tara Westover de son enfance et de son entrée dans l'âge adulte.
La vie auprès de son père est à la fois extraordinaire et insupportable. Ce type est un genre de génie autodidacte, capable de résoudre des équations complexes d'une façon toute personnelle. Il est dans le même temps un ferrailleur qui travaille comme un sagouin, mettant constamment son équipe (c'est-à-dire ses propres enfants) en danger. Et lorsque l'accident survient, il refuse qu'ils aillent à l’hôpital. Pire, il reproduit les mêmes erreurs, qui conduisent inévitablement aux mêmes effets catastrophiques.
Pour sauver sa peau (au sens littéral du terme!) il est donc vital de lui résister. Mais toute velléité de désobéissance déclenche les foudres du maître de maison, et cause chez Tara et ses frères et sœur d'intenses conflits de loyauté. Au fond d'elle-même, Tara reste la petite fille qui rechigne à désobéir à son père. Un père n'est-il pas censé être là pour la guider et la protéger?
Quel que soit l'amour qu'elle porte à ses parents, Tara est dotée d'un fort instinct de conservation et d'une ambition exceptionnelle: celle d'apprendre. Lorsqu'elle se tourne résolument vers le monde extérieur, sa famille fait bloc pour tenter de la convaincre qu'elle est une dévergondée, qu'elle est en train de se perdre. Son frère Shawn, particulièrement, exerce son emprise sur elle, soufflant à sa guise le chaud et le froid. Comment dans ces conditions trouver la force de briser les liens, comment échapper à ce qui s'apparente à une secte familiale ?
"Aussi loin que je m'en souvienne, j'étais convaincue que les membres de ma famille étaient les seuls vrais mormons que j'aie jamais connus, et cependant, pour une raison qui m'échappait, ici, dans cette université et dans cette chapelle, je ressentais pour la première fois l'immensité du fossé. A présent, je comprenais: je pouvais me ranger du côté de ma famille, ou du côté des Gentils, dans un camp ou dans l'autre, mais il n'y avait pas d'entre-deux." (page 284)
Au delà du cas personnel de Tara Westover, ce livre traite bien évidemment de la question de la condition des femmes dans les sociétés traditionnelles. Dieu et le Diable sont utilisés pour les museler. Leurs talents ne sont pas reconnus ni valorisés ; ils ne leurs sont pas propres mais ils sont des dons de Dieu, ou des manifestations diaboliques lorsqu'ils pourraient les conduire à s'émanciper. Il leur est même interdit de s'habiller de façon pratique ou confortable (le père en est encore à considérer qu'une femme montrant ses chevilles est une tentatrice, une dévergondée !).
La mère de Tara est talentueuse mais résolument sous la coupe de son mari à qui elle obéit sans faillir. Les femmes doivent se soumettre à la volonté des hommes, fussent-ils complètement fous. En témoigne cette scène incroyable où Tara tente de prévenir la petite amie de son frère, Shawn, instable et violent ; celle-ci lui rétorque:
"Le diable lui impose plus encore de tentations qu'aux autres hommes (...) A cause de ses dons, parce qu'il est une menace pour Satan. C'est pour cela qu'il a des problèmes. A cause de sa droiture si vertueuse. (...) Il m'a avertie qu'il allait me faire du mal. (...) Je sais que c'est à cause de Satan. Mais parfois, j'ai peur de lui, de ce qu'il va faire, ça m'effraie. (...) C'est un homme d'une grande spiritualité" (page 394)
Un jour, l'un de ses professeurs fait à Tara Westover cette magnifique déclaration: "Quelle que soit celle que vous deviendrez, peu importe en quoi vous vous transformerez, vous serez toujours celle que vous étiez. C'était là, en vous, depuis toujours. (…) En vous. Vous êtes de l'or." (page 422)
Et ce livre est une pépite !
576 pages / 8,70€
Date de parution: 14/10/2020
Livre de Poche (éditeur d'origine: JC Lattès)

Parasites, Ben H. Winters, 10-18

Susan se sent un peu à l'étroit dans son appartement new-yorkais. Elle épluche les petites annonces jusqu'à ce qu'elle tombe sur une offre de location pour un duplex bien situé, spacieux et pas trop cher. Il y a même une "pièce bonus" où elle pourrait installer son chevalet pour se remettre à peindre. Heureuse d'avoir trouvé la perle rare, Susan décide sur un coup de cœur d'emménager dans cet appartement avec son mari, Alex, et leur petite fille, Emma.
Bien sûr, on se doute que ce duplex en plein Brooklyn est trop beau pour être vrai. Sadique, l'auteur entretient le suspense et joue avec nos nerfs pendant un bon moment. La charmante vieille dame propriétaire des lieux - qui vit au rez-de-chaussée de la maison - n'est-elle pas trop polie et attentionnée pour être honnête? A bien y bien réfléchir, son homme à tout faire n'est-il pas inquiétant lui-aussi ? Pourquoi les locataires précédents ont-ils quitté un tel bon plan ? Qu'est-ce qui a bien pu piquer Susan ?
Le titre original du roman (Bedbugs, punaises de lit en anglais) nous met sur la voie. Il y a aussi un indice sur la couverture du livre : le titre est écrit en noir, avec des tas de reflets brillants de vilains petits insectes. C'est joli... mais assez flippant !
A force de chercher la petite bête, Susan se retrouve totalement obnubilée à l'idée d'héberger ces fameuses punaises de lit dont tout le monde parle. Son inquiétude vire au cauchemar et son obsession devient maladive. "Elle avait l'impression que les punaises se moquaient d'elle, qu'elles la torturaient, comme si elles avaient décidé qu'elle, et elle seule devait être punie." (page 185)
Lire Parasites, c'est comme regarder un bon vieux film d'épouvante. C'est écrit sans prétention mais c'est redoutablement efficace. On ne s'arrête pas de lire tant on est impatient de voir arriver la catastrophe. On est servi !
Un bon divertissement pour l'été!
Paru le 16 juin 2022
Chez 10-18, collection Littérature étrangère
285 pages / 7,90€
Traduction Pierre Szczeciner (Anglais américain)

Abattre la Bête, David Goudreault, 10-18

Grâce au talent de son avocat, celui que l'on surnomme La Bête échoue en hôpital psychiatrique plutôt que d’atterrir en prison. Celui qui (se) trouve toujours une bonne raison de commettre des agressions sauvages n'est pas responsable ; c'est officiel. ("C'est documenté" comme il le dirait lui-même.)
"La psychiatrie, c'est comme la prison, en plus désinfecté. On joue sur les termes pour mettre la main sur des subventions spécifiques, mais au fond c'est pareil. Le trou s'appelle pièce consacrée à l'isolement, la cellule se nomme notre chambre, les menottes s'appellent médication et la détention s'appelle thérapie, mais faut pas se tromper, c'est la même violence psychologique, la pire: l'enfermement de l'homme par l'homme." (page 24)
La Bête rêve de s'évader car il est persuadé que retrouver sa mère lui apporterait la stabilité. La première scène, celle où il s'échappe de l’hôpital, est très rythmée et assez tordante. Le reste du livre continue sur le même mode.
"Rares sont les occasions de se divertir à l'Institut universitaire de psychiatrie ¨Philippe-Pinel. Privé d'alcool, de drogue et de pornographie, faut se rabattre sur la médication et la violence. L'humain est créatif de nature, et je suis très humain." (page 11)
David Goudreault aligne aphorismes, zeugmas et saillies aussi drôles que de mauvais goût. On croirait lire une chronique radio qui s'étirerait sur près de 200 pages. L'auteur manie avec délice l'argot québecois, une langue mêlée d'anglais (les couples qui se frenchent dans la rue...) et ponctuées de jurons religieux (tabarnak, crisse, ostie etc. ; un glossaire figure à la fin du livre si vous êtes perdus).
Avec son débit de mitraillette, La Bête tire sur tout le monde : les femmes, les noirs, les asiatiques, les homosexuels, les flics bien sûr. "De toute façon, je ne suis pas sexiste ni raciste, moi, je méprise tout le monde égal." (page 124) C'est savoureusement politiquement incorrect, même si l'auteur n'ose pas franchir la limite de certains tabous. Si vous aimez l'humour trash et le second degré, vous rirez à chaque page.
"Tout s'emboîtait, comme des poupées russes ou des échangistes." (page 96)
C'est amusant, c'est réjouissant, ça se lit rapidement ; c'est donc un livre parfait pour un voyage en train vers votre lieu de vacances. Pour autant, si les cent premières pages se lisent facilement, le récit devient un peu longuet. Sincèrement, cet opus ne m'a pas donné envie de lire l'entière trilogie que vient clore Abattre la Bête.

Blackwood, Michael Farris Smith, 10/18
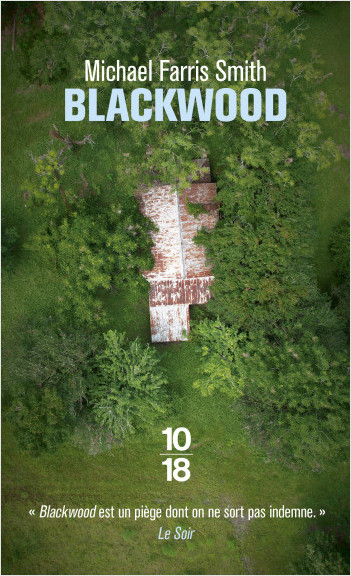
La scène d'ouverture est tout simplement époustouflante. L'un des meilleurs premiers chapitres qu'il m'ait été donné de lire. Une scène entre un père et son fils, Colburn, dans le Mississippi en 1956. Une scène sinistre et dure, d'une dureté de diamant. Froide et choquante. Il ne faut pas plus de quatre pages à Michael Farris Smith pour nous saisir à la gorge.
Vingt ans plus tard, Colburn reviendra dans ce bled du Mississippi où il a passé une partie de son enfance et où son destin croisera celui d'un gamin qui y a atterri par hasard. Le deuxième chapitre nous propulse en effet en 1976, avec un couple de paumés accompagnés de leur fils d'une dizaine d'années, leur fils devenu unique après qu'ils ont littéralement laissé leur bébé sur le bord de la route, sans le moindre scrupule.
Par certains côtés, Blackwood tient du polar. La noirceur y est. Le shérif aussi, un shérif aussi attachant qu'il est peu causant, et qui forme un vieux couple épatant avec sa femme. Le personnage inquiétant y est. L'ambiance y est, une ambiance très particulière, celle d'une ville noyée sous le kudzu, une plante grimpante et envahissante qui recouvre les collines et la vallée et sous laquelle disparaissent les maisons. Ajoutez à cela des souterrains oubliés et des voix intérieures, et vous comprendrez que le drame n'est pas loin d'y être, lui aussi.
On a parfois du mal à savoir s'il y a vraiment des fantômes dans le coin. En tout cas, il ne fait aucun doute que les personnages sont hantés. Hantés par leurs démons, hantés par leurs traumatismes, hantés par leurs amours impossibles.
"Il mangeait rarement. Il dormait rarement. Une créature de la vallée. Le roi de son propre royaume sous les vignes. Il était dans un état de constante exploration, se demandant s'il y avait d'autres secrets. D'autres réponses. Car c'était ce qu'il croyait avoir découvert. Sa vie jusqu'au moment où il avait commencé à entendre la voix rien qu'un grand vide de question." (page 94)
Le style de Michael Farris Smith est sobre, une écriture à l'épure. Mais si les chapitres sont courts, le livre est d'une densité telle qu'il ne se lit pas en deux minutes ; il requiert une certaine concentration. L'auteur a un talent fou pour ramasser tout un tas d'images en à peine quelques mots. Ainsi, par exemple, lorsqu'un personnage fait le tour des fermes pour récupérer de la ferraille, Michael Farris Smith résume tout un monde en moins de dix lignes:
"Vous pouvez le prendre, mais je le regretterai un jour. Les différentes pièces et parties étaient toujours plus que simplement du métal et du fer. Plus que des surfaces couvertes de rouille et de crasse. Pour les hommes, c'était des souvenirs de jours meilleurs ou les suggestions d'un avenir possible dont ils étaient désormais certains qu'il n'arriverait pas. Il emportait leur passé et leurs espoirs, ficelés à l'arrière de la camionnette." (page 41)
On peut dire que Michael Farris Smith a écrit un livre de taiseux !
Date de parution : 19 mai 2022
chez 10/18, collection Littérature étrangère
Fabrice Pointeau (traduit de l'anglais par)

Là où vont les belles choses, Michelle Sacks, 10/18

La couverture et le titre ("Là où vont les belles choses") nous laissaient espérer un récit beau et nostalgique, c'est en réalité une bien triste histoire qui nous est contée par Michelle Sacks.
Dolly a sept ans. Elle joue tranquillement avec Clemesta (son poney en peluche affublé d'un nom qui sonne comme un antidépresseur) lorsque son père la saisit et la jette précipitamment dans sa jeep. Ils "partent à l'aventure" rien que tous les deux, lui annonce-t-il ; une aventure dont on sent dès le départ qu'elle recèle quelque chose de louche.
Ayant choisi une enfant comme narratrice de son roman, l'autrice tâche de restituer le phrasé, la langue et l'état d'esprit d'une pipelette de sept ans. A mon avis, ce procédé est légèrement casse-gueule et, d'ailleurs pas toujours très convaincant. A la longue, la lecture du livre est parfois un brin fastidieuse, d'autant qu'il faut attendre 175 pages pour que l'écrivaine cesse (enfin) de tourner autour du drame. Heureusement, les choses s'améliorent nettement dans la seconde moitié du livre. (Le dernier chapitre est bouleversant, bien que l'on ne soit pas totalement surpris par le dénouement.)
Tout au long du livre, la petite new-yorkaise découvre par la vitre de sa voiture un paysage ponctué de mobile-homes posés sur des parpaings, d'églises protestantes aux slogans accrocheurs et de drapeaux confédérés étendards de la fierté blanche. La description de l'Amérique proposée en filigrane est saisissante et vaut le détour.
Ainsi, à travers les yeux d'une enfant, ce livre témoigne de l'effondrement du rêve américain et de la peur du déclassement, avec pour obsession d'échapper à l'obésité, la crasse, la vulgarité et la bêtise. Le paysage défile et nous en apprend finalement beaucoup sur les États-Unis. J'ai été particulièrement saisi par l'image de l'aigle dont le dresseur a coupé les ailes pour l'empêcher de voler. Tout un symbole pour l'emblème de l'Amérique.
Paru le 16 juin 2022
Éditions 10/18, Collection Littérature étrangère
Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Romain Guillou
309 pages / 8,20€

L’octopus et moi, Erin Hortle, 10/18

Jadis, de grands écrivains – américains notamment – évoquaient la beauté des grands espaces avec un style tout en virilité. Avec Erin Hortle, c’est un genre de récit différent qui est proposé, celui de la relation d’une jeune femme cabossée à son environnement (la Tasmanie) ; une relation intime, mais aussi confuse et pleine de contradictions.
« Le monde est plein de sources d’anxiété, se dit Lucy : l’environnement qui se dégrade, le réchauffement climatique, et en plus elle n’a plus rien à se mettre. » (page 186)
La plume d’Erin Hortle se fait transformiste et imite la voix d’humains de genres et d’âges différents, mais aussi de phoques, d’oiseaux ou encore de pieuvres. C’est un livre actuel, qui traite de problématiques d’aujourd’hui telles que le rapport au genre, à l’environnement et aux êtres qui nous entourent, qu’ils soient humains ou non. Les bouseux qui ne sont jamais sortis de leur patelin et les néo-ruraux écolos aiment tout autant leur environnement mais se détestent mutuellement, chacun pensant que l’autre n’a rien compris à la Nature qui l’entoure.
« S’il te plaît, Flo, ne les tue pas, supplie Lucy. Tu sais que ce sont des femelles qui essaient de trouver un endroit pour pondre leurs œufs. Et puis elles sont intelligentes. Tellement intelligentes ! Plus qu’un chien ! Tu ne tuerais pas une chienne enceinte, quand même !
- Faut pas voir les choses comme ça, réplique simplement Flo.
- Et pourquoi pas, demande Lucy ?
- Mais parce que si on voyait les choses comme ça, on ferait plus jamais rien, non ? » (page 396)
Lucy, le personnage principal, est une battante, mais pas du genre agressif ; elle aime la vie et affronte les difficultés comme elle peut, elle se débrouille, tâtonne, doute, elle rit, elle pleure et on a envie de la suivre. Cerise sur le gâteau, je rechigne tout comme elle à manger un animal aussi fascinant et intelligent que le poulpe !
Le livre fait plus de 400 pages ; c’est un impressionnant travail, surtout pour un premier roman. L’écrivaine Erin Hortle sait faire monter l’intensité dramatique et créer une attente angoissée chez son lecteur. Et s’il est question d’une histoire d’amour et d’attirance adultérine, le propos du livre est bien plus riche et profond qu’une simple bluette. Et la fin, simple et émouvante, est très belle.
Date de parution : 05 mai 2022
Chez 10/18, collection Littérature Étrangère
8,80€ / 432 pages
Traduit par Valentine Leys (Langue d'origine : Anglais, Australie)

Je ne suis pas encore morte, Lacy M. Jonhson, 10/18
Le livre démarre par le récit échevelé de la fuite d’une jeune femme parvenant à s’échapper d’une pièce insonorisée où elle a été séquestrée et violée par son ex-compagnon.
« Je jaillis par la porte, les bras battant telles deux hélices désaxées, titubant comme une femme brûlée vive : les cheveux et les vêtements en flammes. Ou bien je ne titube pas. » (page 9)
Cette fuite n’est que le point de départ de l’histoire traumatique de Lacy M. Jonhson (le livre n’est pas un roman mais le récit d’une expérience vécue). La narratrice raconte combien cet homme soufflait le chaud et le froid sur son existence, alternant tendresse et violence physique pour mieux exercer son emprise, jusqu’à lui faire comprendre l’étendu de son droit sur elle, un droit absolu de vie et de mort.
Il est difficile d’admettre que l’on a été la victime de celui que l’on a aimé ; la raison s’y refuse et le cerveau n’hésite pas à reconstruire certains souvenirs pour rendre les choses moins insupportables. Les années passant, Lacy M. Jonhson tente de se reconstruire et tâche de bâtir une vie saine et équilibrée. Pourtant, malgré les kilomètres et les années, la distance entre Lacy M. Jonhson et son agresseur n’est pas abolie. Les thérapies et les pilules (qu’elles soient jaunes, bleues ou blanches) n’y changent rien : il est toujours là, tapi dans l’ombre de ses cauchemars et de ses angoisses.
Au fond, peu importe qu’elle ait été sa prisonnière pendant cinq heures (la durée du kidnapping) ou deux ans et demi (la durée de leur relation). Ce qui compte, c’est qu’il a tatoué son âme à l’encre de la peur et de l’angoisse, un traumatisme qui reste vivace même après une décennie. De ce point de vue, le témoignage est impressionnant.
La façon distanciée qu’a l’autrice de raconter son histoire est assez troublante. Les personnages n’ont pas de nom, elle les appelle Ma Grande Sœur, Ma Grande Amie, Mon Bel Ami ou encore, et surtout, l’Homme Avec Qui J’ai Vécu. Difficile de dire si cette distanciation rend le livre supportable ou encore plus glaçant !
Date de parution : 21/04/2022
chez 10/18, collection Littérature étrangère
Héloïse Esquié (traduit par)

Léonce et Léna, Georg Büchner, Loïc Mobihan, Montansier Versailles
Le Prince Léonce s'ennuie. Désespérément. Enfant gâté devenu grand, il est revenu de tout et blasé. Son valet, Valério, lui est fier d'être "encore pucelle dans le travail". Il savoure l'oisiveté lorsqu'elle se présente à lui et apprécie plus que tout de ne rien faire. "Le sol n'a pas encore bu une seule goûte de sueur de mon front".
Tandis que Léonce fuit le palais afin d'échapper à un mariage arrangé par son père, sa promise (la princesse Léna) prend elle-aussi la route pour échapper à l'inconnu qu'on voudrait lui faire épouser. Évidemment, les chemins de ces deux-là vont se croiser, et Léonce et Léna vont tomber amoureux l'un de l'autre, réconciliant ainsi l'amour et la raison (d'état).
Si je me suis permets de divulgâcher le dénouement de cette comédie, c'est parce que ce n'est pas vraiment une surprise. Ce importe dans ce drôle de texte de Georg Büchner, où l'oisiveté est le maître mot, c'est de réfléchir à la meilleure façon de remplir sa vie autrement que par le travail.
Les comédiens les plus âgés, s'ils ne tiennent pas les rôles principaux, sont néanmoins excellents. Jean-Paul Muel est impeccable en un vieux roi en pleine confusion, monarque réduit à faire un nœud à son mouchoir pour ne pas oublier son peuple."Quand je parle à haute voix comme ça, je ne sais plus qui parle, moi ou un autre". Et Marc Susini excelle dans le rôle du Président, mutique, raide comme un piquet, et qui prend grand soin de ne jamais contrarier les monarques.
Maxime Crescini (le prince Léonce) et Sylvain Debry (Valério, le valet) tiennent fort bien leur rôle. Quel plaisir de voir ces jeunes comédiens talentueux sur scène; quelle fraîcheur dans la façon dont ils jouent ! Et quel injustice que le public ne fut pas plus nombreux ce douze mai !
Loïc Mobihan, signe ici une première mise en scène dont il n'a pas à rougir. En la quasi absence de décor et d'accessoires, il fait le pari de revenir à l'épure de ce texte drôle et désabusé et de s'en remettre au talent de ses comédiens. Pari gagné !
Les 11, 12 et 13 mai 2022
Au Théâtre Montansier Versailles
de Georg Büchner, traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng, Jean-Pierre Vincent (L’Arche),
mise en scène Loïc Mobihan, dramaturgie Françoise Jay, scénographie Clémence Bezat, costumes Marjolaine Mansot, lumières Anne Terrasse, musique et création sonore Arthur de Bary, mouvement Maxime Thomas, coiffures et maquillages Cécile Larue, masques Célia Kretschmar
avec Maxime Crescini, Sylvain Debry, Jean-Paul Muel, Isis Ravel, Roxanne Roux, Marc Susini

Par une mer basse et tranquille, Donal Ryan, 10/18
Lorsqu'on découvre le titre et l'illustration en couverture du roman, Par une mer basse et tranquille, on s'attend à un récit sur le sort des migrants. En réalité, le livre est tout à la fois plus, et moins, que cela.
Ce livre raconte les histoires assez courtes de trois hommes : Farouk, le Syrien contraint de quitter son pays en guerre, Lampy, un jeune looser irlandais et John, un horrible personnage, corrupteur et diffuseur de fausses rumeurs.
Chacun des personnages est, à sa façon, confronté à la mort. Mais l'écrivain tient l'émotion à distance, il suggère les drames vécus par ses personnages plus qu'il ne les décrit ; on est plus dans le registre de l'évocation que dans celui de la description.
A chaque protagoniste son ton, son phrasé ; la plume de Danal Ryan se fait caméléon avec un brio certain, le tout servi par une traduction fluide et pertinente. Les styles sont si différents que chacune des trois histoires, racontées l'une à la suite de l'autre, pourrait être une nouvelle à part entière.
L'on comprend donc que, dès lors qu'il s'agit d'un roman et non d'un recueil de nouvelles, les destins des protagonistes qu'a priori tout oppose devront en définitive se croiser, s'emmêler et s'imbriquer. Pour parvenir à relier les trois histoires, l'auteur va subitement accélérer le rythme dans un final véritablement haletant.
Même si je reconnais les qualités d'écrivain de Danal Ryan, j'ai été - moi qui aime les narrations au long court - un peu déçu par la brièveté des récits. C'est très bien fichu au plan littéraire… mais, finalement, les histoires m'ont semblé assez artificielles.
Paru le 07 avril 2022
Editions 10/18
Traduction Marie Hermet
216 pages / 7,60€

Les Aventures de China Iron, Gabriela Cabezon Camara, 10/18
Martin Fierro est un grand classique de la littérature argentine ; un poème épique écrit par José Hernandez (1834-1886) et paru en 1872.
Là comme ça, je fais le malin, mais en réalité je n'avais jamais entendu parler de Martin Fierro avant de lire la quatrième de couverture des Aventures de China Iron, un roman signé Gabriela Cabezòn Camara, qui vient de paraître en poche chez 10/18 et qui revisite le mythe de façon farouchement féministe.
China, une orpheline indienne, est recueillie par un couple de noirs. Un soir, elle est donnée en paiement d'une dette de jeu par le mari à Martin Fierro (le fameux, donc).
"Ce vieux fils de pute m'a jouée au truco, Fierro a gagné et à eux deux ils m'ont emmenée par les cheveux à l'église, deux chevaux ont galopé jusqu'à l'exténuation, et ils m'ont mariée. J'ai cessé de parler. Je ne pouvais rien y faire." (page 92)
La voici, à quatorze ans à peine, mère de deux enfants. Par chance, la conscription passe par là et la libère de son mari. S'étant délestée de ses enfants, mais pas de son chien nommé Estreya, China part sur les routes où elle rencontre Elizabeth, une anglaise au port aristocratique qui l'accueille dans une charrette digne du sac de Mary Poppins.
"Quelques jours de charrette, de poussière et d'histoires auront suffit à faire de nous une famille." (page 42)
China est ignorante et Liz lui permet de s'émanciper. Elle lui donne un nom, lui ouvre les frontières du monde et lui offre un horizon, un idéal même.
"Chaque chose que je touchais, ou presque, connaissait davantage le monde que moi et était nouvelle pour moi. " (page 68)
Le récit est servi par une langue riche et complexe, l'autrice alterne des phrases longues - si longues qu'il faut parfois les relire pour les bien comprendre - avec des rafales de phrases courtes et percutantes. Elle mêle également sans vergogne les langues anglaise et espagnole.
" Soudain, tout se calmait, les herbages suspendaient leur va-et-vient - dans les pampa, l'herbage se berce comme les flots -, le silence tombait pesamment sur chaque chose, un nuage noir qui semblait lointain nous couvrait en quelques instants avec ses volutes de gris presque obscur et de gris clair brouillées et gonflées d'imminence, malgré la douce texture qu'elles montraient à nos yeux, nous qui marchions sur la terre, et en peu de temps, celui qu'il nous fallait pour ranger la future viande séchée dans la charrette, elles s'effondraient violemment sur nous, elles éclataient avec véhémence en grillant les arbres et parfois les animaux." (page 65)
Gabriela Cabezòn Camara est sans conteste une écrivaine d'une grande exigence et d'un certain talent (y compris pour les scènes de sexe qui sont assez réussies). Les Aventures de China Iron n'est pas un de ces romans vite écrit et aussitôt oublié. D'ailleurs, l'autrice finit son récit dans une extase exotique, blasphématoire et poétique, à grand renfort de vocabulaire botanique et entomologique (parfois aussi assez indigeste).
"C'est ainsi qu'on a un brugmansia au goût de narã et de mûre, les arbres fruitiers poussent comme des mauvaises herbes à Y pa'û, un thé qui commence par t'aveugler et te plonge aussitôt au plus profond de ton âme, un thé qui t’emmène au centre de l'éclair divin et qui de là te laisse voir que le monde entier est un seul animal, nous et les feuilles d'ypya et les surubis et les kamichis et les girafes et les mantes mamboretà et la passiflore mburucuyà et le jaguar et les dragons et l'opossum micuré et la guêpe camuati et les montagnes et les éléphants et le Paranà et même les chemins de fer anglais et les prairies gigantesques que les Argentins ravagent." (page 205)
Dans ce roman qui tient autant de l'épopée féministes que du western, Gabriela Cabezòn Camara s'attaque joyeusement aux formes classiques de la domination (machisme, colonisation, destruction de l'environnement, genre, tabous sexuels...) et laisse entrevoir qu'un autre monde aurait été possible, eut-il été confié aux femmes.
Je comprends bien le plaisir qu'il peut y a avoir à déconstruire le mythe, que j'imagine volontiers machiste, de Martin Fierro ; mais… Mais quitte à écrire un roman féministe, je ne comprends pas pourquoi Gabriela Cabezòn Camara s'est appuyé sur une histoire ancienne. Pourquoi faire une relecture de Martin Fierro à la sauce LGBTQ+ ? J'aurais préféré que l'autrice raconte, tout simplement, le monde d'aujourd'hui sans ces références que je n'ai pas !
Évidemment, je suis un homme, blanc de surcroit, et c'est donc plein de scrupules et avec un sentiment coupable que je rechigne à aimer cette ode à la diversité. Reste que c'est une drôle d'idée, à mon avis, que de s'appuyer sur une autre œuvre pour écrire un roman.
En tout cas, j'ai hâte de lire un livre 100% Gabriela Cabezòn Camara !
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Guillaume Contré,
Édition L’Ogre et 10/18 pour l'édition en poche
Paru le 7 avril 2022 chez 10/18
216 pages / 7,60€
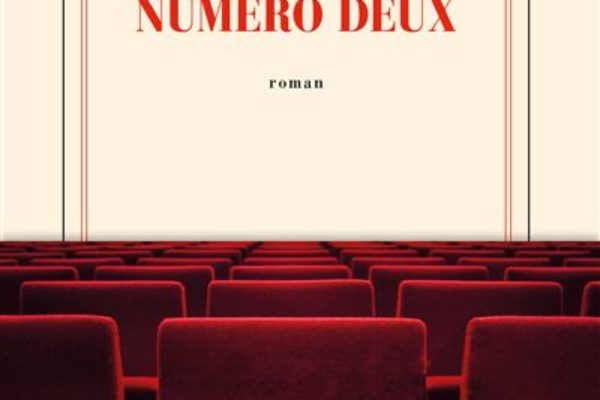
Numéro deux, David Foenkinos, Gallimard
David Foenkinos est un écrivain habile, un auteur reconnu (il a remporté, notamment, le Renaudot et le Goncourt des lycéens, et plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma). Dans son dernier bouquin, intitulé Numéro deux, David Foenkinos imagine la vie de Martin Hill, un garçon qui passa à un cheveu d'incarner Harry Potter au cinéma lorsqu'on lui préféra Daniel Radcliffe en finale du casting.
Manifestement, David Foenkinos cherche à surfer sur la vague Harry Potter et, sans doute espère-t-il ainsi récupérer quelques lecteurs de J. K. Rowling, ce qui n'est pas idiot si l'on a pour ambitionner de figurer dans la liste des meilleures ventes. Il se murmure d'aussi qu'une adaptation au cinéma serait à l'étude. A mon avis, c'est une rumeur infondée qui sert uniquement à la promotion du livre.
Certes, l'idée de départ, l'intrigue, (le pitch comme on dit quand on se veut aussi branché que Thierry Ardisson) est séduisante. Sauf qu'une fois passée la mise en place du personnage - qui est fort bien menée et qui nous accroche agréablement - l'histoire a tendance à tourner en rond.
Certes, ce roman se lit tout seul et n'est pas déplaisant. En vieux roublard de la littérature, David Foenkinos multiplie les accroches (les fameux cliffhangers, comme on dit pour ce genre de bouquin) afin de piquer la curiosité de son lecteur et de le pousser à tourner les pages.
"Il avait raison d'y croire: une solution existait quelque part. il lui faudrait encore du temps, mais il allait la trouver ; et elle serait pour le moins inattendue." (page 162) / "Il comprendrait plus tard pourquoi." (page 172) / "Il lui faudrait attendre encore un peu avant de trouver la solution." (page 205)
L'auteur s'essaie aussi à des formules qui se veulent spirituelles et drôles ("Karim apporta de l'alcool fort histoire d'être plus rapidement faible.", page 206) et nous gratifie de ses considérations mièvres et au ras des pâquerettes sur l'amour:
"Martin avait simplement oublié un élément: il est bien connu qu'il faut arrêter de chercher l'amour pour le trouver." (page 187) / "Sophie devait attendre que Martin fasse le premier pas, sans imaginer qu'en matière amoureuse il n'avait connu que du surplace." (page 208)
S'il était allé un peu plus loin que la simple idée de départ "inspirée de faits réels", David Foenkinos aurait pu écrire un livre bouleversant, un vrai drame. Au lieu de cela, il signe avec Numéro deux un livre divertissant, paresseux et malheureusement peu intéressant. Vous avez sûrement mieux à faire avec 19,50€ que d'acheter ce roman peu inspiré.
Paru le 06/01/2022
Éditions Gallimard, collection Blanche
240 pages / 19,50€

Albert Edelfelt, Lumières de Finlande, Petit Palais
Albert Edelfelt est un peintre finlandais du XIXème siècle (1854-1905). Installé en France, il garda toute sa vie un lien indéfectible avec sa terre natale et acquit en son temps notoriété et reconnaissance internationale.
Aujourd'hui injustement méconnu du grand public, cet immense artiste est mis à l'honneur au Petit Palais, jusqu'au 10 juillet prochain. L'exposition Albert Edelfelt, Lumières de Finlande, qui regroupe une centaine d’œuvres, est très bien faite et suffisamment bien agencée pour qu'on puisse se plonger dans la contemplation d'un tableau sans être gêné par les autres visiteurs.
Le talent me manque malheureusement pour décrire comme je le voudrais la joie qui fut la mienne de retrouver les œuvres de ce peintre que j'avais découvert lors de l’exposition Échappées nordiques, proposée en 2009 par le Musée des Beaux-Arts de Lille.
Portraitiste hors pair, Edelfelt a rencontré le succès et est devenu à son époque un peintre recherché. Il faut dire qu'avec lui, les sujets, comme la composition, sont simples (au sens d'exempts de toute prétention).
Ainsi, le fameux portrait de Louis Pasteur - qui illustre classiquement les manuels scolaires - témoigne de la parfaite compréhension qu'avait Edelfelt de ses modèles.
Lors du Salon de 1886, ce portrait - qui représente le savant au travail, à sa paillasse - a éclipsé celui proposé en même temps par François Lafon et qui était beaucoup plus "officiel" et académique. Le décalage était complet, et le génie d'Edelfelt a sauté aux yeux de tous !

Huile sur toile
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, en dépôt au musée
d’Orsay. Photo © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Martine Beck-Coppola
Heureusement, le finlandais ne se contenta pas du rôle de portraitiste pour gens fortunés. Car, en s'installant à Paris, l'artiste s'est, au contact de Jules-Bastien Lepage, "converti" au pleinairisme, ce courant privilégiant l'observation de la nature et l'étude de la lumière. Et quelle lumière! Les œuvres sont limpides, il n'y a pas d'autre mot.
Chaque été, Edelfelt se rendait en Finlande où il trouvait matière à des scènes de la vie "simple", "authentique" comme on dit. La vie au grand air.
La technique picturale est classique mais irréprochable, que ce soit les huiles ou les pastels. Coloriste virtuose, Edelfelt restitue comme personne la luminosité franche du nord. Il y a toujours un détail d'une infini beauté: un paysage magnifique en arrière plan ou un charmant bouquet de fleur.
Avec toute l'empathie dont il était capable, Edelfelt traduisait en images les émotions de ses sujets, leur peine, leur accablement, leur joie teintée de nostalgie tant le bonheur est fugace. Les peintures témoignent du grand respect que l'artiste avait à l'égard de ses modèles. Qu'ils soient des gens simples ou des personnalités, on sent toute la considération qu'il avait pour eux. Il saisit les regards de façon exceptionnelle. Ah, le regard de la petite Berta qui plante ses beaux yeux bleus droit dans les vôtres ! Et celui de la bonne au Jardin du Luxembourg, toute attendrie par le bébé qu'on lui présente.
A chaque tableau, l'émotion nous saisit. Et si ses toiles sont plus lisses, si la touche est moins épaisse, et si le rendu est plus réaliste que chez les Impressionnistes, Edelfelt n'a absolument rien à leur envier, pas même à Monet (le plus grand d'entre eux, à mon humble avis).
Je parie qu'à peine sorti de l'exposition, vous aurez, comme moi, la nostalgie d'Edelfet et l'envie de très vite le retrouver.
Jusqu'au 10 juillet 2022
Petit Palais, Paris
Plein tarif : 11 euros
Tarif réduit : 9 euros
Gratuit : - 18 ans

Rien de sérieux, Naoise Dolan, 10/18
Rien de sérieux est le premier roman de Naoise Dolan, une irlandaise née en 1992. Aussi espéré-je en le lisant en apprendre davantage sur la jeunesse actuelle. On en a parfois assez de lire des livres écrits par des vieux !
Rien de sérieux conte l'histoire d'Ava, une irlandaise qui a vidé sa "cagnotte IVG" pour s'installer à Hong-Kong où elle enseigne l'anglais BBC à des enfants indigènes, ce qui est un comble pour celle qui parle l'anglais de Dublin et qui découvre certaines règles de la grammaire anglaises en même temps qu'elle les enseigne à ses élèves. Ava est assez solitaire ; elle snobe ses colocataires et ses collègues de travail.
"Mes jours de congé étaient le dimanche et le lundi. En salle de pause, je suis convenue avec mes collègues que travailler le samedi était catastrophique pour la vie sociale alors que je n'en avais pas, ou presque. Mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais avoir du temps pour penser. En outre, la fréquentation du métro aux heures de pointe m'apportait une présence." (p. 124)
Ava rencontre Julian (un banquier anglais au flegme tout britannique), avant de faire la connaissance d'Edith (une jeune avocate Hong-kongaise). Alors s'installe la confusion des sentiments.
Certaines critiques nous vantent la "folle modernité (du roman) sur les relations amoureuses" (Madame Figaro), comme si le questionnement sur l'amour et sur le genre étaient l'apanage des Millenials. En réalité, force est de constater que les jeunes d'aujourd'hui n'ont, au fond, rien inventé.
"On peut très bien se passer de mecs dans la vie, j'y vois même une certaine forme d'élégance, mais la société est ainsi faite que j'ai du mal à assumer ce point de vue. Il faut faire semblant d'être déprimée lorsqu'on reste célibataire trop longtemps. Ça a le don de l'énerver. J'ai bien d'autres raisons de déprimer dans la vie." (p. 42)
Reste que la narration est bien menée et que l'écriture de Naoise Dolan est vive. Le livre est en outre truffé d’anecdotes intéressantes sur la situation peu enviable des femmes en Irlande, sur la domination occidentale, ou encore sur la grammaire anglaise. (Qui a dit que l'anglais était une langue facile ?)
"En Irlande, on écopait de cinq ans pour avoir violé une fille, de quatorze ans pour avoir avorté à la suite d'un viol, et de la perpétuité dans un couvent de la Madeleine pour avoir été violée, sachant qu'il en existait encore au moment de ma naissance. Rien de tout cela n'était la faute des hommes qui me sautaient, mais quand on était une fille, comme moi, cela pesait forcément sur l'état d'esprit lorsqu'il s'agissait de baiser" (p.83)
En décrivant la condescendance des anglais vis-à-vis des autres anglophones, l'autrice nous parle plus généralement de la domination des puissances coloniales (et des hommes blancs) sur le reste du monde, même si certaines réflexions sur les rivalités irlando-britanniques tiennent parfois de la private joke.
Le récit est assez amusant et le livre se lit très bien. A l'image de son héroïne, ce roman est séduisant. J'ai néanmoins fini par le trouver un peu lassant tant il ressasse le thème un brin éculé du je-t'aime-moi-non-plus et de la peur de s'engager.
Rien de sérieux
Roman
Naoise Dolan (Trad. Nathalie Peronny)
Sortie le 4 mars 2022 chez 10/18 Littérature Étrangère
336 pages / 8,20€

Le petit terroriste, Omar Youssef Souleimane, Hervé van der Meulen, Montansier

Au lendemain des attentats de 2015, Omar Youssef Souleimane (un syrien réfugié en France) s'est rappelé sa jeunesse en Arabie Saoudite, où l'enseignement salafiste aurait pu le transformer lui aussi en terroriste. Il en a témoigné dans un roman qui est aujourd’hui adapté au théâtre.
Lorsqu'il était enfant, Omar Youssef Souleimane a vécu quatre ans en Arabie Saoudite, où ses parents, deux dentistes syriens, s'étaient installés. Son père religieux pratiquant s'épanouit dans ce pays berceau de l'Islam et souhaite faire de ses fils de bons croyants:
"Ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de sept ans et frappez-les s'ils la délaissent quand il atteignent l'âge de dix ans."
Oui mais voilà, le petit Omar fait rapidement la prière buissonnière ! La religion, pourtant omniprésente dans son pays d'adoption, ne l'intéresse pas vraiment, d'autant qu'il se rêverait plutôt poète ou Bruce Lee. Sans compter que les interdits religieux pèsent trop sur ses désirs (pré)adolescents.
Or voici que les choses changent avec les attentats du Onze Septembre. Le pays est en liesse tandis qu'Omar éprouve quelque difficulté à se réjouir de la mort d'innocents, fussent-ils américains. Certes, mais Omar entrevoit dans le djihadisme un facteur d'intégration dans une société raciste où il ne fait pas bon être syrien. Et puis, il suit l'exemple de ses parents qui vénèrent Oussama Ben Laden.
"Mange bien, pour devenir un grand djihadiste. Comme Oussama."
Omar se révélera finalement doté d'un esprit trop indépendant et rebelle pour suivre aveuglément un embrigadement religieux.
La pièce est un témoignage particulièrement intéressant et on lui pardonnera bien volontiers ses quelques défauts. (Le texte est assez décousu et tient davantage de la succession d'anecdotes que de la dramaturgie. Le comédien est charmant mais il butte régulièrement sur un texte peu naturel car truffé de passé simple.)
Ce spectacle est montré à des lycéens yvelinois dans le cadre du parcours de lutte et de prévention contre la radicalisation, et s'accompagne d'ateliers d'écritures. Omar Youssef Souleimane fait donc un gros travail d'accompagnement afin d'expliquer qu'il ne s'agit en aucune façon de stigmatiser l'Islam, mais plutôt de démontrer que la foi sincère (quelle que soit la religion) peut être dévoyée et instrumentalisée à des fins violentes. Au théâtre, cette pièce était suivie d'un débat et sympathique et éclairant.
Bravo au Théâtre Montansier qui a produit cette pièce salutaire, intelligente et non dénuée d'humour.
10 & 11 mars 2022
Omar Youssef Souleimane
mise en scène Hervé van der Meulen
son et vidéo Charles Leplomb, lumières Stéphane Deschamps
avec Elie Youssef
Théâtre Montansier Versailles

Connemara, Nicolas Mathieu, Actes Sud
Hélène est une quadragénaire du Grand Est. Douée pour les études, elle a fait une grande école de commerce, est montée à Paris pour tenter de réussir dans le consulting. De retour sur ses terres natales, après un burn-out, Hélène repense à (voire revit) ses quinze ans avec une nostalgie douce-amère.
Prenant le prétexte de la relation entre ses deux personnages principaux, Hélène et Christophe (l'ancienne star du lycée qui, lui, est resté au pays) Nicolas Mathieu entrecroise le présent et la jeunesse d'Hélène ; il alterne ainsi chapitre après chapitre les années 2017 et 1993.
Comme dans son précédent roman (Leurs enfants après eux, lauréat du Prix Goncourt 2018), Nicolas Mathieu raconte la France d'en-bas, ou plus précisément de la France du côté (de Nancy). Il reprend le thème de la vie des "vrais" gens et celui de l'adolescence dans les années 1990.
Nicolas Mathieu a un succès fou parce que ses histoires parlent à beaucoup de lecteurs, ces quadra provinciaux ayant grandi en périphérique d'une ville moyenne (la "France pavillonnaire"). Qu'ils soient restés dans leur province ou qu’ils l’aient quittée pour une métropole, ils sont aujourd'hui revenus de tout après avoir soit assisté impuissants au déclin de leur campagne soit sacrifié leur jeunesse à saisir des tableurs Excel ou à remplir des slides PowerPoint.
Nicolas Mathieu s'attache à démontrer que la vie passe vite. Hier encore tu avais quinze ans, des rêves (raisonnables) plein la tête, te voici aujourd'hui arrivé à la quarantaine sans avoir vu passer ni la vingtaine ni la trentaine, et demain il te faudra vieillir puis mourir. Vous l'aurez compris, Nicolas Mathieu a la nostalgie pas vraiment joyeuse ; il ne fait pas dans l'optimisme mais plutôt dans la désillusion, sans aller pour autant jusqu'à l'aigreur. Il raconte avec compatissance mais sans complaisance la vie de la génération X (cette génération mal définie, coincée entre les Baby boomers et les Millenials) : une adolescence aux allures grunges, une jeunesse professionnelle pleine d'optimisme, un présent assez merdique et un avenir pas vraiment riant.
Moi qui ai sensiblement l’âge de l'auteur, j'ai apprécié les multiples références à l'époque de mes quinze ans autant que le constat lucide sur notre société actuelle. L’écrivain maîtrise très bien son sujet, décrit avec acuité la morosité et l’ennui de la jeunesse et réussit même les scènes de sexe (sujet casse-gueule s’il en est).
J'ai aimé lire ce livre dont j'ai dévoré les 400 pages quasiment d'une traite. Oui mais voilà, lorsque je l'ai refermé, un je-ne-sais-quoi me turlupinait.
C’est qu’en arrière-plan, on devine tout le "métier" de Nicolas Mathieu, ses trucs d'écrivain. Ainsi, il choisit avec soin les noms de ses personnages. Il choisit aussi soigneusement son vocabulaire, qu’il soit opérationnel (EBITDA, k€, slides etc.) ou qu’il s’agisse d’un langage plus châtié ("pusillanime", "commensal", "l'orbe massif du crâne", "ses deux séides convinrent qu'il était temps de se replier sur le buffet", "zélotes", "enguirlander", "panoptique", "méphistophélique" etc.) ; ce n'est pas désagréable mais, comment dire, ça veut trop "faire" écrivain. La construction narrative est, quant à elle, presque trop parfaite techniquement pour que l'histoire nous émeuve en profondeur.
Connemara est presque trop bien écrit !
Nicolas Mathieu
EAN : 9782330159702
400 pages, 22€
Actes Sud (02/02/2022)

La Seconde Surprise de l’Amour, Marivaux, Françon, Montansier Versailles
La Marquise, jeune veuve ayant perdu l'Amour de sa vie, fait le serment de plus jamais aimer ("mon veuvage est éternel"). Lisette, sa servante dévouée et optimiste, fait pourtant tout son possible pour lui faire oublier son chagrin.
"LA MARQUISE.
Il est vrai que votre zèle est fort bien entendu ; pour m'empêcher d'être triste, il me met en colère.
LISETTE.
Eh bien, cela distrait toujours un peu : il vaut mieux quereller que soupirer
LA MARQUISE.
Eh ! Laissez-moi, je dois soupirer toute ma vie.
LISETTE.
Vous devez, dites-vous ? Oh ! Vous ne payerez jamais cette dette-là ; vous êtes trop jeune, elle ne saurait être sérieuse"
Le Chevalier lui aussi est en deuil ; sa bienaimée est entrée dans les ordres pour échapper à un mariage arrangé avec un autre. Lui aussi se voudrait inconsolable, mais c'est sans compter sur les intrigues de Lubin, son valet, qui se met en tête de marier son maitre à la Marquise afin de lui-même se rapprocher de Lisette.
Il saute aux yeux dès le départ que la Marquise et le Chevalier sont épris l'un de l'autre. Chacun, voyant l'autre inconsolable d'avoir perdu un amour, l'estime donc capable d'aimer d'une façon absolue... et ne l'aime que davantage pour cela. Mais comme avouer son amour reviendrait à démontrer qu'on ne sait soi-même pas aimer, puisqu'on est capable de passer outre son amour perdu, il ne faudrait en aucun cas (s')avouer ses inclinations.
Au cas où vous ne m'auriez pas suivi, je résume: le Chevalier et la Marquise s'aiment mais n'osent se l'avouer.
Il s'ensuivra évidement des quiproquos et des rebondissements cocasses et très amusants, le tout servi par une langue classique et riche. Les imparfaits du subjonctif fusent: "que vous fussiez, crussiez, honorâtes, connussiez, avant que vous n'arrivassiez, je souhaiterais que vous restassiez" etc.
La mise en scène d'Alain Françon est, elle aussi, très (voire trop) classique. Le décor est archétypique du théâtre, sans invention aucune, même s'il est aussi beau que simple. Le jeu des acteurs est, lui aussi, sans surprise. Les comédiens jouent toujours face au public, même dans les dialogues ou les soliloques. Nous sommes donc résolument au théâtre, et c'est tant mieux.
On passe un agréable moment. Les comédiens sont talentueux, avec une mention spéciale pour les servants : Suzanne De Baecke incarne une Lisette pétillante et Thomas Blanchard excelle dans le rôle du valet. Par contre, le Marquis joue si mal et il est si raide que cela ne peut être qu'un fait exprès ; étonnant parti-pris...
La Seconde Surprise de l'Amour telle que proposée par Alain Françon est en définitive une pièce d'une fort belle facture, très classique. Dommage qu'elle manque de sel.
Jusqu'au 18 février 2022
Durée 1h50 / de 5€ à 39€
texte de Marivaux
mise en scène Alain Françon assisté de David Tuaillon, dramaturgie David Tuaillon, décor Jacques Gabel, lumières Joël Hourbeigt, costumes Marie La Rocca, musique Marie-Jeanne Séréro, chorégraphie Caroline Marcadé, coiffures et maquillages Judith Scotto, son Léonard Françon
avec Thomas Blanchard, Rodophe Congé, Suzanne De Baecke, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, Georgia Scalliet
production Théâtre des nuages de neige
coproduction Théâtre du Nord-Lille Tourcoing, Théâtre Montansier-Versailles
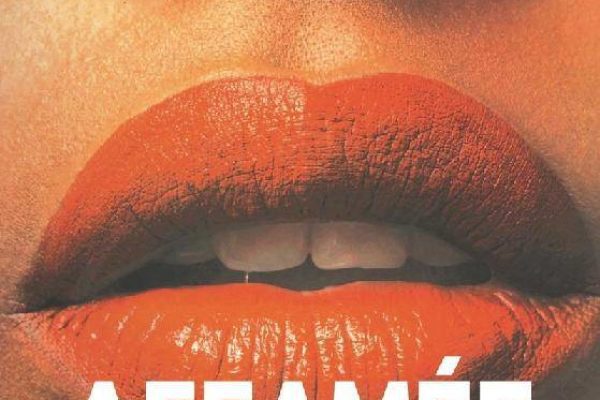
Affamée, Raven Leilani, Nathalie Bru 10/18
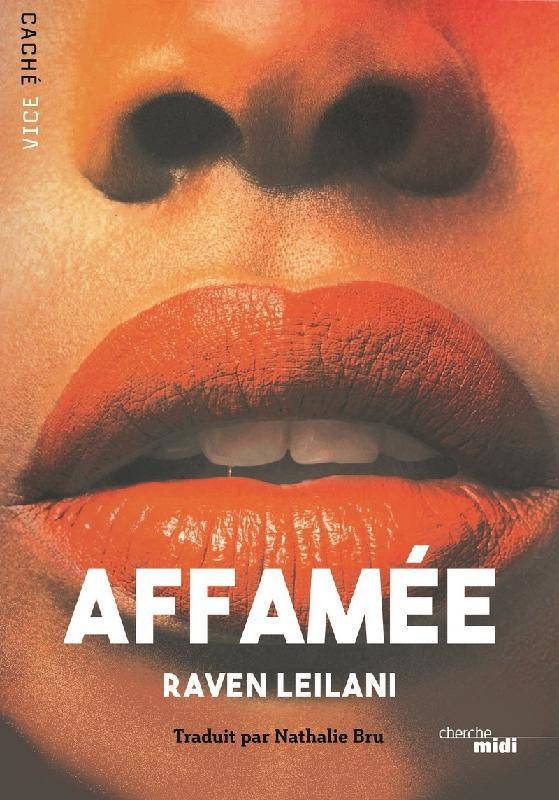
Edie est une afro-américaine dans un monde de blancs. Elle vit dans une coloc' du genre taudis (avec les cafards qui vont avec...). Au boulot, elle multiplie les erreurs : trop noire, trop grosse, elle a fait une fac au rabais (avec les emprunts étudiants qui vont avec...), elle n'est pas assez motivée, et en plus elle a couché avec tous les mecs.
Lorsqu'elle fait la connaissance d'Eric sur une appli de rencontre, on ne peut pas dire que ce soit le grand amour mais bon, même s'il est marié, peu disponible et un peu tordu, Edie a trop la flemme pour entamer une relation avec un autre mec. Il n'empêche que cette histoire va peut-être ranimer quelque chose en Edie.
En attendant, elle est totalement blasée et elle (se) traine un peu (voire beaucoup). Pourtant, on a une envie irrépressible de la suivre dans cette vie d'échecs et de désillusions (même si, à vrai dire, sa lucidité mordante lui ait interdit toute illusion).
J'ai aimé ce livre et apprécié le personnage. Car si le thème est éculé (un adultère un peu foireux), l'écrivaine Raven Leilani parvient à raconter cette histoire d'une façon irrésistible.
"Nous nous retrouvons dans le noir, et toutes ces choses insipides et trop généreuses que les hommes sont sujets à proférer avant de jouir ont l'air troublantes et vraies. Des mots tendres, cucul la praline. un vocabulaire qu'on reçoit, belle joueuse, et qu'on renvoie à la volée les yeux fermés. Parce que lorsque c’est fini, lorsqu’il se penche pour ramasser son pantalon, de l'autre côté de la porte il y a un monde avec des embouteillages, la rougeole et nulle place pour ces mots optimistes et capiteux." (page 178)
L'autrice réussit à nous embarquer totalement dans la vie de cette drôle d’héroïne qui est plus battante qu'elle ne veut l'admettre. Toujours à la recherche de quelques dollars, la narratrice enchaine des expériences surréalistes, déshumanisées et désastreuses, que ce soit comme livreuse à vélo ou comme sexcameuse.
"Je laisse tomber les petites annonces et me rabats sur un site de cam-girl respectable, même si j'ai du mal à y connecter mon Paypal et malgré la rareté du trafic. Pendant une demi-heure, je reste assise en soutien-gorge devant la caméra et ne décroche qu'un seul client. Le type passe la majeure partie du temps à lire le journal, puis il le plie et m'envoie un message par le chat qui dit, Suicide-toi, sale pute de négresse. Je me déconnecte et pense au nez de clown." (page 129)
Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce livre n'est pas un manifeste. C'est juste une description de ce à quoi peut ressembler la vie d'un looser magnifique dans le monde d'aujourd'hui.
"Je consulte mes mails: un message des pains Panera qui dit Aucun poste n'est à pourvoir dans la société pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous recontacter prochainement, un message du Ministère de l’Éducation nationale, un message de la Bank of America, un message de ma proprio qui a de mauvaises nouvelles au sujet de ma caution,, un autre d'un prince nigérien et puis un dernier de mon assurance santé qui souhaiterait me rappeler par la présente qu'à la suite de mon licenciement, mes droits à une couverture médicale expireront dans onze jours." (page 159)
Même si ce n'est pas toujours l'éclate, bon sang ce que cela fait du bien de lire un roman de notre époque !
PS: retrouvez un autre regard sur ce livre en cliquant ICI
Cherche Midi Éditions
Paru en poche chez 10/18
le 03 février 2022
237 pages, 7,50€
Traduction Nathalie Bru

Tartuffe, Molière, Yves Beaunesne, Montansier
A l’ouverture de la salle, les comédiens sont déjà sur scène, donnant au spectateur l’impression d’entrer dans le vif de leur vie. Il n’y a pas de décor, les murs noirs de la scène du magnifique théâtre Montansier sont nus. En revanche, meubles et accessoires abondent et occupent tout l’espace scénique, en particulier un magnifique et imposant billard français.
Lorsqu’ils ne jouent pas, les comédiens ne rejoignent pas les coulisses mais restent en arrière-plan du plateau. Le scénographe utilise en effet l’intégralité de l’espace disponible, y compris la salle d’où surgira un personnage.
Étant placé dans les premiers rangs, j’ai malheureusement loupé une bonne partie du jeu en arrière de scène ; il n’en demeure pas moins que l’absence de tableaux de décor fait gagner la pièce en fluidité. Ainsi, l’histoire se déroule en continu, sans interruption pour changer de décor. Nous pouvons donc entrer sans frein dans l’intrigue, comme si nous faisions nous-mêmes partie de la famille, et ce d’autant plus que la pièce est transposée à une époque relativement récente (les années 1960).
Pas de costumes d’époque donc, mais de beaux et élégants vêtements de tweed, très gentleman-farmer. Seul Damis (le fils d'Orgon) fait exception et détonne volontairement avec son milieu social en portant les cheveux gras et une atroce chemise orange. Les lumières tout en clair-obscur renforcent le côté cosy de l’ensemble.
Cette opulence un rien baroque illustre parfaitement la richesse mâtinée de décadence d’Orgon (Jean-Michel Balthazar), le maître de maison, un homme riche et gras jusqu’à l’obésité, qui rêve d’ascèse. Son idéal se matérialise en la personne de Tartuffe, un dévot qu’il admire jusqu’à l’adoration, devenant totalement aveugle à la fausseté et à la rouerie de l’infâme hypocrite qui tente de séduire sa femme de son bienfaiteur.
« Pour être dévot, je n’en suis pas moins homme »
Les comédiens sont talentueux et parviennent à rendre fluide et naturelle leur déclamation d’un texte pourtant ancien et en vers. Les comédiens se donnent sans compter : ils se jettent par terre, se dénudent, se malmènent, se battent et ils chantent (fort bien !). D’une façon générale, le son est soigné ; les voix ne sont pas amplifiées (ça tombe bien, je déteste ça !) et les micros sont uniquement utilisés pour créer des ambiances.
L’ensemble de la distribution est talentueuse (J’ai juste regretté que Johanna Bonnet - alias Dorine - adopte parfois une gestuelle trop moderne, faisant des gestes de rappeur lorsqu’elle se lance dans une joute verbale). L'excellent Nicolas Avinée tient le rôle Tartuffe avec maestria ; avec son charme trouble et sa folie qui affleure juste ce qu’il faut, il transpire le cynisme de façon presque effrayante. Le fait que Tartuffe soit un imposteur n'étant une surprise pour personne dans la salle, le metteur en scène prend le parti, réussi à mon avis, de ne pas montrer comment l'imposteur manipule Orgon. Nicolas Avinée incarne ainsi un Tartuffe chétif et plaintif, au comble de la manipulation, qui hypnotise Orgon sans avoir l'air d'y toucher, presque de façon subliminale.
Scénographie, son, lumière, costumes, interprétation, tout est parfaitement maîtrisé dans ce Tartuffe digne de la Comédie Française. Le metteur en scène respecte la pièce de Molière, il la met à notre portée sans chercher un « truc » pour se l’accaparer et la dénaturer. C’est un très beau spectacle !
Jusqu'au 05 février 2022
Théâtre Montansier-Versailles
de 5 à 39€
de Molière, mise en scène Yves Beaunesne assisté de Pauline Buffet et Louise d’Ostuni
dramaturgie Marion Bernède, scénographie Damien Caille-Perret, lumières César Godefroy, musique Camille Rocailleux, costumes Jean-Daniel Vuillermoz, chef de chant Hugues Maréchal, chorégraphie des combats Emilie Guillaume, maquillages et coiffures Marie Messien
avec Nicolas Avinée, Noémie Gantier, Jean-Michel Balthazar, Vincent Minne, Johanna Bonnet, Léonard Berthet-Rivière, Victoria Lewuillon, Benjamin Gazzeri-Guillet, Maria-Leena Junker, Maximin Marchand et Hughes Maréchal (claviers)
production Compagnie Yves Beaunesne
coproduction Théâtre de Liège, les Théâtres de la ville de Luxembourg, CDN de Poitiers-Nouvelle Aquitaine, Théâtre Montansier-Versailles, Albi-Scène nationale, Théâtre de Nîmes, Théâtre Molière-Scène nationale archipel de Thau, L’Azimut-Antony-Châtenay-Malabry

Les vivants, les morts et les marins, Pia Klemp, 10/18
Pia Klemp est capitaine de navire. Pas n'importe quel navire: un bateau de sauvetage qui vient au secours de migrants partis de Libye sur des rafiots d'infortune pour tenter de rejoindre une Europe qui les rejette, voire qui facilite leur naufrage.
La quatrième de couverture nous vante "un roman engagé, à la langue éblouissante et acérée, dans lequel elle raconte tout". Une langue éblouissante? Jugez plutôt :
"Notre mission est la rébellion enflammée qui monte du cadavre pourri d'une société jadis promesse de justice. Notre engagement est un dernier sursaut d'humanité de ce zombie qui a trahi ses valeurs et s'est trahi lui-même. Les graisses fermentées de sa décomposition deviennent l'huile jetée sur notre feu. La déchéance nous fait avancer, que nous le voulions ou non."
Pour ma part, je vois dans ce livre une collection fort mal écrite de diatribes digne d'une adolescente parlant davantage de son absence de pénis et de sa rébellion que du principal, c'est-à-dire de ceux à qui elle vient en aide. Elle qui n'aime (presque) personne, préfère ne pas voir en eux des êtres humains, d'autant qu'ils ne sont probablement même pas végans.
" Je me demande de temps en temps si ma misanthropie est vraiment compatible avec le travail humanitaire." (p.23)
Qu'on ne s'y trompe pas : je critique ici un objet littéraire et une autrice, pas le travail en mer de la capitaine Pia Klemp à qui je tire mon chapeau (chapeau d'homme blanc favorisé, c'est dire si je suis mal placé pour critiquer).
Pour rendre son personnage de rebelle plus crédible, et choquer le bourgeois, Pia Klemp surjoue la misanthropie, la grossièreté et la vulgarité. Je pense pour ma part qu'elle est, de ce point de vue, une sacrée poseuse.
"La nuit dernière, j'ai poursuivi pendant une heure un bidon en plastique à la dérive. Quoi que ce soit, c'est à huit milles de nous. Ça me laisse amplement le temps de prendre un café et d'aller chier." (p.62)
Lorsque l'autrice nous raconte ses soirées - arrosées et enfumées - passées en compagnie de ses potes végan-rebelles-punk-à-chien, on s'ennuie autant qu'eux. Très donneuse de leçons avec les autres, Pia Klemp n'est pas avare en contradictions avec elle-même. Fustigeant le couple, elle rêve du grand amour et nous saoule avec son histoire de fesses bien cucul ; anarchiste, elle ne tolère qu'un chef à bord: elle-même ; végan, elle aimerait posséder un chien et picole et fume tout ce qui lui passe sous la main (sans trop se poser de questions sur l'origine de ses drogues) etc, etc.
Il faut attendre la page 180 pour qu'elle évoque le vif du sujet et raconte, en quelques pages à peine, une effroyable scène de sauvetage qui prend aux tripes et vous retourne l'âme. C'est sans doute sa pudeur de bonhomme qui lui interdit de s'épancher davantage.
" La tristesse est indéfinissable, elle vient de partout. La vérité honteuse, c'est que je pleure sur moi-même et sur personne d'autre. Il s se sont pitoyablement noyés sous mes yeux, et pourtant je ne pleure que sur moi. Pas pourtant - à cause de ça. Si je m'autorisais à les laisser m'atteindre, je ne pourrais plus être là pour eux. Je ne suis pas asse forte pour ça. Est-ce froid? Déprimant? Peu importe. Je suis un outil, je dois fonctionner." (p.194)
240 pages / 7,50€
Traduction Céline Maurice
10/18

L’homme qui dormait sous mon lit, Pierre Notte, Rond-Point
Une femme (blanche) et un homme (noir) partagent un petit appartement sous les combles. Manifestement, l'hôte trouve son invité bien encombrant et a du mal à supporter sa présence. " Ça fait deux mois que vous êtes là, et vous avez fini le dentifrice ?"
Mais pourquoi tient-elle absolument à ce qu'il reste chez elle, lui qui y est manifestement indésirable ? Très vite, on comprend que la femme perçoit une allocation de l’État pour héberger ce réfugié, ce migrant, cet invité en qui elle ne veut pas voir un homme.
Puisqu'il contribue à assurer sa subsistance (en plus de lui servir d'homme à tout faire), pourquoi lui sape-t-elle méthodiquement le moral et à le pousser au suicide?
"Les lames de rasoir sont sous l'évier, à droite. Les lames de rasoir sont sous l'évier, à droite. Les lames de rasoir sont sous l'évier, à droite."
Intervient une médiatrice censée veiller sur cette drôle de cohabitation. Mais souhaite-t-elle réellement que la situation s'améliore ? A quel jeu trouble joue-t-elle?
"On ne pousse pas les gens par la fenêtre, on les incite - nuance"
C'est par l'humour (noir profond) que Pierre Notte aborde la question de notre indifférence collective au sort dramatique des migrants, des réfugiés, des invités (comment faut-il les appeler? se demande l'auteur), eux dont on préférerait se débarrasser.
On pourrait s'offusquer que l'auteur nous fasse rire de tant de souffrance. Sauf que Pierre Notte est lucide et qu'il ironise sur le théâtre engagé et sur lui-même. Ainsi, il a confié dans une interview "C'est ma honte, quand je vais demander au Roumain qui fait la manche, en loques, tous les jours, au pied de mon immeuble, de baisser un peu sa musique parce que j'écris ma pièces sur les migrants… Mais j'écris, tant pis".
Écrire une pièce sur un tel sujet (le rejet des migrants, la honte de notre époque à mon avis) peut paraitre dérisoire. Car on est bien ici au théâtre ; aucun doute là-dessus : le phrasé et la scénographie en attestent. Sauf que Pierre Notte a le talent de faire sortir ses personnages du cadre, de mettre le rôle du comédien en abyme par d'habiles références à la réalité.
Le texte est mordant, dérangeant et, surtout, très drôle..
Il est servi par une interprétation ciselée. Muriel Gaudin, "l'accueillante", est tout en colère et tension. Lui, Clyde Yeguete, est si mal à l'aise que cela se voit dans son corps. Silvie Laguna, la médiatrice, est irrésistiblement drôle.
Avec son décor minimaliste - des marques au sol figurant le plan d'un petit appartement, et un tabouret pour tout accessoire - la pièce de Pierre Notte pourrait être jouée partout, ce qui ferait le plus grand bien à nos consciences anesthésiées.
Jusqu'au 30 janvier 2022
Théâtre du Rond-Point, Paris.
de 12€ à 38€

Harvey, Mary Chase, Laurent Pelly, Montansier
Aujourd'hui est un grand jour: celui de l'entrée de Clémentine dans le Grand monde. Pour l'occasion, sa mère a convié tout le gratin de la ville. Malheureusement, son oncle Elwood s'invite aussi à la fête, accompagné d'Harvey, son encombrant - bien qu'invisible! - meilleur ami. Humiliée, Clémentine convaincra sa mère de faire interner Elwood. Mais rien ne se passera comme prévu car Harvey va les rendre tous fous.
Le texte est drôle, d'un humour très légèrement mais délicieusement désuet :" Voici ma carte. Si vous la perdez ce n'est pas grave, j'en ai plein".
Avec son doux air ahuri, Jacques Gamblin incarne parfaitement Elwood, ce tendre rêveur qui pense qu'on "n'a jamais trop de copains" et qui s'enthousiasme de tout: "Est-ce que ce n'est pas un endroit charmant?" demande-t-il ainsi en découvrant l'asile de fous où l'on voudrait le jeter.
Mais, si le nom Jacques Gamblin s'affiche en gros, il ne faudrait pas pour autant oublier la dizaine de comédiens dont les rôles sont essentiels: Clémentine (rose bonbon), le jeune psy et son assistante (qui n'osent s'avouer leurs sentiments), l'avocat (troublé par Elwood), l'infirmier (presque imperturbable), le psychiatre (échevelé) etc.
Compte tenu de la qualité de l'écriture et du talent manifeste des comédiens, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi la pièce manquait de rythme au point que quelques spectateurs partent avant la fin. Les blancs qui émaillent la pièce ne sont pas en cause ; au contraire, ces silences volontaires apportent un vrai plus à la pièce. Non, ce qui m'a dérangé, c'est plutôt le manque de fluidité dans le jeu collectif ; chaque comédien joue très bien sa partition, mais isolément. Par exemple, lorsqu'ils sont censés se couper la parole, ils se laissent gentiment terminer leur réplique avant d'embrayer. Tout cela crée des micro-décalages qui étirent la pièce en longueur et lui font, parfois cruellement, manquer de naturel. J'ai fini par apprendre qu'un rôle venait tout juste d'être réattribué. Nul doute donc qu'après une nécessaire petite période de rodage, la pièce devrait retrouver rapidement tout son peps.
Par contre, la scénographie signée Chantal Thomas est incroyable et magnifique ; elle vaut à elle seule le détour. Les éléments de décor mobiles permettent de jouer savamment avec l'espace. Je pense et espère me souvenir longtemps de ces ensembles porte-tableaux-radiateur-bibliothèque, véritables bouts de salon portatifs qui habillent la scène d'une manière élégante et faussement simple. Le placement des comédiens sur l'espace scénique est lui aussi très convaincant et esthétique.
Tout cela fait une pièce bien agréable à regarder. Le public applaudit d'ailleurs avec enthousiasme, et se laisse bien volontiers séduire par Harvey.
18 et 19 janvier 2022
Théâtre Montansier, Versailles
Durée 1h45
Harvey, de Mary Chase, mise en scène et costumes Laurent Pelly, traduction nouvelle Agathe Mélinand, scénographie Chantal Thomas, lumières Joël Adam, musique Aline Loustalot
assistant à la mise en scène Grégory Faive
avec Jacques Gamblin, Charlotte Clamens, Pierre Aussedat, Agathe L’Huillier, Thomas Condemine, Emmanuel Daumas, Lydie Pruvot, Katell Jan, Grégory Faive, Kevin Sinesi

A l’autre bout de la mer, Giulio Cavalli
Lorsqu'un pêcheur trouve un cadavre sur la plage de DF, personne ne s'en inquiète ; après tout, ce n'est que le corps d'un inconnu rejeté par la mer. Lorsque quatre jours plus tard est retrouvé un deuxième cadavre quasiment identique, l'on commence à se poser des questions. Et le lecteur se dit que le livre est bien parti.
Lorsqu'une vingtaine de cadavres, eux aussi visuellement très ressemblants, font leur apparition et que l'on en apprend un peu plus sur la veulerie et l'hypocrisie de la population de DF, l'on se dit que le livre est décidément très bien parti. On apprécie alors le style très particulier de l'auteur, Giulio Cavalli, qui parvient à rendre la lecture fluide tout en écrivant des phrases d'une page de long.
"Nos mercredis sont une aubaine, dit Stincone en rétrogradant car son véhicule couinait comme s'il frôlait le mur du son, nos mercredis me libèrent le cerveau, en ce moment c'est dur pour moi au travail et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, je devrais bientôt trouver le courage d'annoncer que le restaurant à calle Fargione ne marche plus, non vraiment? demanda le docteur Quinto, vraiment répondit Stincone, désormais les gens vont soit à celui du bord de la mer soit piazza Vittoria, ils n'ont pas envie de faire une grimpette de quelques mètres même pour changer de menu, on a perdu le goût des bonnes choses dit le docteur, tu as raison Quinto, c'est ça le problème, on a perdu la culture de dîner pour dîner, on va au restaurant pour se donner une raison de sortir mais jamais le contraire, c'est le progrès selon mes frères, le progrès nous envoie tous au restaurant pour gonfler le défilé, pour nous montrer, "eh vous là, vous nous voyez? on dîne dehors, vous nous voyez? nous entrons exactement ici", et un éclat de rire aux relents gastriques, avec son rire de poitrine Stincone est hilarant, le docteur Quinto disait que c'était quand-même un sacré problème de fermer un restaurant comme ça au pied levé et Stincone confirmait, il allait laisser sur le carreau au moins dix personnes et leurs dix familles, je n'en dors plus la nuit, tu n'imagines pas ma tristesse mais je peux rien faire de plus que ce que j'ai déjà essayé de faire, après il me reste la charité, je ne peux plus les payer, et soudain il se tut en songeant combien la vie est difficile quand elle nous retire une chose qu'on croyait acquise."
*** ATTENTION, DIVULGACHAGE ***
Malheureusement (à mon goût), au lieu d'écrire un livre noir sur le drame des Migrants ou de se lancer dans un polar étouffant et ambitieux, l'auteur croit bon de verser dans le fantastique en faisant se déverser des tsunamis de cadavres sur DF. Giulio Cavalli se lance alors dans une description de la façon surréaliste dont les habitants de la ville se débarrassent de ces montagnes de corps importuns. C'est glauque, éprouvant et je me suis demandé si j'allais réussir à terminer le bouquin. Mais mes efforts ont été récompensés.
Soudain, j'ai réalisé avec effroi que cette horrible histoire n'était qu'à peine une caricature de notre société d'opulence qui accepte sans sourciller que la mer rejette quotidiennement des cadavres sur nos côtes, sans que l'on se préoccupe de savoir qui étaient "ceux-là" ni d'où ils venaient. Les habitants de DF comprendront-ils qu'on ne nie pas impunément l'humanité de ses frères humains?
La portée critique du roman est d'autant plus forte que l'histoire se termine d'une façon assez prémonitoire !
Sortie le 06 janvier 2022 en poche
Editions 10/18
Traduit de l'Italie par Lisa Caillat
216 pages

Matrix resurrections
Je me souviens de la sortie de Matrix à la fin du siècle dernier. Quelle inventivité dans la mise en scène et les effets spéciaux (ah, le fameux Bullet time !), et quelle finesse dans le scénario. Une vraie claque. Un film inoubliable.
Malheureusement, les frères Wachowski ont étiré leur idée sur trois épisodes, multipliant les badaboums, les bastons dans tous les sens et les détours scénaristiques, jusqu’à l’indigestion. Personnellement, je me suis arrêté au deuxième volet, et j’aurais très bien pu en rester là. Oui mais voilà, vingt ans plus tard, je me suis laissé gagner par un brin de nostalgie, et séduire par une bande-annonce relativement prometteuse.
Quelle bonne idée de montrer le héros plongé de nouveau dans la Matrice (comme quoi il n’est pas facile de s’échapper du bocal) et doutant de sa santé mentale. Lui qui dans le premier épisode avait dû choisir une pilule pour accéder à la vérité se retrouve désormais gavé de pilules (d'antidépresseur).
Le début du film est relativement convaincant et l'on pouvait espérer que Lara Wachowski (l’un des frères, devenus sœurs entretemps) ait réalisé un film noir avec une bonne dimension psychologique, dans la veine de ce qu'avaient fait Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman), Christophe Nolan (Batman, the Dark Knight) ou encore Todd Phillips (Joker).
Au lieu de cela, le film tourne très vite au labyrinthe scénaristique foireux avec des bagarres toujours plus rapides et donc de moins en moins regardables. Sortant de sa léthargie, Keanu Reeves finit par se souvenir qu'il sait se battre, et se lance dans la bagarre (qui consiste le plus souvent à faire un bouclier avec ses mains, genre Dragon Ball). S'il y a tout-de-même de très belles chorégraphies de combat, notre bon vieux Neo n'arrive malheureusement plus à décoller. Le film non plus d'ailleurs !
Tout cela est agrémenté de références et d'extraits du vieux Matrix, nous donnant l'occasion de constater combien le film a vieilli.
Le pire est atteint lorsque Neo (Keanu Reeves) rejoint la réalité, c'est-à-dire la ville des rebelles. C'est absolument kitch et ringard. Au son d'une musique aux accents militaires, le film se vautre alors dans une esthétique martiale riche en jeunes gens le doigt sur la couture du pantalon et prêts à mourir pour le monde libre, fut-il merdique. Un beau résumé de l'Amérique, en somme. L'on se prend alors à rêver d'une Matrice qui transformerait tout cela en un film meilleur.
Sortie le 22 décembre 20222
Warner Bros

American Dirt, Jeanine Cummins, 10-18
Dès la première phrase, on est happé par cette histoire à la violence effroyable et saisissante: "L'une des premières balles surgit par la fenêtre ouverte, au dessus de la cuvette des toilettes devant laquelle se tient Luca."
Miraculeusement rescapés d'une tentative de meurtre, Lydia et son fils de 8 ans, Luca, tenteront de fuir le Mexique en devenant Migrants. Avec American Dirt, l'autrice Jeanine Cummins nous plonge dans l'horreur absolue, celle des cartels et de l'émigration, en même temps qu'elle nous convie à un voyage où l'humanité peut, aussi, recéler une solidarité inattendue et de l'amour précieux.
"Je m'appelle Danilo. Quand vous serez arrivées là où vous voulez aller, quand vous aurez un boulot et une maison agréable e que vous rencontrerez un beau garçon, un gringo, que vous serez mariées et aurez des enfants, quand vous serez de vieilles dames et que vous borderez vos nietos dans leur lit, je veux que vous leur racontiez qu'un jour, il y a bien longtemps, vous avez rencontré à Guadalajara un homme sympa nommé Danilo, qu'il a marché avec vous et qu'il balançait sa machette de gauche à droite pour dissuader les crétins d'avoir de mauvaises idées".
La description d'un Mexique gangrené par le trafic de drogue et son cortège de corruption est terrifiante. Aucune couche de la société n'est épargnée, personne n’est digne de confiance, et si les trafiquants savent se montrer séduisants et généreux, ils sont en réalité des brutes sanguinaires jamais repues de violence.
La description de la situation des Migrants est bouleversante. Ce n'est ni par envie ni pour céder à une quelconque chimère qu'ils quittent leur pays , c'est tout simplement parce qu'ils n'ont le choix. Pour tenter d'échapper à la violence qui règne en Amérique du Sud, ils devront – au péril de leur vie - sauter sur un train de marchandises en marche pour tenter de rejoindre le Nord.
"Certains d'entre vous tomberont du train. Beaucoup seront estropiés ou blessés. Beaucoup mourront. Beaucoup, beaucoup d'entre vous seront kidnappés, torturés, victimes de traite ou rançonnés. (...) Seul un sur trois d'entre vous arrivera vivant à destination. Est-ce que ce sera vous?"
Cette enquête en forme de thriller haletant et instructif est addictif ; ce roman est redoutablement efficace et bien écrit. On tourne page après page tant on veut connaître la suite, tant on a envie de savoir si Lydia et Luca vont s'en sortir. Je parie que vous dévorerez les 560 pages sans avoir envie de reposer le livre.
America Dirt,
de Jeanine Cummins
Traduction par Françoise Adelstain et Christine Auché
Éditions Philippe Rey et 10-18 en poche
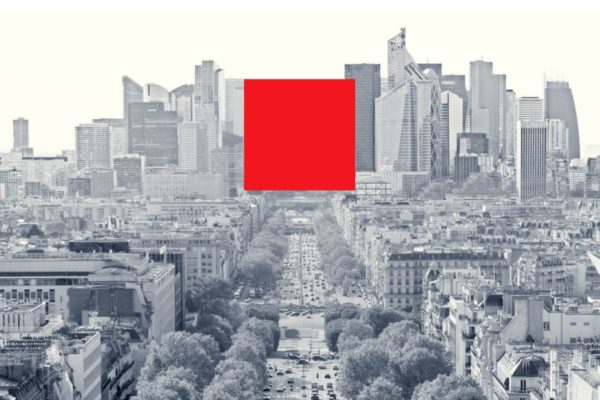
La Grande Arche, Laurence Cossé
Il y a presque trente ans de cela, le quartier de la Défense était loin d'être achevé. Des constructions modernes, dont le CNIT, bordaient alors une immense dalle en forme de boulevard que rien ne venait clore. Un concours international d'architecture fut donc lancé en 1983 pour l'aménagement de la « Tête-Défense » (situé à l'extrémité de l'axe historique parisien). Concrètement, il s'agissait de combler un terrain vague dans le plus grand quartier d'affaires français.
Monarchie républicaine oblige, le Président Mitterrand eut le dernier mot dans le choix du vainqueur.
Surprise lorsqu'à l'ouverture de l'enveloppe anonyme, il apparait que le Président de la République a opté pour le projet de Johan Otto von Spreckelsen, un danois inconnu du tout Paris de l'architecture. Ce professeur d'architecture est avant tout un théoricien et un artiste. Concrètement, il n'a jusqu'alors construit que "(sa) maison et quatre églises".
Très vite, le chef de l'Etat appréciera l'homme tout autant que le projet et l'Architecte, comme Spreckelsen se désigne lui-même (avec une majuscule, s'il vous plait) se croira doté de l'immunité propre au fou du roi. Ne comprenant rien aux méandres de l'administration française, notre danois oublie un peu vite que notre monarque n'est que républicain et qu'il ne peut (et, surtout, ne voudrait pas montrer qu'il a le pouvoir de) décider de tout.
Outre ces complications administratives, Spreckelsen ne veut pas admettre que l'architecture ne se limite pas à un geste et que les chantiers pharaoniques obligent parfois à des compromis avec le réel. On lui adjoindra donc un architecte bâtisseur, français celui-là, qui gérera les aspects techniques de la construction.
C'est une enquête méticuleuse en forme de tragédie que nous raconte l'écrivaine : l'histoire passionnante d'un homme sans compromis sacrifié sur l'autel de la politique.
Une fois commencé, vous ne pourrez plus lâcher ce livre avant de l'avoir fini.
L'écriture de Laurence Cossé est d'une élégance folle et d'une fraicheur revigorante. L'autrice signe une enquête rigoureuse et passionnante qu'elle agrémente de parenthèses et autres digressions parfaitement délicieuses. Elle est ainsi capable d'insérer dans des descriptions éminemment techniques (considérations précises et documentées sur la texture du béton ou sur la portance des poutres) à des anecdotes au ton beaucoup plus personnel (description de sa visite aux archives, ou encore histoire d'une poule rencontrée chez l'un des protagonistes).
" Une enquête est toujours l'occasion de rencontres improbables. La grâce animale, la plume qui a l'air d'une fourrure, les coups de menton d'une orpington aristocratique, ce que véhicule de féérique un oiseau doré, débonnaire et déterminé, la poésie veut qu'on en rende compte."
400 pages / 8,20€
Gallimard - collection Folio
Prix du Livre d'architecture 2016
Prix François Mauriac 2016
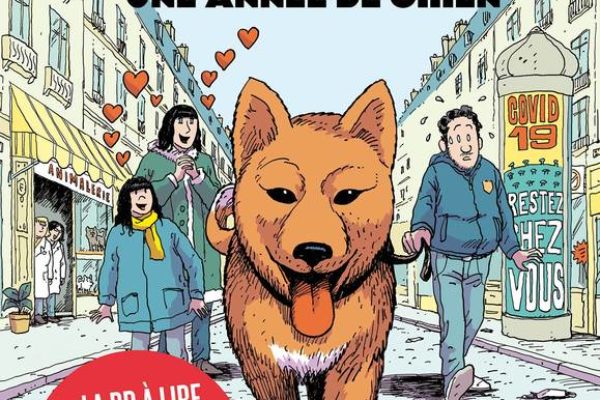
Tiki, une année de chien, Fred Leclerc, David Azencot, la Boîte à Bulles
J'ai aimé cette bande-dessinée dès la première page.
Fred est tout chamboulé par le confinement Covid et il a bien envie de faire plaisir à sa fille et à sa copine. Il se laisse donc convaincre par deux vendeuses d'animalerie sans scrupules d'acheter un chien: Tiki.
C'est vrai qu'il est très mignon ce chiot ; et en plus il pourra servir de prétexte pour sortir pendant le confinement Covid. (Mais siiii, rappelez-vous, les attestations de sortie avec la case "Promenade de son animal de compagnie"!) Ce qu'il n'avait pas prévu, notre bon Fred, c'est qu'il lui faudrait aussi surtout la nuit pour faire pisser son nouveau compagnon. Ce qu'il n'avait pas anticipé non plus, c'est qu'un chien est possessif, pas forcément commode, et qu'il descend du loup (certaines espèce descendant plus vite que d'autres..)..
Dès le premier jour de leur vie en commun, Fred se sent dépassé et commence à se dire qu'il a fait une grosse bêtise, ce qui est bel et bien le cas !
Je tire mon chapeau à l'auteur, Fred Leclerc, qui a l'honnêteté de témoigner sans honte de son expérience afin d'édifier ses lecteurs et leur éviter de faire la même erreur que lui. Le Président de la Société Protectrice des Animaux signe d'ailleurs une postface très intéressante et affirme qu'il s'agit d'une "BD à lire avant d'adopter un animal".
Les couleurs et dessins sont simples mais pas du tout désagréables à regarder, et le récit est mené avec humour, ce qui allège la charge émotionnelle. Ce livre utile ne vous ôtera peut-être pas l'envie d'avoir un animal de compagnie, mais il vous évitera quelques pièges.
Si vous envisagiez de (vous) offrir un animal pour Noël, achetez donc plutôt l'adorable Tiki !
EAN13 9782849534199
ISBN 978-2-84953-419-9
Éditeur La Boîte à Bulles
Date de publication 24/11/2021
Collection BD ADULTE
Nombre de pages 144
Dimensions 26,5 x 19,8 x 1,3 cm
Poids 462 g
19€

Les Elfkins : opération pâtisserie
Les Elfkins, véritables rois de l'artisanat, effectuaient jadis le travail des humains pendant la nuit, du moins jusqu'à ce qu'une horrible mégère ne mette fin à cette harmonie entre les espèces. Depuis, les elfes vivent reclus au sous-sol où ils font des concours d'artisanat et médisent sur les Hommes, ces créatures méchantes et ingrates.
Mais un jour, Helvi, une jeune Elfe - intrépide mais maladroite - décide de renouer contact avec les Humains, sûre qu'ils pourront lui apprendre un métier. C'est accompagnée de deux compagnons qu'elle part à la découverte de notre monde... et de la lumière du jour.
Les trois lutins font bien vite la rencontre d'un pâtissier génial mais bougon qui s'est endetté auprès de son frère, un affairiste ayant fait fortune dans les gâteaux industriels. Mais heureusement, les Elfkins arriveront à point nommé pour mettre un peu de fantaisie et de bienveillance dans le monde des humains.
A l'image des dessins qui sont un peu lisses, l'histoire est sans surprise même si pas du tout déplaisante. Certes, vous ne trouverez ici ni double niveau de lecture ni humour au second degré à destination des parents, et vous vous ennuierez parfois un peu.
Par contre, les enfants trouveront pleinement leur compte dans ce conte tranquille et plein de douceur. J'ai moi-même accompagné un groupe d'enfants de huit ans qui étaient tous ravis et souriants à la sortie du film.
- Et toi Aimé (8 ans), tu as aimé le film ?
- Oui !
- Et qu'est-ce que tu as préféré?
- Tout !
au cinéma le 8 décembre 2021
un film de Ute von Münchow-Pohl
KMBO Distribution
1h18
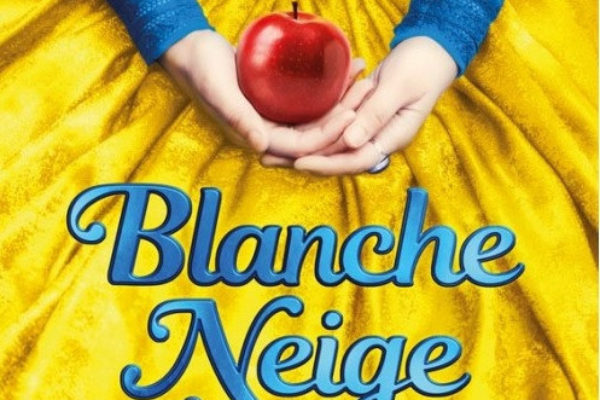
Blanche-Neige, Olivier Soliveres, Gaité Montparnasse
En ce dimanche après-midi, le joli théâtre de la Gaité fait salle comble. Un valet en livrée nous accueille, sonnant la trompette et annonçant les invités à haute voix. Chacun a droit à son petit clin d’œil personnalisé, en particulier les petites filles qui sont venues déguisées... ainsi que les retardataires.
Je ne vais pas vous résumer l'histoire mais simplement vous dire qu'elle est ici mise au goût du jour, avec des décors exclusivement numériques, ce qui ne manque pas d'épater les enfants. "Elle est dans l'écran Blanche-Neige?"
La pièce présente de vraies qualités du théâtre classique (Commedia dell'arte, danse, chansons). Comme souvent, le spectacle contient aussi son lot de blagues à destination des parents. Les références à la culture populaire s'enchainent à un rythme effréné (en vrac, à Abba, Google, E.T., Johnny Halliday, Fort Boyard et j'en passe), avec une mention spéciale pour le petit doigt de la reine "qui a grandi dans une cité médiévale voisine" et qui parle comme un loulou de banlieue.
Le spectacle fonctionne à merveille. Les enfants vivent l'histoire à 100% et - comme dans un bon vieux théâtre de Guignol - ils hurlent à Blanche-Neige de ne pas croquer la pomme. Une petite fille crie même à la Reine: "T'es très moche!"
La pièce repose presque entièrement sur le personnage de la Reine qui est la vraie star du spectacle. Avec sa voix rauque et ses grimaces cartoonesques, la comédienne qui l'incarne est irrésistible. Sa présence et son énergie sont impressionnantes, et l'on ne peut s'empêcher de la comparer à Jim Carrey (lorsqu'il était encore drôle). Et en plus elle chante remarquablement!
Malheureusement, si l'on excepte la Reine et son valet, les comédiens sont peu convaincants. Si Blanche-Neige danse bien, elle n'en demeure pas moins assez falote. Quant au Prince, il joue terriblement à plat. Est-ce un parti-pris de mise en scène visant à mieux mettre en valeur la Reine ? J'avoue à titre personnel, avoir toujours trouvé Blanche-Neige et son Prince assez cucul !
On regrette aussi que le metteur en scène n'ait pas su se dépêtrer du problème des nains. Peut-être aurait-il mieux valu avoir recours à des marionnettes, ou carrément assumer de faire un "Blanche-Neige et les sept géants" ? Toujours est-il que les enfants s'étonnent que les nains soient si grands ! Cette scène est d'ailleurs la seule où le rythme ralentit assez dangereusement (au point que mon voisin de devant s'assoupît...)
"J'aime pas être tous d'accord" dit Grincheux. Eh bien les spectateurs petits et grands, eux, sont tous d'accord pour dire que la Reine est épatante et mérite le déplacement.
Théâtre de la Gaité Montparnasse
A partir de 3 ans
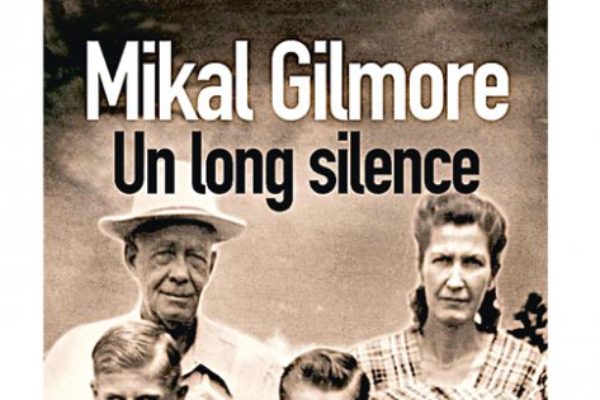
Un long silence, Mikal Gilmore, 10-18
C’est une histoire extraordinaire que raconte Mikal Gilmore ; l’histoire de sa famille. Sa mère Bessie, fille de mormons, tombe amoureuse de Franck, l’ex-petit ami de l’une de ses copines, un homme qui a l’âge de son père et qui déteste les mormons. Ils badinent gentiment jusqu'à ce qu'il lui annonce soudainement qu’il doit se marier le lendemain avec une autre femme!
Un an plus tard ils se croisent à nouveau, pour ne plus se quitter même si, à peine mariée avec Franck, Bessie apprend que son mari n’en est pas à son coup d’essai et qu’il a essaimé des familles un peu partout dans le pays, abandonnant sans scrupules plusieurs femmes et de nombreux enfants. Pourtant, Bessie suivra son mari dans sa fuite perpétuelle.
Ce tourbillon ne s’arrêtera jamais réellement, même lorsqu’ils finiront enfin par poser leurs valises. Car Franck Gilmore a toujours la bougeotte. Et il ne supporte pas qu’on lui résiste ni que l’on conteste son autorité.
La violence psychologique et physique (violence dont Bessie n’est pas exempte) qui règne chez les Gilmore marquera profondément les enfants de Franck et Bessie.
« Franck Gilmore et Bessie Brown étaient deux êtres pitoyables et misérables. Je les aime, mais je dois dire ceci : c’est une tragédie qu’ils aient eu des enfants » (p. 383)
Pourquoi Bessie n'a-t-elle pas pris ses jambes à son cou dès le début ? Pourquoi reste-t-elle avec ce menteur compulsif doublé d’un escroc minable ? Pourquoi ne quitte-t-elle pas ce menteur violent et instable à qui il arrive de disparaitre subitement (il n'hésite pas à laisser sa femme et ses trois fils en plan dans un restaurant minable ou au bord d’une route de campagne)? Et pourquoi avoir quatre enfants avec un tel individu ?
En n’apportant pas de réponse aux énigmes familiales, Mikal Gilmore donne une dimension universelle à son livre. La narration forte et puissante impose le respect. Ce récit est salutaire et riche d'enseignement pour tous ceux qui ont grandi au sein d’une « famille » dysfonctionnelle.
« Parfois nous acceptons une liaison malheureuse, et (…) nous ne nous imaginons pas en dehors de ce malheur. Il fait partie de notre identité. L’idée d’abandonner le malheur devient plus effrayante que la perspective de vivre avec. On risque de ne plus savoir qui on est si on quitte cette dynamique – on risque de devoir se reconstruire entièrement. »
Le destin des Gilmore est si fascinant qu’il inspirera un grand livre à l'immense Norman Mailer (« Le Chant du bourreau » relate l’histoire de Gary et permettra à Mikal d’en savoir un peu plus sur sa propre famille). Gary, l’ainé, sera condamné pour meurtre et exigera d’être fusillé alors que les Etats-Unis avaient renoncé à appliquer la peine de mort depuis dix ans. Gaylen, le troisième de la fratrie, finira lui aussi dans des circonstances violentes.
Si l’histoire des Gilmore est incroyable, elle est aussi terriblement banale. Racontée d’une autre façon, cette longue suite de malheurs pourrait être insoutenable. Mais Mikal Gilmore raconte l’histoire de ses parents et de ses frères avec une franchise et une sobriété remarquables et pleines d’un espoir doux-amer. Car Franck Junior (le deuxième) et Mikal (le petit dernier de la famille) échapperont à ce qui ressemble à une malédiction familiale, même s'ils n'en sortiront pas tout à fait indemnes. Par chance, Mikal perdra son père trop tôt pour avoir eu le temps de le décevoir (car le paternel fait payer cher sa déception). Par chance, Mikal ne croit pas aux fantômes qui hantent sa mère et la maison familiale. Par chance, ces frères s'aiment, envers et contre tout.
Trop de zones d’ombre demeurent pour que Mikal puisse comprendre les motivations des membres de sa famille. Il les observe pourtant avec bienveillance et mansuétude, sans les juger. Ce faisant, l’auteur rend son histoire non seulement supportable mais aussi passionnante.
C’est une tragédie férocement sublime, une ode à la fraternité où le héros s’arrache à son destin et parvient à absoudre les siens pour accéder à une forme de paix.
Un Long Silence
Mikal Gilmore (traduit de l'américain par Fabrice Pointeau)
10-18
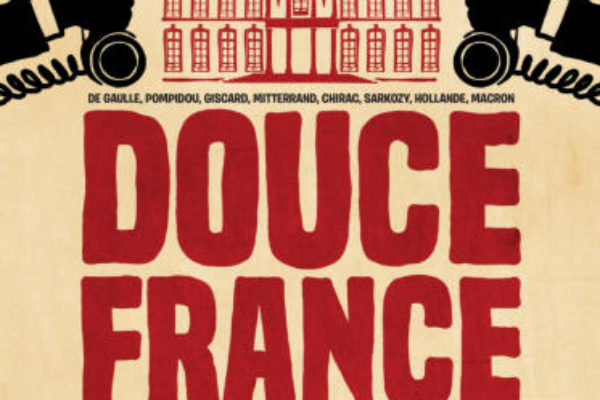
Douce France, Stéphane Olivié Bisson, David Salles, Tristan Bernard
Le ravissant théâtre Tristan Bernard se transforme en Palais de l’Elysée. Nous sommes pris en charge par une conférencière (Delphine Barril) qui, à l’occasion des Journées du Patrimoine, va nous faire visiter un endroit incroyable : le bureau de Capucin (l’excellent David Salles) et Pierre-Marie-Joseph (Stéphane Olivié Bisson), deux conseillers du Président de la République depuis quelque 120 ans et qui vont nous faire revivre toute la Cinquième République!
Ce spectacle intéressant, rythmé et extrêmement drôle dure 55 ans mais l’on ne voit pas le temps passer. On est pris dans un tourbillon d’anecdotes auxquelles on a parfois du mal à croire tellement elles sont énormes. L’objectivité est pourtant respectée car nos deux conseillers spéciaux sont apolitiques (Pierre-Marie-Joseph tient bien à préciser qu’il n’est pas de gauche, tandis que Capucin n’est pas de droite, lui qui fut jadis tenté par le maoïsme. « On ne se trouve pas sans commencer par se perdre ».).
Tout est vrai et c’est bien là le pire de l’histoire. On choisit de rire à gorge déployée mais on pourrait aussi en pleurer. Car tandis que les chiffres du chômage grimpent inexorablement, aucun Président n’est épargné par son propre ridicule : De Gaulle qui aborde 1968 avec confiance dans ses vœux télévisés, Giscard et sa passion pour la chasse (dont la chasse à l’ours… du zoo de Bucarest !), Mitterrand et ses caprices de milliardaire (sommet du G7 à Versailles avec serveurs déguisés en laquais et perruques poudrées, chabichou du Poitou que l’on envoie quérir en jet privé...), Hollande dont l’état de grâce dure 10 minutes, etc. etc.
Sincèrement, j’ai rarement vu un spectacle aussi drôle ; c’est bien plus drôle que la plupart des one-man-shows, et les comédies de Boulevard à la papa peuvent aller se rhabiller. Douce France est vraiment un spectacle passionnant et hilarant !
A partir du 07 octobre 2021
Théâtre Tristan Bernard
du mardi au samedi à 21h (Relâches les 18 et 19 novembre)
PS : en ce moment, le Tristan Bernard vous offre une place si vous achetez une place plein tarif. Alors contacter vite le Théâtre. Réservation au 01 45 22 08 40
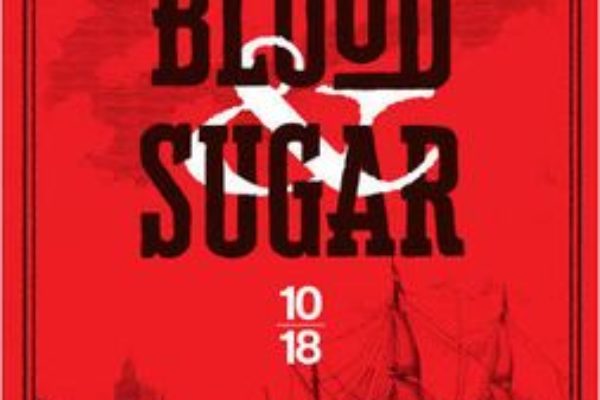
Blood & sugar, Laura Shepherd-Robinson, Traduit par Pascale Haas, 10-18
A la fin du XVIIème siècle, l'esclavage et la canne à sucre font la fortune de l'Angleterre, et plus particulièrement de la ville de Deptford où un militaire mène l'enquête pour découvrir qui a torturé puis tué son meilleur ami. Ses investigations le mèneront sur la piste de marchands et d'armateurs qui s'enrichissent grâce au commerce d'êtres humains.
"Si vous espérez que cesse un jour l'esclavage, vous devrez jeter un sort au peuple anglais! Car il aime mettre du sucre à bas prix dans son thé tout comme du tabac à bas prix dans sa pipe. Aucune lamentation à ce sujet n'y changera rien!"
"Nous sommes une nation d'hypocrites. C'est la triste réalité. Les gens ne cherchent pas à savoir comment leur sucre arrive réellement dans leur thé, car ils ne veulent pas le savoir"
Il parait que Blood & Sugar est le thriller historique du moment. Il devrait donc ravir les amateurs du genre. Pour ma part, n'aimant ni les polars, ni les livres historiques, je n'aurais pas dû m'y risquer... Que voulez-vous, je suis curieux et toujours à la recherche d'une bonne surprise ; mais de bonne surprise il n'y eut pas pas pour cette fois. Dommage.
En se focalisant sur l'enquête menée par son personnage principal, l'autrice passe à mon avis totalement à côté de son sujet. En adoptant le point de vue, et la langue, d'un aristocrate, elle passe aussi littéralement, et littérairement, à côté de son sujet. Un peu comme si le magnifique film Twelve years a slave avait été raconté par un planteur plutôt que par un esclave.
Parce qu'il reste à hauteur d'hommes et se focalise sur la recherche du meurtrier, ce roman n'évoque que superficiellement le sujet de l'esclavage. Historiquement, l'intérêt du livre est donc assez limité. Littérairement, c'est une catastrophe. Laura Shepherd-Robinson a un ton ampoulé et mièvre. Tout est très bien expliqué, très didactique... mais pas très bien écrit. Si bien que, alors même que les meurtres sanglants se multiplient sur le passage du héros (le type est un vrai chat noir!), l'on n'est jamais ému.
"Nous arrivâmes à Londres un peu après huit heures. La lumière du couchant parait le dôme grandiose de Saint-Paul d'un éclat ambré, les clercs et les courtiers de la City rentraient chez eux ou cherchaient un endroit où dîner. Plus nous roulions vers l'ouest de Soho, plus les rues s'animaient, se remplissaient de gentilshommes noceurs accompagnés de leurs catins".
"Londres baignait dans la lumière laiteuse du pâle soleil qui parvenait à percer le ciel d'étain maussade. Des prostituées et des pigeons se pavanaient en ébouriffant leurs plumes de temps à autre d'un air courroucé. Les vitrines des commerces du port renvoyaient des reflets noirs et dorés au gré du mouvement des nuages".
Si elle n'avait pas à ce point usé d'adjectifs qualificatifs ni abusé de fausses pistes, peut-être l'écrivaine aurait-elle pu boucler son enquête en 300 pages plutôt qu'en 450. Peut-être alors le temps m'aurait-il paru moins long ; car il m'a vraiment fallu lutter pour terminer ce roman, même si je comprends très bien qu'il puisse trouver son public.
Blood & sugar
Laura Shepherd-Robinson
Traduction Pascale Haas
10-18 collection Grands-Détectives
453 pages

Que du bonheur, avec vos capteurs , Thierry Collet, Rond-Point
Le mentaliste-prestidigidateur Thierry Collet s'est posé une question simple : "On peut se demander si les machines ne sont pas devenues de meilleures mentalists que les humains. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je résiste, ou je pactise?"
Thierry Collet n'en rajoute pas, il n'en fait pas des tonnes comme un magicien. Il déroule tranquillement son argumentaire, de façon assez linéaire. Paradoxalement, cela rend encore plus forte certaines démonstrations. Less is more, comme disent les anglais.
Le magicien ne cesse de nous dire qu'il n'en est pas un ; qu'il ne fait qu'utiliser des technologies facilement accessibles, même si encore peu connues du grand public.
"Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie". Ainsi, au Moyen-Age, le truc de l'encre sympathique relevait de la sorcellerie, avant de passer pour de la magie au XVIIème et, enfin, d'être compris par tous de nos jours. Ce qui impressionne aujourd'hui n'étonnera plus personne demain.
Le spectacle de Thierry Collet oscille entre performance et conférence ; à rebours de tout magicien qui se respecte, il va même jusqu'à nous dévoiler certains trucs. Il nous explique ainsi comment il peut très facilement savoir quel type de buveur est un spectateur, quelle est sa marque de bière favorite et quel est son bar préféré. C'est à la fois très simple et terriblement bluffant, voire effrayant.
Le spectacle est interactif et il faut donc vous attendre à en être partie prenante. J'ai ainsi pu voir interagir mon propre portefeuille avec son double numérisé dans un final particulièrement troublant.
Jusqu'au 06 novembre 2021
Théâtre du Rond-Point
Durée 1h
Conception et interprétation : Thierry Collet
Mise en scène : Cédric Orain
Assistanat à la création et interprétation : Marc Rigaud

James Bond 007, Mourir peut attendre, Cary Joji Fukunaga
!!! ATTENTION SPOILER !!!
Certes, les scénarii des James Bond ne brillent généralement pas par leur crédibilité ; mais là, il faut bien reconnaître qu’on bat des records dans le n’importe quoi. Personne n’y croit, même pas les grandes marques de bagnoles qui ont refusé de prêter leurs derniers modèles ! Du coup, Bond se retrouve à rouler dans des voitures qui n’ont pas moins de 30 ans… De toute façon, les cascades sont toutes faites en animation numérique, au point qu’on se croirait dans un jeu vidéo.
Bond se croit trahi par celle qu’il aime (Madeleine Swann qu’il avait rencontrée dans l’épisode précédent). Du coup, alors qu’il a sur les talons toute une armée de dangereux italiens très en colère et surarmés, il dépose sa future-ex copine à la gare pour qu’elle prenne tranquillement un train pour Nowhere et qu’elle l’oublie à jamais. C’est limite s’il ne lui achète pas son billet et un journal. Et si je vous dis que cela fait trois mois qu’ils copulaient comme des lapins et qu’elle se tient le ventre au moment des adieux, vous pourrez aisément imaginer la suite. (Non, elle n’a pas la gastro.)
Amoureux déçu, Bond quitte tout pour se réfugier incognito à la Jamaïque. Bien qu’en retraite, notre bon vieux James gardé la forme. Il mange du poisson qu’il pêche lui-même et, comme ça, il entretient du même coup son instinct de chasseur et son corps d’athlète ; malin ! Malin, et surtout bien pratique quand il lui faudra reprendre du service cinq ans plus tard pour sauver le monde!
Pendant ce temps-là, le chef de Spectre garde son Internationale Vilain à l’œil, tranquilou-pilou depuis sa prison surprotégée. Quand il a un peu de temps entre deux complots, il consulte sa psy qui n’est autre que, devinez qui ? Madeleine Swann, évidemment !
Donc forcément, Bond est amené à revoir celle qu’il a quitté mais aime toujours. Il comprend alors son erreur et repart pour un tour de piste avec Dr Swann, ce qui n’est absolument pas crédible car, comment pourrait-il tomber amoureux de Léa Seydoux qui ressemble à un veau qu’on mène à l’abattoir. (Mais qu’est-ce qu’elle joue mal, c’est pas permis !)
Autres invraisemblances, en vrac. Classique : les méchants ne savent pas viser tandis que 007 fait mouche à chaque coup de feu. Les services secrets de Sa Majesté n’ont pas eu l’idée d’aller chercher Bond à la Jamaïque, et ce sont les agents de la CIA qui s’y collent. Et lorsque Bond part retrouver Madeleine sur l’île de son enfance, ses ex-collègues n’arrivent toujours pas à le localiser. Sans doute parce que son téléphone (Nokia) d’agent secret est hyper discret. Autre étrangeté numérique : Q consulte les fichiers classés Secret Défense depuis chez lui ; c’est bien pratique le télétravail !
Non seulement le scénario est paresseux, mais il est en plus desservi par des acteurs pas ni convaincus ni convaincants. Daniel Craig et Ralph Fienes font le service minimum, Christoph Walz fait un passage éclair Lashana Lynch est bien la seule à se croire crédible en nouvelle 007, Rami Malek incarne un ennemi de Bond bien falot… et tout est à l’avenant. Et je vous passe le politiquement correct de rigueur qui veut que le remplaçant de Bond soit une femme noire, que Q soit homosexuel, et que Bond s’encombre d’une famille.
Car c’est accompagné de Madeleine Swann et de sa fille (à elle) que Bond part à la chasse aux vilains. Tiens mais au fait, qui peut donc bien être le papa de cette petite fille de cinq ans? (soit le temps qui s’est écoulé depuis que James n’a pas vu Madeleine…)
Sans doute les scénaristes ont-ils incorporé cette pauvre enfant à leur histoire bancale pour tenter (vainement, malheureusement) de créer une intensité dramatique en nous faisant craindre pour l’avenir de cette adorable fillette aux yeux bleus piscine. (Mais qui est son père, non, franchement, je ne vois pas).
Moi qui suis hyper sensible, je n’ai pas cru un seul instant que les scénaristes pourraient sacrifier la fillette. J’espérais donc qu’ils nous débarrassent définitivement de Swan Seydoux. Mais au lieu de ça, ils terminent leur film de 2h43 (dont 1 heure de trop) dans un beau feu d’artifice et... ils tuent James Bond ; carrément !
Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes et Rami Malek – 2h43 – MGM – 6 octobre 2021

François, le Saint jongleur, Dario Fo, Gallienne, Claude Mathieu, Montansier
Dario Fo, célèbre dramaturge italien et prix Nobel de littérature 1997, est l'auteur de cette pièce assez irrévérencieuse sur François d'Assise, ce fils de grands bourgeois qui au XIIème siècle a renié la richesse de ses parents (allant jusqu'à se mettre nu dans un église pour tout rendre à son père, même ses vêtements!) afin de vivre dans la pauvreté avec ses compagnons.
A une époque où seuls les prêtres étaient autorisés à dire l'évangile, dans leur église et en latin, François d'Assise a voulu raconter la vie de Jésus en tout lieu et en italien. Il fascine les foules en leur narrant la Bible à sa façon.
"Quelle bonne religion nous avons là!" dit la foule quand Jésus transforme l'eau en vin ou lorsqu'il multiplie les poissons (désarêtés, s'il vous plait) !
A l'image de François qui est revenu à l'épure de l'évangile pour mieux lui donner sa dimension pleine et entière, le metteur en scène Claude Mathieu revient à l'essentiel du Théâtre pour mieux le magnifier. Pas de décor. Une table pour tout accessoire. Un seul comédien (pour une vingtaine de personnages). Et quel comédien !
Il y a quinze ou vingt ans, Gallienne m'apparaissait comme un artiste talentueux. Puis, je trouve qu'il s'est un peu perdu dans une forme de caricature de lui-même, que ce soit dans "Guillaume et les garçons, à table!" ou, pire, dans "Ça peut pas faire de mal" sur France Inter. Gallienne faisait alors du Gallienne et c'était lassant.
Gallienne montre ici l'étendue de son talent. Lorsque commence la pièce, l'on est un peu décontenancé ; mais on ne sait pas trop par quoi au juste. Il m'aura fallu un certain temps pour réaliser que Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, ne déclame pas, mais qu'il parle. Tout simplement. Et pourtant, on l'entend, même à l'autre bout du théâtre. Et pourtant il joue, sans aucun conteste.
Avec François, la Bible est une histoire accessible à tous. Avec Guillaume, la vie de François est un conte, l'histoire d'un homme complexe à la fois bourgeois et pauvre, indépendant mais pistonné, drôle mais tragique, illuminé mais visionnaire.
Et je me suis senti comme un enfant qui écoute avec délice et fascination son père qui lui raconte une histoire passionnante, drôle et tragique. La vie, quoi !
Jusqu'au 03 octobre 2021
Théâtre Montansier, Versailles
1h30 - de 5 à 39€

D’Artagnan et les trois Mousquetaires
Aaah, Les Chiens Mousquetaires, une vraie madeleine de Proust ! L’un de mes dessins animés favoris dans les années 80 ; et pourtant, avec Albator, Goldorack, Inspecteur Gadget, Candie, Fraggle Rock, il y avait une sacrée concurrence !
Les Chiens Mousquetaires (Dogtanian) est un dessin animé charmant qui s’inspire des aventures des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, père. Dans l’édition originale du dessin-animé, tout était encore fait à l’ancienne, avec de belles couleurs faites au pinceau. Dans la version moderne actuellement au cinéma, on est passé au numérique ; pourquoi pas ? Par contre, pourquoi une telle laideur dans les couleurs ? Tout est ultra brillant et flashy, c’est visuellement assez indigeste.
Pour le reste, on n’est pas dépaysé : on retrouve nos sympathiques héros, dont le prétentieux D’Artagnan qui ne doute pas un seul instant ni de son talent, ni de son destin. « Mais qu’ont-ils tous à se prétendre la plus fine lame du Royaume, alors que la plus fine lame du Royaume, c’est moi ?! »
Le rythme est tranquille (j’adore quand ils courent sur place !), ce qui change de certains dessins-animés ou films actuels qui font 120 plans à la minutes pour faire moderne et combler le vide du scénario.
L’intrigue est très bien expliquée et compréhensible, vous pourrez donc sans crainte y amener les petits (5 ans) comme les moyens enfants (8 ans).
Star Invest Films France 2021
De Toni Garcia. Espagne, Japon. 1 h 29. Animation.
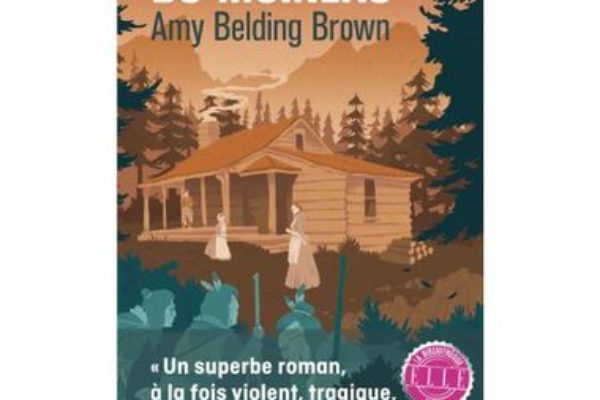
L’envol du moineau, Amy Belding Brown, 10-18
Inspiré d’une histoire vraie, L’envol du moineau est une épopée féministe, historique et terriblement actuelle !
1672 en Amérique. Mary est la femme respectable d’un pasteur puritain, dont la soumission est mise à l’épreuve lorsqu’elle continue, malgré l’interdit posé par son époux et maître, à rendre visite à Bess, une toute jeune femme de sa communauté qui vient d’accoucher d’un enfant conçu avec un esclave noir. Scandale et réprobation chez les bigotes.
Puis la vie de Mary bascule totalement lorsque des indiens détruisent son village avant de la faire prisonnière. Elle qui, au contact de Bess, commençait à douter du bien-fondé de l’esclavage, soit disant permis si ce n’est voulu par Dieu, se retrouve elle-même esclave. Un comble. Or, au fur et à mesure de sa vie au quotidien avec les Indiens, c’est toute sa conception puritaine du monde, et plus particulièrement des rapports entre hommes et femmes, qui est ébranlée.
« Il lui vient à l’esprit qu’elle devient de plus en plus indienne dans son apparence et son attitude. Elle sait qu’elle devrait craindre pour son âme. Pourtant, elle ne ressent que de la paix et du réconfort. Et de la gratitude. »
La surprise de Mary est grande lorsqu’elle se rend compte que son propriétaire n’est pas l’homme de la famille mais sa femme qui est une cheffe et une guerrière respectée par toute sa tribu. « Il est inconvenant – et tout à fait effrayant – qu’une femme détienne un tel pouvoir sur les hommes. », pense-t-elle alors.
Bien que l’action se déroule au XVIIème siècle, cette histoire est d’une redoutable actualité à l’heure où tant de femmes attendent encore leur émancipation. La dénonciation factuelle du patriarcat est implacable et convaincante. Et le tout est plutôt bien écrit.
« L’amour. On attend d’elle qu’elle aime, honore et écoute son mari. Mais que signifie un tel amour ? Ce n’est ni du désir ni de l’affection. Ce n’est qu’une obligation de plus. »
L'envol du Moineau
Amy Belding Brown
464 pages
Éditeur : Le Cherche midi (21/03/2019) / 10-18 en édition poche

BAC Nord, Cédric Jimenez
Avec BAC Nord, vous allez prendre une grosse claque !
Film événement de la rentrée, BAC Nord nous narre le quotidien de trois « baqueux » de Marseille, Antoine, Yassine et Cyril. Trois potes aux caractères différents, mais qui sont inséparables à force de passer leur vie ensemble à arpenter Marseille dans leur bagnole et à traquer les voyous. Leur quotidien est rythmé par des interpellations de délinquants assez minables (vendeurs de tortues à la sauvette, voleurs de scooter…) dans une ville aux allures de Tiers Monde.
Le film - porté par des comédiens tous impeccables et extrêmement convaincants - est magistral du début à la fin. Dans la scène d’ouverture, nos trois flics se donnent à fond pour interpeler le conducteur (sans casque) d’un scooter (volé) qui finit par leur échapper. Blasés par cet échec, ils décident de faire un « plan stup » : Antoine et Yassine enfourchent le scooter afin de pénétrer incognito dans une cité où, faisant mine d’acheter de la drogue, ils arrêtent le dealer qu’ils jettent dans la voiture conduite par Grégory qui les a rejoints entre-temps. Mais au moment de sortir de la cité, ils endommagent la voiture pour forcer un barrage de fortune, ce qui leur sera plus tard reproché par leur capitaine. « Un gros dealer ou un pickpocket, ça fait pas de différence pour (le Ministère) », leur dit-il. Il leur faut donc faire du chiffre plutôt que de chercher à être utiles.
Prise de risque, adrénaline. Frustration. Esprit d’équipe et petits arrangements avec la procédure. Tout est dit.
« Le terrain, c’est des frustrations ». « On ne sert plus à rien »
Ces histoires de flics découragés, décrédibilisés et impuissants face à des délinquants qui les narguent éhontément, on les connait par cœur et on les a déjà vues mille fois. Sauf qu’ici, on a l’impression de les vivre. On est avec eux, on est eux. Que peuvent-ils faire contre des coqs dont la testostérone est la seule valeur ? Comment composer avec une hiérarchie veule et changeante ? Comment ne pas tomber dans des petits arrangements coupables (une cartouche de cigarettes de contrebande ou un kebab offert par ci, un barrette de shit confisquée puis fumée par là) ?
Le portrait qui est fait de la France est triste à pleurer. Tout est dans un état lamentable : les « quartiers » comme les institutions (police, prison, politique). Le décalage est saisissant entre la misère ambiante et le cadre magnifiquement de la Méditerranée.
Et lorsqu’enfin ils donnent l’assaut dans une cité, on tremble pour eux ; la tension est presque insoutenable dans une scène de guérilla urbaine d’anthologie.
Ce film est un modèle du genre et le réalisateur Cédric Jimenez n’a pas à rougir, même face à Martin Scorsese, Michael Mann ou Ridley Scott.
Drame, Policier
Sortie nationale le 18 août 2021
104 minutes
Festival de Cannes 2021 : sélection officielle, hors compétition

OSS117 Alerte rouge en Afrique noire
Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS117, est enfin de retour après 12 ans d’absence. Les deux premiers opus signés Michel Hazanavicius étant devenus cultes, la pression était forte sur Nicolas Bedos, le réalisateur de ce troisième volet intitulé OSS117 Alerte rouge en Afrique noire.
Alléché par une habile bande-annonce, on se régalait d’avance de voir notre anti-héros national mettre les pieds dans le plat du racisme ordinaire.
Malheureusement, Nicolas Bedos signe un film trop long (quasiment deux heures, quand tout était déjà dit dans la bande-annonce) et trop bling-bling. Le réalisateur avait manifestement trop d’argent à dépenser. Pour preuve, au lieu de faire montre d’imagination dans sa mise en scène, il a recours à des effets numériques qui, en plus d’être ratés, n’apportent rien à l’affaire. Ainsi, dans la scène d’ouverture à la James Bond, Nicolas Bedos déploie force images de synthèse pour montrer à l’écran des explosions, des hélicoptères ou encore des montagnes afghanes même pas en carton-pâte.
De même, il multiplie au cours du film les scènes avec des animaux sauvages de synthèse auxquels on ne croit pas un seul instant, car comme le dit OSS117 « Je n’ai rien contre la modernité, mais ça ne marche pas ».
Plutôt que de s’adonner, comme tout le monde, aux images de synthèse, Nicolas Bedos aurait mieux fait d’utiliser des bons vieux trucages à la papa et des cascades à la Rémy Julienne, qui auraient été dans le ton des années 80 où se déroule l’action. Il aurait pu aussi offrir à Pierre Niney une perruque crédible ou autre chose qu’une fausse barbe pitoyable.
Le scénariste Jean-François Halin, qui est habituellement très drôle, multiplie les blagues toutes plus douteuses les unes que les autres avec un débit de kalachnikov. Cela ne suffit pourtant pas à réveiller les spectateurs qui – comme le film - ronronnent gentiment. On ne s’amuse pas vraiment. J’étais surpris de voir comme le public riait peu malgré les efforts manifestes de Jean Dujardin pour sauver ce film qui n’est pas à la hauteur des nos attentes.

L’Anomalie, Hervé le Tellier, Gallimard
Je n’ai jamais eu envie de lire les livres d’Hervé Le Tellier alors même que je le trouve plutôt drôle et sympathique. C’est donc avec curiosité et plaisir que j’ai emprunté le dernier livre de cet auteur, l’Anomalie, à un ami qui l’avait proprement détesté et dont il était très content de se débarrasser !
Ce roman ayant obtenu le Prix Goncourt, et son auteur ayant fait le tour des popotes médiatiques, l’histoire est désormais assez connue. Et pour ceux qui ne la connaitraient pas encore, ils peuvent sauter le paragraphe suivant. Attention, divulgachage !
Dans l’Anomalie, Hervé Le Tellier raconte l’histoire d’un vol Paris-New-York qui s’est dédoublé après avoir essuyé une tempête d’une force inédite. Ainsi, le même avion et les mêmes passagers - alors qu’ils sont partis au même moment - atterrissent aux USA à 106 jours d’intervalle. Dans ce court roman, Hervé Le Tellier explore les conséquences de ce dédoublement pour les personnes confrontées à leur double (ou du moins pour les onze passagers qu’il a sélectionnés), pour les Autorités, pour les religions et pour le monde tout entier.
Ce livre qui se lit tout seul est très divertissant et l’on sent bien le métier de son auteur. Hervé Le Tellier fut longtemps l’un des piliers des Papous dans la tête, une émission de jeux littéraires sur France Culture où il s’adonnait avec délectation au pastiche littéraire et à l’écriture sous contrainte. Dans l’Anomalie, l’écrivain recycle ce savoir-faire en adoptant plusieurs styles, selon les chapitres.
Clairement, Hervé Le Tellier écrit son roman comme une série. A la lecture, on ressent (un peu trop à mon goût !) que l’écrivain avait en tête une adaptation à l’écran, adaptation en série va d’ailleurs avoir lieu prochainement. Il devait en avoir assez de signer des livres relativement confidentiels ! Ce n’est pas désagréable à lire, c’est divertissant, mais ce n’est pas non plus fantastique (on est assez loin des Goncourt d’anthologie : Proust, Genevoix, Merle, Gary, Echenoz etc.). Cela m’a beaucoup fait penser à Tonino Benacquista qui eut son heure de gloire dans les années 90-2000, et dont le roman Malavita fut adapté au cinéma par Luc Besson.
Pour résumer, l’avantage de l’Anomalie, c’est que c’est plaisant et vite lu. Le gros inconvénient, c’est que cela reste assez léger, malgré le fond pseudo-philosophique ; Hervé Le Tellier étale un peu sa science et nous fait du Descartes 2.0…

Trilogie Benlazar, Frédéric Paulin, Agullo Noir et Folio Policier
C’est le polar de mon été. Attention, c’est addictif !
N’étant pas du tout lecteur de polars, je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai récupéré La guerre est une ruse, de Frédéric Paulin, qui avait été déposé dans une boîte à livre. Grand bien m’en a pris !
J’ai littéralement dévoré ce livre avant de voir en 3ème de couverture qu’il n’était que le premier tome d’une trilogie. Il ne me restait alors plus qu’à me procurer les deux tomes suivants pour prolonger le plaisir de lecture.
Quand je parle de plaisir, il me faut préciser que le sujet de cette trilogie n’est pas des plus riants. Le héros, Tedj Benlazar, est un agent des services secrets français en poste en Algérie dans les années 90 (la décennie noire). Très tôt, il a l’intuition que la barbarie qui sévit en Algérie dépassera les frontières du pays. Malheureusement, personne ne l’écoute ni ne peut enrayer la machine infernale qui est à l’œuvre.
« Durant la guerre faite au peuple, l’Algérie a compté 200 000 morts ; la France vient de perdre 17 personnes. Quel est ce monde qui pleure 17 personnes mais qui en oublie 200 000 autres ? »
Avec sa trilogie « Tedj Benlazar », Frédéric Paulin dresse une histoire documentée et passionnante du djihad islamiste depuis ses origines sur le territoire algérien jusqu’aux attentats de novembre 2015 en France, en passant par le 11 Septembre et le Djihad de citoyens français en Syrie. La description romancée de la chronologie et des ramifications internationales du terrorisme est très instructive, et tout simplement passionnante.
La guerre est une ruse, Agullo Noir et Folio Policier
Prémices de la chute, Agullo Noir
La Fabrique de la terreur, Ed. Agullo Noir

Adieu les cons
Adieu les cons… Bonjour le navet !
« Intégré dans un monde de tarés, je suis pas sûr que ce soit une réussite ». Si la phrase prononcée par le personnage de Dupontel est juste, elle s’applique malheureusement à ce dernier dont le film a raflé 7 César (meilleur film, meilleur réalisation et meilleur scénario entre autres). Il fut un temps où Dupontel pratiquait un humour punk saignant mais jouissif. Avec Adieu les cons, il signe une bluette gentiment contestataire, suffisamment peu corrosive pour pouvoir être diffusée sur TF1.
Dupontel voudrait mettre en scène une fable mais ne parvient qu’à réaliser un film kitsch et laid, sans parler des hommages lourdingues à Brazil (participation exceptionnelle de Terry Gilliam, personnage qui s’appelle Tuttle, scène dans les archives etc.). Dupontel dénonce la toute puissance de l’informatique qui contrôle désormais tout. Lorsque le héros prend le contrôle des choses grâce à son ordinateur tout puissant, on se croirait dans un James Bond ou un Mission Impossible du début des années 2000…
Bien sûr il y a des choses à sauver, comme ces seconds rôles qu’on aime tant (Nicolas Marié, Michel Vuillermoz, Laurent Stocker, Bouli Lanner et surtout Jackie Berroyer qui incarne avec douceur un médecin sénile), mais l’on comprend mal comment ce film très très moyen (visuellement très moche et dont le scénario est indigent) a pu rencontrer un tel succès tant critique que populaire.
Sortie le 21 octobre 2021
Manchester Films
87 minutes

5ème set

Ayant terminé mes études il y a très longtemps, cela devait bien faire au moins 20 ans que je n’avais pas vu un match de Roland Garros.
Autant vous dire que je me fous complètement du tennis, et que je ne suis pas allé voir « 5ème set » pour son sujet, mais plutôt pour son interprète, Alex Lutz. Et grand bien m’en a pris car le comédien porte le film avec le talent qu’on lui connait.
L’histoire: Thomas Edison (Alex Lutz, donc), un ancien petit prodige du tennis français rêve, à 37 ans et alors qu’il a un genou en vrac, d’accéder à la finale de Roland Garros qu’il avait laissé échapper sur une balle de match lorsqu’il avait tout juste 18 ans. Personne ne croit en lui et l’on se demande bien où il trouve la force, ou la folie, ou l’abnégation, de continuer à se battre. Quand tout le monde autour de lui se résigne à abandonner la compétition, lui pense qu’il n’en a pas fini avec les tournois.
Avec qui ou avec quoi a-t-il des comptes à régler ? Avec son impitoyable mère ? Avec sa femme protectrice ? Avec le jeune homme qu’il fut jadis et qui trébucha ? Avec son corps vieillissant qui le lâche ?
Tout cela, et plus encore, se mêle pour donner un film sobre mais prenant. Alex Lutz est extrêmement juste et suscite chez le spectateur une véritable empathie avec son personnage. On souffre avec lui et l’on a envie d’y croire, tout en n’y croyant pas (mais Thomas Edison y croit-il vraiment, au fond ?).
Le film ne tiendrait pas sans Alex Lutz, c’est sûr. Mais il faut aussi saluer les seconds rôles qui nous font croire à cette histoire aussi improbable qu’émouvante : Ana Girardot (Eve, sa femme), Kristin Scott Thomas (Judith, sa mère), Quentin Reynaud (son entraîneur, qui est aussi le réalisateur du film) ou encore Tariq Bettahar (un chauffeur compatissant mais pas téméraire).
La réalisation est honnête et parfois même trop didactique (le gros plan sur la cicatrice au tout début du film…). La direction d’acteurs est bonne (sauf pour Jürgen Briand qui appuie un peu trop le côté prétentieux et arrogant du jeune rival de notre héros). Le réalisateur (ancien tennisman) se fait plaisir en donnant un voir un match « comme à la télé ». J’ai l’air de critiquer comme ça, mais j’avoue que je me suis laissé prendre avec plaisir à cette rencontre épique qui m’a presque donné envie de regarder Roland Garros l’année prochaine. J’espère juste qu’Alex Lutz sera qualifié !
Sortie le 16 juin 2021
Un film de Quentin Reynaud
Durée 105 minutes

Le Lac des cygnes, Angelin Preljocaj, Chaillot

D’abord, une danseuse vient délicatement jouer avec une bulle de savon virtuelle. C’est très simple et très beau. Immédiatement l’émotion m’étreint : après de longs mois sans danse dans ma vie, je mesure à quel point cet art m’est précieux.
Malheureusement, la danse classique est trop souvent considérée comme intimidante, démodée voire un peu ridicule. Je comprends très bien qu’on puisse lui trouver un côté tarte à la crème rose-bonbon un peu indigeste (tutus, chaussons, pantomimes etc.). Mais avec Angelin Preljocaj, le ballet est dépoussiéré ; c’est, en somme, le parfait alliage entre la rigueur technique du ballet classique et la liberté de la danse contemporaine. Le Lac des cygnes proposé par ce chorégraphe de génie offrira une belle entrée en matière à ceux qui n’y connaissent encore rien. Ma fille de 7 ans, par exemple, n’a âs rechigné devant les presque deux heures du spectacle. Elle a apprécié la beauté des gestes, même si elle n’a pas toujours très bien compris l’histoire (qui est, il faut bien l’avouer, assez alambiquée).
Angelin Preljocaj transpose l’action du ballet à notre époque et, fidèle à l’air du temps, nous propose un Lac des cygnes teinté d’écologie, le tout assez lourdement appuyé par les vidéos. Pour résumer l’intrigue: à tout juste 18 ans, la mère du prince Siegfried (Clara Freschel qui réalise la performance de danser enceinte!) lui enjoint de trouver une épouse. Alors qu’il cherche le calme après une fête donnée en son honneur, il trouve l’amour au bord d’un lac en la personne d’Odette (Isabel García López), une ravissante princesse qui fut jadis métamorphosée en cygne blanc par le sorcier Rothbart (l'impeccable Antoine Dubois). L’horizon s’assombrit cependant bien vite. D’abord, le père de Siegfried (Baptiste Coissieu) autorise l’exploitation d’un gisement pétrolier sur le lac des cygnes, promettant celui-ci à la destruction. Ensuite, Rothbart et ses sbires battent le prince Siegfried qu’ils laissent pour mort. Enfin, parce qu’il tombe amoureux d’un cygne noir (sosie d’Odette envoyé par Rothbart), Siegfried condamne Odette à rester cygne (blanc) pour l’éternité.
Oscillant entre tradition et modernité, Preljocaj reste majoritairement fidèle à la musique de Tchaïkovski mais ne s’interdit pas quelques insertions de musique électro voire techno. Ainsi, lors de la fête d’anniversaire de Siegfried, danse et musique adoptent des rythmes jazzy pour se faire sensuelles. Puis, tout-à-coup, l’on se croirait dans West Side Story : l’explosion de couleurs et d’allégresse nous fait un bien fou et nous fournit quelques réserves de bonheur avant que le ballet ne sombre inéluctablement dans une noirceur désespérée (et aussi, il faut bien le dire, formellement moins intéressante).
Ce ballet n’est peut-être pas la meilleure chorégraphie de l’artiste (cf. le magnifique Blanche-Neige) ; mais tout de même, quel chorégraphe! La qualité des ensembles et l’exécution rigoureuse offerte par les membres du Ballet Preljocaj sont impressionnantes. Et il y a tant de choses magnifiques que l’on aimerait fixer dans sa mémoire : ce ballet millimétré des 25 danseurs qui se croisent mécaniquement sans se percuter, les corps relâchés dans une scène de boîte de nuit à la Grande Bellezza, les 16 cygnes en diagonale comme dans un paradis où les danseuses auraient avantageusement remplacé les anges, la tête aimantée par la main de l’être aimé, les quatre danseuses bras-dessus bras-dessous entremêlées en losange…
Au fait, le spectacle dont il est question ici est actuellement visible sur France.tv. C’est bien pour se faire une idée mais il me semble nettement préférable de franchir la porte du Théâtre national de la danse à Chaillot, tout comme il vaut mieux aller au restaurant que regarder des émissions de cuisine (en mangeant des chips !). Mais si cela peut vous donner faim de danse, j'en serais ravi !
Jusqu’au 26 juin 2021
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Extraits musicaux Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes Igor Chapurin
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
ODETTE - ODILE Isabel García López
SIEGFRIED Leonardo Cremaschi
MÈRE DE SIEGFRIED Clara Freschel
PÈRE DE SIEGFRIED Baptiste Coissieu
ROTHBART Antoine Dubois
Tarif C — de 8€ a 43€

Crise de nerfs, Anton Tchekhov, Peter Stein, Théâtre Montansier

Quel plaisir de retourner au théâtre !
Quel plaisir de retrouver la magnifique salle du Théâtre Montansier ! Et quelle drôle de sensation que de contempler (la faute à la distanciation physique) un public éparse et étrangement uniforme (masque blanc couvrant le visage oblige). Pour un peu, l'on se croirait projeté dans une pièce de Beckett ou sur l'affiche de Réalité (le film de Quentin Dupieux).
Néanmoins, dès la lumière éteinte et une fois cette étrange atmosphère assimilée, on se plonge avec délice dans les trois micro-pièces d'Anton Tchekhov proposées par Peter Stein. On est d'autant plus concentré que, merci le Covid, plus personne n'ose tousser ; comme quoi c'était possible !
Dans « Le Chant du cygne », l'absence totale de décor (les murs sont bruts, comme aux Bouffes du Nord) et l'éclairage à la bougie soulignent le caractère crépusculaire du personnage incarné par Jacques Weber : un comédien vieillissant qu'on a littéralement oublié dans un théâtre.
Jacques Weber, volontiers tonitruant, semble avoir du mal à camper ce personnage désabusé oscillant entre désespoir et bouffonnerie : « J'ai 70 ans, c'est déjà Ding-ding, on ferme ».
C'est comme si le metteur en scène et le comédien n'avaient pas trouvé le bon rythme pour une pièce qui, bien que courte, s'étire en longueur.
Heureusement, la deuxième pièce, intitulée « Les méfaits du tabac », est bien plus réussie. Jacques Weber, seul en scène, se réveille (et du coup, les spectateurs aussi!) et nous amuse avec un exposé sur le thème du tabac dont le sujet dérive bien vite sur la femme du conférencier : « elle est toujours de mauvaise humeur (…) elle m'appelle l'épouvantail ». Ici encore la pièce est douce-amère : on s'amuse drôlement de la descente aux enfers que constitue la vie du personnage. Il faut dire que Weber a trouvé le bon tempo et qu'il est délicieux et juste,
Pour la troisième et dernière farce, l'on se dit que les deux autres comédiens vont servir de faire-valoir à la star Weber ; or c'est tout l'inverse, Jacques Weber se met au service de ses partenaires Manon Combes et de Loïc Mobihan, un formidable duo de jeunes comédiens.
Dans « Une demande en mariage », un jeune homme émotif, obséquieux et pragmatique (« Si l'on attend l'amour véritable, on ne se mariera jamais ») demande la main de la fille de son voisin et ami. Mais ses hésitations et circonlocutions vont lui faire commettre un impair qui va bientôt mettre son projet en péril. Alors que le père lui donnait au départ des petits noms tendres (ma bichette, ma mignonne...), sa relation avec sa promise s'envenime jusqu'à la crise de nerfs, crise de nerfs qui donne l'occasion à Loïc Mobihan et, surtout, à Manon Combes d'exprimer pleinement leur talent dans un numéro débridé et désopilant.
Il y a un véritable crescendo dans la mise en scène des trois pièces et, si la mort rode au départ (ce qui correspond assez bien à l'ambiance Covid), l'on ressort du théâtre tout ragaillardi et avec une pêche d'enfer ; le spectacle vivant porte ici bien son nom.

Le Cirque invisible, Victoria Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée, Rond-Point

Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierée entrent en scène pour nous faire rire et nous émerveiller.
Jean-Baptiste Thierée est un papy
magicien et un peu clown aussi, qui enchaîne à rythme effréné les
tours de prestidigitation, les illusions et les blagues. Lorsqu'il
nous promet de faire apparaître un chien, c'est le lapin Jean-Louis
qui sort de la boîte, un running gag
en forme de petite peluche
qui sert de mascotte du magicien.
Lorsqu'elle entre en scène la première fois, Victoria Chaplin est vêtue d'une longue robe mordorée qui l'avale avant de se mettre à danser et à cabrioler toute seule. Ici, les objets – et en premier lieu les costumes – ont une vie qui leur est propre et un pouvoir infini de transformation. Les objets prennent vie : les tables se métamorphosent en charrette, les vélos en sculptures à la Jean Tinguely, les rocking-chairs en dragon etc. Tout est possible et tout est incroyable.
Les enfants - petits et grands voire
très grands - se régalent des gags idiots de ce clown malicieux qui
les fait rire aux éclats, tandis qu'ils restent bouche bée devant
les prouesses épatantes de Victoria Chaplin.
« Mais comment il fait ? » ne cessera de me demander ma fille de six ans, enthousiasmée et transportée par ce qu'elle voit.
Même s'il est impressionnant de
maîtrise, le Cirque invisible ressemble à un spectacle bricolé par
deux enfants malicieux. Ce côté naïf pourrait agacer mais il n'en
est rien. On est tout simplement conquis et émerveillé par ce que
l'on voit. Car quel que soit leur âge à l'état civil,
Jean-Baptiste Thierée reste un gamin, et Victora Chaplin une
demoiselle à la souplesse de jeune fille ; et leur plus grand
tour de magie, c'est de transformer tous les adultes du public en
enfants pendant toute la durée de la représentation.
Jusqu'au 05 avril 2020
Théâtre du Rond-Point

Dark waters, Todd Haynes, Mark Ruffalo

Rob Billot est un avocat du genre besogneux, de ceux qui se lèvent à l'aube pour préparer la salle de réunion mais qui ne sont pas conviés au déjeuner avec le client.
Même s'il vient d'être promu associé dans le cabinet où il travaille, Rob n'est manifestement pas du sérail : pas la bonne université, pas la bonne bagnole, pas le bon style. Au fond, il est resté un péquenot, comme ne manquera d'ailleurs pas de lui balancer, en public, le directeur juridique de DuPont de Nemours,
Car c'est à ce géant de l'industrie
chimique que va s'attaquer Rob, par loyauté à sa West Virginia
natale et à sa grand-mère qui lui a envoyé un éleveur bovin mal
dégrossi convaincu que la décharge jouxtant sa ferme, et qui
appartient à Dupont, fait crever ses vaches.
Jusqu'alors avocat spécialisé dans
l'environnement – du côté des pollueurs - Rob va basculer dans
l'autre camp, celui des victimes. Mais attention, notre héros n'est
pas flamboyant, ce n'est pas Erin Brokovitch ! L'interprétation
de Marc Ruffalo est fine et juste, et la sobriété générale du
film lui procure une puissance indéniable.
Tout commence comme un film d'horreur ;
l'on n'est jamais en sécurité, même lors d'une innocente baignade
tout nus dans un lac. Ici l'ennemi avance masqué, la pollution est
omniprésente mais savamment dissimulée par un industriel des plus
cyniques (pléonasme?!).
Si vous voulez vous remonter le moral
avec un combat à la David contre Goliath où les pauvres gentils
triomphent des méchants et où les vilains sont punis, ce n'est pas
la peine d'aller voir Dark Waters. Par contre, si vous êtes prêts à
affronter la réalité, y compris dans ce qu'elle a de plus noir,
alors vous ne devez pas louper ce très bon film.

Le cas Richard Jewell, Clint Eastwood

Richard Jewell est un loser même pas magnifique, un gros nounours trentenaire célibataire qui vit encore chez maman, qui aurait rêvé d'être flic et qui collectionne les armes.
Viré de la police municipale et même
de son poste de vigile, il se retrouve agent de sécurité aux Jeux
Olympiques d'Atlanta en 1996. C'est alors qu'il découvre un sac
piégé sous un banc et permet ainsi d'éviter un massacre.
Malheureusement pour notre héros, un
enquêteur du FBI s'acoquine avec une journaliste impitoyable pour
gâcher son heure de gloire et le transformer en suspect numéro 1.
La vie du pauvre Richard Jewel bascule alors dans un cauchemar
médiatique qu'il lui faudra affronter avec l'aide d'un avocat aussi
raté que lui et qui fut jadis son camarade de jeux vidéos.
Papy Eastwood saborde totalement cette
histoire vraie, et assez géniale, qui aurait pu (qui aurait dû !)
donner un très grand film. Certes, il est agréable de voir des
scènes à l'ancienne, avec des vrais figurants (plutôt que des
foules reconstituées par ordinateur) ; mais quelle lourdeur
dans la réalisation !
L'image est très laide : les
décors et les couleurs sont d'une pâleur dignes d'un mauvais
feuilleton télé. La scène de l'attentat est un modèle de
ringardise : ralentis appuyés, caméra subjective, gros plans
pathétiques sur la mère et la fille qui mourront justement au
moment où elles allaient partir etc.
Lorsqu'il veut nous tirer des larmes,
ce bon vieux Clint utilise systématiquement la bonne vieille
technique du gros plan progressif sur le visage, accompagné d'une
douce petite musique émouvante (trois notes jouées à deux doigts
au piano et puis envoyez les violons!).
Voilà pour la forme. Mais que dire du
fond, si ce n'est qu'on le touche ?
Le vétéran du cinéma se borne à
étirer sur plus de deux heures des scènes creuses et qui sonnent
faux. Il n'approfondit pas son sujet et ne propose ni psychologie du
personnage, ni réflexion sur la mécanique de l'emballement
médiatique, ni rien. Juste le spectacle d'un pauvre beauf gentil et
naïf qui est manipulé par un flic méchant et roublard. C'est trop
injuste, comme dirait Caliméro.
Après le dérangeant mais quand-même
moins raté American Sniper, Clint Eastwood continue de distiller
aussi subtilement qu'il le peut son discours Républicain et
pro-armes à feu : les fonctionnaires sont trop nombreux (police
municipale, gardiens du parc où a eu lieu l'attentat et autre FBI se
disputent la compétence du crime et semblent tous aussi nuls les uns
que les autres), avoir des armes à feu (et même des armes de
guerre) ce n'est rien tant qu'on est du côté des gentils, les
femmes sont fourbes et les médias sont vraiment rien que des
menteurs (Fake news!).
Pour nous résumer, ce Richard Jewell tient plus du navet que du joyau !

Tout le monde ne peut pas être orphelin, les Chiens de Navarre, MC93
Dans « Tout le monde ne peut
pas être orphelin », les Chiens de Navarre réservent un chien
de leur chienne à la Famille ! Pudibonds et âmes sensibles
s'abstenir.
Si vous aussi,
vous avez une famille (« Tout le monde ne peut pas être
orphelin » !), allez voir ce spectacle qui vous concerne
intimement. Car, qui peut dire que ses parents, sa fratrie, son
conjoint ou ses enfants ne sont pas parfois un boulet que l'on
traîne, ou au mieux un caillou dans sa chaussure ?
Plutôt que de dépenser votre dernier argent liquide chez le psy, courez-donc voir ce spectacle construit comme un immense psychodrame*, mais en plus drôle.
Placés au milieu des spectateurs qui
sont disposés de chaque côté de la scène (dispositif
« bi-frontal »), les acteurs se foutent à poil devant
nous, au sens (pas toujours propre) comme au figuré.
A travers plusieurs saynètes, les
Chiens de Navarre incarnent des familles qui déjantent, qui
dérapent, qui délirent lors d'événements familiaux dont Noël
représente l'acmé. Dans ce spectacle basé en partie sur de
l'improvisation, on va de surprise en surprise (même le décor s'en
mêle).
Bien que totalement foutraque, la
performance des Chiens de Navarre ne se limite pas à l'humour
pipi-caca, Si le spectacle est hilarant, il est surtout intense et
par moment émouvant, ce qui fait de « Tout le monde ne peut
pas être orphelin » un petit bijou qui reste agréablement en
tête.
Car si le spectacle part dans tous les
sens, c'est pour mieux balayer un large spectre de sujets liés à la
famille (boomers vs génération
Y, violence des rapports filiaux, règlements de compte pendant les
réunions de famille...). La violence se fait jour là où
nous voudrions de l'affection. A la fille qui dit à ses parents
« J'ai l'impression que, quoi que je dise, quoi que je
fasse, vous n'êtes jamais fiers de moi », sa mère répond
« Alors là, tu me déçois ! ».
Il y a forcément un moment où l'on se reconnaît, que ce soit en tant que parent ou comme enfant. Et putain, ça fait du bien de ne pas se sentir seul !

* le psychodrame est une forme de thérapie utilisant la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés
Jusqu'au 18 janvier 2020
MC93, Bobigny
Durée estimée 1h30 – Salle Oleg Efremov
Tout le monde ne peut pas être orphelin – Les Chiens de Navarre – teaser from charleshéloïse on Vimeo.

Malade Imaginaire, Claude Stratz, Guillaume Gallienne, Théâtre Montansier

Un hypocondriaque naïf,
Des charlatans cupides,
Une épouse vénale,
Des filles désobéissantes (mais aimantes),
Des amours contrariées,
Une servante rusée (mais loyale),
Des ballets époustouflants,
Un décor et des éclairages parfaits…
Voilà quelques ingrédients de cette comédie crépusculaire,
dernière pièce écrite et jouée par Molière qui mourra pratiquement sur scène à
la quatrième représentation.
Molière n’aurait pas renié la mise en scène de feu Claude Stratz qui respecte tant l’époque de l’action que l'ambiguïté d’une pièce à la fois résolument burlesque mais aussi effrayante dans son propos, et dans son atmosphère. Les médecins ont des airs de croque-morts (d’ailleurs, « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leurs maladies. »), tandis qu'Argan ressemble à un gros bébé aussi ridicule que pathétique. Claude Stratz n’hésite pas à appuyer cette dualité en montant des saynètes de Commedia dell’Arte et d’ombres chinoises dans une ambiance de mort (la demeure d’Argan est une ruine magnifiquement éclairée à la bougie).
Claude Stratz prouve, s’il en était besoin, qu’il est inutile de vouloir moderniser Molière dont le génie comique suffit à faire rire aux éclats les enfants (et les adultes !) près de trois siècles et demi après sa mort. La mise en scène et pourtant ancrée dans la modernité, notamment par l’utilisation de saisissantes prothèses permettant de transformer littéralement des comédiens en monstres.
Certes,
en cherchant bien, on peut dire qu’on aurait aimé un Cléante (Yoann Gasiorowski)
plus convainquant et une scène du faux médecin jouée par Toinette (Julie
Sicard) un peu plus subtile, mais il faut bien reconnaitre que la
représentation donnée en ce 24 septembre 2019 était formidable.
Gallienne ne se prend pas pour Gallienne (ouf !) mais met toute sa force et son talent au service d’une pièce qui résonne tout particulièrement dans le magnifique théâtre Montansier de Versailles qui – même s’il fut édifié un siècle après la mort de Poquelin – nous donne l’impression d’assister à une représentation à la Cour du Roi Soleil. Les comédiens sont épatants, avec une mention spéciale pour la petite fille incarnant Louison, qui est bluffante de talent).
Une fois de plus, Molière triomphe à Versailles : le public est debout pour l’acclamer, et c'est mérité !
Jusqu'au 26 septembre 2019
Théâtre Montansier, Versailles

Le CV de Dieu, Fournier, Bénureau, Balmer, La Pépinière

Avec le temps, Dieu s’est transformé en rentier qui se la coule douce au soleil (une création qui lui rapporte 92M€ de droits d’auteur annuels). Mais voilà, Dieu « s’emmerde tout seul là-haut ». Que voulez-vous, les couchers de soleil c’est bien joli mais ça ne comble pas son homme, et encore moins son Dieu.
« Moi la poésie, ça me les gonfle ! »
Pour tuer Son ennui, Dieu décide de chercher un travail et passe donc une semaine d’entretiens afin de tenter de convaincre le DRH d’une grande société de l’embaucher. D’abord impressionné par son interlocuteur et à la limite de l’obséquiosité, le recruteur s’enhardit rapidement et commence par reprocher à Dieu le kitsch de ses couchers de soleil. Il faut dire qu’il s’y connait en matière de bon goût, ce DRH qui est aussi peintre amateur : mettre ainsi du rose à côté du violet, c’est du grand n’importe quoi, comme Picasso.
Qui d’autre que Didier Bénureau pourrait incarner ce DRH retors et revanchard qui se paye le culot d’enguirlander Dieu ? Il Le jalouse, Le cuisine avec ses « questions pyscho », Le somme de s’expliquer sur les imperfections de Sa création avant de carrément L’engueuler. Parce qu’il ne faudrait pas s’y tromper : « Ici c’est moi le patron, on n’est pas à l’église ! C’est clair ? »
Face à lui, Dieu (un Jean-François Balmer blasé à souhait) tâche de faire bonne figure. C’est qu’il le veut ce job ! Alors face aux saillies de l’intraitable DRH, Dieu argumente et tente de Se justifier : « L’Homme est impossible à contenter ».
Faussement naïf, le texte de Jean-Louis Fournier est un petit bijou qui apporte des réponses aux critiques généralement adressées à Dieu (pourquoi mourir, pourquoi les catastrophes naturelles, pourquoi je perds mes cheveux etc.). Ce texte drôle et intelligent nous invite à voir le bon côté de la vie. Epurée et classique, la mise en scène signée Françoise Petit n’est pas miraculeuse mais se met agréablement au service du texte.
Jusqu'au 6 janvier 2019
Théâtre de la Pépinière
du mardi au samedi à 19h
Matinée les dimanches à 16h

Le Révizor, Nicolas Gogol, Paula Giusti, Montansier

L’histoire se passe il y a très longtemps « quelque part entre la Russie et l’Argentine ». Le bourgmestre d’une petite ville est informé de la visite prochaine, impromptue et incognito, d’un inspecteur du gouvernement. Et comme tous les notables locaux ont quelques « petits péchés » sur la conscience, ils se démènent pour dissimuler le chaos qui règne dans la ville. Au tribunal, les gardes élèvent des oies dans le hall tandis que le juge, passionné de chasse, y a installé un chenil. A l’hôpital, les (trop) nombreux malades sont soignés sans médicaments car, s’ils doivent guérir, ils guériront.
Or justement, se sont récemment installés dans un auberge un saltimbanque fauché comme les blés, Ossip, et son pantin. Les deux inconnus sont immédiatement pris par nos braves mais malhonnêtes notables pour l’inspecteur (le Révizor) et son serviteur. Ossip comprend vite l’aubaine qui se présente et emmène la ville dans un tourbillon mythomaniaque. Plus les mensonges sont gros et plus la ferveur se déchaine car tous pensent avoir à faire à « quasi un général, tant qu’à faire, un généralissime ».
Le Révizor effraye les hommes et charme les femmes, et les événements surnaturels se multiplient. A l’hôpital les malades « guérissent comme des mouches », tandis que l’argent remplit miraculeusement les poches d’un Ossip qui prétend collecter les pots de vin pour son soi-disant maître : « mon maître, il aime que le manger il soit le plus mieux », et il aime qu’on me traite avec égards « moi qui ne suit qu’un esclave ».
Si l’histoire du « Révizor ou l’inspecteur du gouvernement » de Nicolas Gogol est bonne, la représentation proposée dans le magnifique Théâtre Montansier de Versailles (un bijou de théâtre à l’italienne) est excellente à plusieurs égards. Le décor est sobre mais nous n’avons pas besoin de plus pour nous projeter volontiers dans l’histoire. L’interprétation des comédiens est juste : tous dosent parfaitement le ridicule de leur personnage pour nous faire rire sans cabotinage. La scène où les hommes viennent tour à tour corrompre Ossip est très drôle ; il y a juste ce qu’il faut de rythme et d’absurdité pour ne pas verser dans une bouffonnerie trop lourde. Le travail avec la marionnette mérite lui-aussi le détour, particulièrement le tango argentin dans lequel il emporte les femmes subjuguées par le charme qu’elles lui prêtent. Enfin, la musique jouée en direct se met au diapason et au service de l’action, sans se mettre en avant.
Si le Révizor passe dans votre ville, courrez céder à sa folie !

Eugénie Grandet, Balzac, La Guillonnière, Théâtre Montansier

Par le passé, Eugénie Grandet m’a déjà plu deux fois. La première lorsqu’à l’adolescence j’ai lu le roman d’Honoré de Balzac, et la deuxième en visionnant la belle adaptation télévisuelle signée Pierre Moustiers en 1994, avec Jean Carmet dans le rôle du père Grandet. Le 12 décembre dernier, la Compagnie « Le temps est incertain… » m’a donné une troisième occasion d’apprécier cette œuvre, au théâtre cette fois.
Le père Grandet est un avare digne de celui de Molière. Homme le plus imposé de sa ville, il n’en compte pas moins jusqu’aux morceaux de sucre et se montre avare en tout, même en paroles (il règle l'ensemble de ses affaires en quatre phrases : « je ne sais pas, je ne puis pas, je ne veux pas et, surtout, nous verrons cela »). Il inculque à sa fille unique, Eugénie, le culte de l’argent qu’il met au-dessus de tout, mais c’est sans compter sur l’Amour qui vient bouleverser la jeune femme et ses certitudes.
Un décor réduit à l’extrême (à la façon des Bouffes du Nord) illustre le dépouillement auquel l’avare astreint sa famille et permet au spectateur de mieux se concentrer sur l’écriture magnifique de ce texte visionnaire.
« Les avares ne croient point à une vie à venir, le présent est tout pour eux. Cette réflexion jette une horrible clarté sur l’époque actuelle, où, plus qu’en aucun autre temps, l’argent domine les lois, la politique et les mœurs. (…) Quand cette doctrine aura passé de la bourgeoisie au peuple, que deviendra le pays ? »
Le texte est beau mais difficile. Comment adapter au théâtre la richesse de la langue de Balzac sans la réduire aux dialogues ? Le metteur en scène Camille de la Guillonnière trouve la solution en ne distribuant pas vraiment les rôles mais en faisant tourner la parole entre les comédiens, la représentation ressemblant alors plus à une lecture qu’à une pièce de théâtre. Et c’est tant mieux en l’occurrence !
Bien sûr, il y a quelques maladresses dans la mise en scène, comme ces phrases prononcées à l’unisson par les six comédiens. Ce procédé fut à la mode il y a quelques (dizaines d’) années et je me souviens que toutes les adaptations/captations de pièces de théâtre à la radio en ont usé, jusqu’à l’écoeurement. Le problème de la monodie est qu’elle est fatigante pour l’oreille et, surtout, qu’elle bride les comédiens qui sont obligés de trop articuler et d’adopter un rythme artificiel pour pouvoir se caler les uns sur les autres. Maladroite aussi cette tirade dite par Lorine Wolff sur un rythme slamé façon lascar.
Mais ces quelques défauts ne retirent pas à la pièce ses grandes qualités au nombre desquelles figure la finesse du jeu de ces six jeunes comédiens dont la fougue nous fait ressentir avec émotion la force du drame qui se joue. Mention spéciale à Hélène Bertrand et à Charles Pommel. Elle pour sa touchante interprétation d’Eugénie Grandet et lui pour sa poignante interprétation d’un Grandet agonisant.
Eugénie Grandet, ou l’argent domine les lois, la politique et les mœurs
Les 12 et 13 décembre 2017

Bella Figura, Yasmina Reza, Emmanuelle Devos, Rond Point

En ce soir de novembre, il aura fallu attendre quelques longues et terribles secondes après l'extinction des feux pour que le public commence à applaudir mollement. Au départ, les spectateurs semblaient pourtant bien disposés ; pour preuve les rires provoqués par cette première réplique pas forcément très drôle :
" BORIS... Ou alors on prend une chambre à l’Ibis et je vais directement te sauter... Je préférerais !
ANDREA... A l’ibis...!"
L’histoire en bref : une femme découvre d'abord que son amant l’a invitée dans un restaurant recommandé par son épouse, puis elle finit conviée à la table de la meilleure amie de la légitime. Ambiance.
Tout dans cette pièce sonne faux : des décors au texte, en passant par le jeu des comédiens, sans parler de l’image que la parisienne Yasmina Reza - qui signe à la fois le texte et la mise en scène de la pièce - a de la province. L’écrivain(e) entend paraît-il dénoncer les fissures (le vernis qui se craquelle) de la bourgeoisie de province… il faut croire qu’elle ne connait de la province que des clichés. Et puis d’abord, un entrepreneur à gourmette et une préparatrice en pharmacie, cela ne fait pas une bourgeoisie, pas même petite, même en province.
Le rôle de la maîtresse boudeuse sied à merveille à Emmanuelle Devos et à son sempiternel air narquois. Elle ne se départ pas de sa moue moqueuse ou, devrais-je plutôt dire, de sa tête à claques. Lorsqu'elle dit "je me sens tellement seule", ça tombe à plat au lieu de nous émouvoir. (Je l’avoue, je n’apprécie pas la comédienne et ne suis donc pas forcément objectif ; mais après tout, qui m’oblige à l’être ?!)
Louis-Do de Lencquesaing incarne sans relief le mari trompeur tandis que Camille Japy, dans le rôle de la meilleure amie de l’épouse cocufiée, surjoue un peu la bourgeoise pètesec. Micha Lescot et Josiane Stoléru, dans le rôle respectivement du mari et de la belle-mère de la copine, sauvent la soirée en insufflant un peu de vie à cette pièce fadasse. Micha Lescot est savoureux dans son rôle de tête à claque (heureusement d’un autre genre qu’Emmanuelle Devos).
Yasmina Reza nous convie à la table ennuyeuse de gens ennuyeux qui ont des problèmes ennuyeux. Au bout d’une demi-heure poussive, un mini coup d’éclat nous fait espérer que la pièce commence enfin. La poussière retombe malheureusement aussitôt, ce qui permettra aux plus fatigués des spectateurs de se rendormir tranquillement. C'est dommage car l'on était presque prêt à mettre la monotonie du début sur le compte d'un subtil effet d'ambiance.
Soyons honnêtes, la pièce n'est pas particulièrement mauvaise et l'on a déjà vu bien pire, c'est sûr. Reste que si Yasmina Reza voulait restituer l’ennui de la vie en Province, on peut dire qu’elle a atteint son but.
Jusqu'au 31 décembre 2017
Durée 1h30

mémoires d’un lutteur de Sumô
Si l'on n'y prend pas garde, on peut penser que le sumô est un combat aussi inepte qu'éclair entre deux gros types qui se rentrent dedans sans finesse.
Mémoires d'un lutteur de sumô nous fait découvrir un univers complexe et passionnant où les enjeux dépassent la simple issue d'un combat.
Kazuhiro Kirishima est un garçon robuste et costaud. Il a 15 ans lorsqu'il est repéré pour entrer dans une école de sumô de Tokyo. Il lui faudra se résigner à quitter son village et les siens et faire preuve d'une abnégation admirable pour tenter de devenir professionnel.
La difficulté principale sera, pour lui qui fait à peine 90 kg, de prendre les kilos qui lui manquent pour faire le poids face aux autres lutteurs. Il évoquera pudiquement et humblement toute la difficulté qu'il y a à supporter des régimes hyper caloriques indigestes et qui lui ôtent tout plaisir de manger.
Kazuhiro Kirishima raconte sa vie simplement, avec une sobriété et une humilité toutes japonaises. Il nous explique le parcours d'un sumô et nous convainc de la difficulté à atteindre les sommets de la hiérarchie, et surtout à s'y maintenir.
On apprend aussi que la carrière d'un sumô n'est pas linéaire, que sa progression se fait en dents-de-scie et qu'un champion peut se retrouver assez facilement rétrogradé et perdre ses avantages. La rétrogradation n'est cependant pas forcément synonyme de baisse de popularité car le public n'apprécie pas le lutteur pour ses victoires mais pour son courage. C'est pourquoi un perdant peut être plus acclamé qu'un vainqueur.
Kazuhiro Kirishima démontre également que les sumôs, qui apprécient l'art et dont la formation comprend l'apprentissage de la calligraphie japonaise, sont loin d'être dépourvus de sensibilité, voire de grâce.
Il faut saluer le travail remarquable de la traductrice, Liliane Fujimori, qui complète le récit par des commentaires particulièrement bien documentés et intéressants et dont la passion manifeste pour le sumô (ou au moins pour Kazuhiro Kirishima) est assez communicative.
Mémoires d'un lutteur de sumô vous permettra en tout cas de ne pas être un de ces lourdauds qui se demandent : "Comment peut-on être fasciné par ces combats de types obèses aux chignons gominés ?", et qui affirment, à tort, que "Ce n'est vraiment pas un sport d'intellectuel !"
Picquier Poche - 262 pages

Le Professeur Rollin : déroutant et désopilant
 Docte et légèrement pompeux, le Professeur Rollin nous édifie à l’occasion de l’une de ces merveilleuses conférences dont il a le secret. Il se passionne pour l’histoire d’une biche qui, par un matin de 1957 à Cologne, en Allemagne, a surgi sur un terrain vague avant d’en repartir. Toute la question, cruciale, vitale, étant de savoir si elle est repartie « tout court » ou si elle est repartie « aussi sec »…
Docte et légèrement pompeux, le Professeur Rollin nous édifie à l’occasion de l’une de ces merveilleuses conférences dont il a le secret. Il se passionne pour l’histoire d’une biche qui, par un matin de 1957 à Cologne, en Allemagne, a surgi sur un terrain vague avant d’en repartir. Toute la question, cruciale, vitale, étant de savoir si elle est repartie « tout court » ou si elle est repartie « aussi sec »…
Le Professeur répond aussi au courrier, abondant, des admirateurs qui s’en remettent à lui pour savoir s’ils sont racistes ou encore pour comprendre pourquoi le raisin est appelé blanc ou noir alors qu’il ne l’est pas.
Au gré de formidables et nombreuses digressions, chaque lettre donne l’occasion au Professeur de (dé)montrer, l’étendue de sa Connaissance (véritable puit sans fond) et de nous délivrer des vérités cinglantes et définitives, loin de toute langue de bois :
« le paprika ne mérite pas de figurer sur la liste des épices ».
Nouveauté : le Professeur Rollin évoque désormais des questions d’actualité. Ce faisant, il nous déroute un peu car nous l’attendions sur un registre plus surréaliste, comme à son habitude. Pourtant, Rollin parvient subtilement à nous montrer que la bien-pensance, présente, pesante, envahissante est d’une absurdité comique lorsqu’elle nous pousse, par exemple, à nous demander : « je préférerais que mon fils ne soit pas homosexuel. Suis-je homophobe ? »
Une fois encore, François Rollin ne nous fait pas rire en surfant sur le trivial, le vulgaire, le quotidien. Rollin distille un humour fin, intellectuel mais tellement plus drôle !
Il faut par ailleurs rendre hommage au comédien que l’on décèle sous le costume du Professeur. Les émotions sont finement jouées et je tire mon chapeau à François Rollin d’avoir appris un monologue aussi long et décousu.
A partir du 21 Octobre 2015 (Du mercredi au samedi à 19h00)
Théâtre Michel, Paris 08
Durée :1h25
http://www.theatre-michel.fr/

Quand Rocco Siffredi prend le porno par les cornes
Alors que Nadine Morano, mi-chèvre mi-FN mi-black mi-beurre salé, a squatté à peu près tout ce qui se fait cette semaine de chaines info, de 20h, de 13h, de 7h, de moins le quart, à en frôler l’indigestion télévisuelle, pour une fachoterie primaire ; la Russie canardait la Syrie, coin coin, Platini et Blatter l’avait dans le cucul, l’ONU commençait son scandale de corruption, pourtant il joue pas au foot, enfin je crois pas et Nice nous refaisait le scénario des Revenants Saison 2 avec des inondations option barrage qui craque, avec module reportages façon « quitte à avoir des journalistes là-bas autant inonder (jeu de mot pourri, je vous l’accorde) les téléspectateurs d’histoires jolies pour faire pleurer ou faussement passionner » avec une foultitude de héros d’un jour, celui qui a sauvé le chien de la vieille, celui qui a stoppé la pluie avec son tahiti douche personnel, celui qui a sorti la vieille dame de la voiture et avec son chien en plus s’il vous plait, le tout sans même une chanson de Dick Rivers, qui n’a jamais autant bien porté son nom, pourtant promoteur s’il en est de la baie des anges…
Et en parlant de Dick, bah justement, parlons-en…y’a sujet.
Et oui ! Au milieu des giclées de catastrophes naturelles, des éjac de bombes sur la gueule à Daesh et des slips sales de la FIFA et de Ban-ki-moon n’amasse pas mousse, le king of the show me your dick, the porn star absolue, la poutrelle italienne, que dis-je l’anaconda du calebard, j’ai nommé Rocco Siffredi, annonçait une nouvelle qui allait réjouir les conseillers d’orientation de tous les collèges et lycées d’Europe, Rocco prenait le porno par les cornes, et annonçait en grande pompe (oui, florilège de jeux de mots luxurieux… et c’est pas fini) qu’il allait créer une Université du porno, mais puisque basée en Italie « Universita del porno » dans la langue des papes ! Pas très catholique tout ça.
On imagine d’ici les options et l’emploi du temps des jeunes étudiants de la kékette :
8h-9h : Levrette Niveau 2 avec Mme Samantha Youporn, réputée pour son tatouage d’un aigle en slip en bas des reins.
9h-10h : Musculation du prépuce avec élastique fluo avec Mr John Biroot.
10h-10h15 : Récrée avec nombreux jeux comme : chatte perchée, la Maquerelle, touche touche nunusse, boules au prisonnier, le facteur est passé mais dans ton cucul, l’épervers (1-2-3 épervers sortez !), échanges de cartes pazizi spéciales lauréates hot d’or 2015, shufumi-moilatoute-jsuispastasoeur.
10h15-12h15 : Histoire de l’art de la fellation asiatique avec Mme Katsumi
12h15-14h : Pause déjeuner avec spaghetti boulognaises au menu puis possibilité d’assister à la conférence de Jackie et Michel intitulée « Merci qui ? »
14h-15h : Cours de scénario avec écriture de textes principalement fait de cris à base de voyelles, exemple « o oui, o oui, o oui », option consomme niveau 2 à base de « mmmmmmmmmmmmmmmm »…avec le professeur Bobby Enlarge Yourpenis.
15h-16h : L’art du déguisement en réparateur de machine à laver, en chauffeur pour bourgeoise en chaleur ou encore en plombier animé par les Frères Mario.
16h-17h : Cas pratique : Le gang bang niveau 1, à 8, niveau 2, à 16, niveau 3, à + de 50 ; test de résistance et autorisation du médecin à fournir au préalable.
17h-18h : Conférence-débat « santé » animée par Angel Péné et JC Tration : Un régime diététique à base de pruneaux est-il compatible avec le métier ? Avec un débat qui risque de rentrer dans les anales.
Enfin, selon le règlement intérieur il est strictement interdit de fumer des cigarettes dans les locaux, seules les pipes sont autorisées.
Voilà, une nouvelle qui réjouit oh oui le plus grand nombre, qui change un peu de Morano et de la Syrie, caleçon propre exigé, Rocco nous fait rêver,
Allez, j vous embrasse, j’ai sexe.

Chante chante danse là le Valls Gate, chouette
Décidément le football est en pleine foforme en ce moment et abreuve nos chaînes infos (si on le dit vite ça fait « chez nympho », j’avais jamais fait gaffe, ça m’étonne de moi…) !
Après le Fifa Gate, où Michel et son orchestre l’UEFA ont crié au loup devant les agissements historiques de Sepp Blatter, voici les gars de l’Europe du foot impliqués dans un Gate pour eux par effet de billard à trois bandes (non, pas Adidas, c’est une expression, ça me fatigue de devoir tout expliquer à chaque chronique, faut que je refasse de la radio moi) avec ce qu’il est désormais courant d’appeler le « Valls Gate ».
Pour mémoire, les Forbans avaient anticipé avec leur très fameuse chanson « Chante chante, danse là le Valls Gate, chouette, c’est sympa tu verras, viens, surtout n’oublies pas, prends ton jet république emmènes tes gosses et tais toi ! », maintenant qu’ils chantent dans les meetings du Front Marine Le Bleu de Le Pen, ils ne se refusent rien (je sens que je vais prendre un procès via Maître Collard moi…).
Résumons-nous, notre 1er ministre au teint halé et aux cravates façon JP Foucault dans « Qui veut gagner des millions » s’est offert un week-end de printemps un aller-retour Poitiers/Berlin en jet de l’Etat, au frais de la princesse, et les princesses c’est nous, youhouuuu comme on est belleessssss avec nos robes à paillettes.
Pourquoi Poitiers ? Non pas pour fêter le 1283ème anniversaire du gain de la bataille anti sarasins de Charles Martel, 1283ème (vous pouvez vérifier si vous voulez…oui le truc date de 732) ça voudrait pas dire grand-chose comme date d’anniv ; mais bel et bien pour participer, en mode on est des cools foufous on met même pas de cravates, au congrès truc rassemblement cambadélisco-progressiste avec tout plein de gens du PS dedans, bref, le congrès du Parti Socialiste qui avait donc lieu à Poitiers.
Pourquoi Berlin ? Non pas pour fêter les 61 ans d’Angela qui était partie elle au G7 avec Barak, François, Paul et les autres, encore moins pour passer une soirée spéciale new wave en reprenant en débardeur et en crête tous les titres du groupe du même nom, Berlin, donc (à savoir un seul connu : « take my breath away », B.O de Top Gun !!! Haannnn mais tout s’explique, Top Gun = Avion = Jet = Voyage Poitiers/Berlin) ; mais bel et bien pour aller voir la finale de la Ligguuuueeeee des Champions (je chante hyper bien l’hymne) qui voyait s’affronter le Barça et la Juve (Barcelone contre Turin pour ceux qui ne regardent pas le foot).
Oui mais voilà, Poitiers-Berlin, sur 12heures top chrono, même invité par Platoch, en train, c’est pas jouable ; déjà parce que Poitiers, t’arrives à Montparnasse, tu prends le métro, direction gare de l’est, t’en as pour 3h, puis, tgv vers Strasbourg, puis sandwich, pause à la Brasserie Kaslbrau, tu prends 1h, direction Berlin, en plus t’as tes deux mômes, qu’ont faim, qu’ont soif parcequ’ils ont rien voulu manger chez Kalsbrau pour cause de « j’aime pas le choux ça sent pas bon », bref, la galère, t’arrives au stade tu sais pas où est la loge, tu tournes en rond, t’es fouillé, bref, tu rentres en tribune vide à 6h du mat’, y’a plus que les jardiniers et les joueurs de foot qui tringlent les hôtesses dans les vestiaires, sale spectacle pour les mômes, et faut déjà repartir. Pas pratique.
Sinon, t’as l’avion, oui mais même si tu voyages léger, le temps de faire Poitiers-Roissy ou Orly Ouest, en plus à Antony ton ticket de métro marche pas pour prendre le OrlyVall (ici on dira OrlyValls, comme ça pour le fun), tu passes le check-in, le check-out, le check-check-check your booty baby, idem, t’arrives à l’Aéroport de Berlin hyper crevé moitié en sueur, genre tu vas avoir des auréoles sous la chemise et t’as toujours tes deux gamins qu’ont faim et soif parce que t’as pas voulu payer un Mars à 15€ dans le Easy Jet, t’arrives à 4h30 du mat’ en tribune, bref, ça change rien, bref, t’auras même pas vu Messi, Messi qui ? Messi la SNCF ou Air France. Donc oui, tu fais bien de prendre un Jet de la République pour aller plus vite, normal !
Et bien vous me croyez ou pas, y’a 77% des français (source Ipsos-Sofres-Institut Pain Harris double tranche moelleuse spéciale petit dej avec des pépites de chocolat) qui ne comprennent pas la démarche du premier ministre ! Les 23% restant sont retraités en vacances à Pornic ou enfants de moins de 12 ans et ne savent pas qui est Valls, forcément ça fausse les stats.
Bon, en attendant, le Manuel a décidé de tout rembourser de sa poche personnelle, mine de rien c’est quand même nous qui payons son salaire par remontée comptable de nos impôts personnels…autant dire qu’on tourne en rond.
Rédemption personnelle pour cas analogue : Devant le scandale naissant au sein de la rédaction d’etat-critique.com, je me suis engagé à rembourser le pass Navigo payé par le site avec lequel j'ai emmené mes enfants à Disneyland Paris et initialement destiné à aller voir la TV chez des copains dans le Val de Marne…je m’excuse, ça va hein !!!
J’vous embrasse,

L’Ours, La demande en mariage, Anton Tchekhov, Lucernaire
Ce succès joue les prolongations au Lucernaire jusqu'au 22 mars ! Allez-y !
La demande en mariage: ou comment demander la main d'une jeune femme sans se perdre en élucubrations ni tomber d'apoplexie? Et surtout comment, entre homme et femme, sortir du piège tendu par le "démon de la contradiction"?
L'ours: qui croire? L'homme déçu par les femmes, ou la femme déçue par les hommes? Tandis que la veuve jure une éternelle fidélité à son défunt mari, le créancier introduit dans sa maison qui réclame bruyamment son dû, ne connaît aucune femme constante. Quand la femme (qui se veut l'égale de l'homme) dégaine les pistolets et accepte le duel, commence une joute à mort. Qui cédera le premier? Par quel miracle s'achèvera l'éternelle dispute d'orgueil entre homme et femme?
Philippe Collin dans le rôle du père dans "La demande en mariage" et du créancier mal léché dans "L'Ours" est convaincant: belle présence scénique, prestance, ruptures de rythme, tout témoigne d'un jeu maîtrisé. Séverine Cojannot interprète avec malice les 2 rôles féminins de ces 2 comédies en 1 acte, réunies ici sans entracte. Elle passe avec facilité de la campagnarde qui ose à peine espérer séduire un jour un fiancé, à la veuve trompée et pourtant fidèle, retranchée entre ses 4 murs, que vient déranger un créancier têtu et misogyne. Dans le rôle du fiancé de "La demande en mariage" et du valet de "L'OURS", Nicolas Haudelaine est moins convaincant que ses compères, mais le trio fonctionne et fait preuve d'une belle énergie.
Une belle réinterprétation de ces 2 comédies, et une belle découverte pour ceux qui pensaient que l'œuvre de Tchekhov se cantonnait au drame existentiel!
Prolongation du 4 février au 22 mars
Au Lucernaire, Paris 06
Du mardi au samedi à 19h
Les dimanches à 15 h
Relâches les 14 et 24 février et 6 et 19 mars
Durée : 1h15

De Beaux Lendemains
De beaux lendemains est un très beau roman raconté à quatre voix, celui d’un drame frappant un petit village de l’état de New York. Russel Banks s’affirme vraiment comme un auteur américain incontournable.
L’histoire a pour fond l’Amérique profonde : un village confronté à un hiver rigoureux et surtout à un drame qui affecte la plupart de ses habitants. La brume, la neige et le froid sont omniprésents et participent de l’ambiance éthérée, de l’humeur cotonneuse qui envahit les gens démolis par un accident venu bouleverser leurs vies.
Russel Banks donne successivement la parole à quatre personnages, chacun nous racontant avec sa propre sensibilité les répercussions du drame sur sa vie.
Les uns se montrent ivres de douleur : "J’étais complètement soûl et je réagissais automatiquement comme si ma bouche avait été un répondeur téléphonique : Vous êtes bien chez Billy Ansel, il a subi une perte irréparable et s’est rendu compte qu’il est inconsolable et par conséquent, afin de vous éviter de la gêne et à lui-même de l’embarras, il s’est retiré de tout contact humain normal"…
… Tandis que d’autres cherchent à se blinder en relativisant : "Notre façon de considérer la mort dépend de l’image qui nous en est préparée par nos parents et les gens qui les entourent, et de ce qui nous arrive au tout début de notre vie. Et si on avait une juste conception de la mort - comparable à la certitude qu’on a de la réalité des impôts, par exemple - si on ne s’obstinait pas à se figurer qu’on peut y échapper, il n’y aurait peut-être jamais eu de guerre."
Russel Banks a incontestablement un grand talent pour restituer l’état d’esprit de ses personnages, leur intériorité. Il parvient étonnamment à changer d’écriture et de style selon le tempérament du personnage à qui il donne vie.
Il est fascinant de voir comme l’auteur réussit à créer chez le lecteur une empathie, une identification à chacun de ses personnages qui sont pourtant très différents les uns des autres.
336 pages - Babel

la imaginacion del futuro, la-resentida, Abbesses
Engagée dans un théâtre politique, la compagnie LA RE-SENTIDA nous impressionne toujours autant par son énergie bouillonnante et son hystérie "sous contrôle".
Vue au Nouveau Théâtre de Montreuil en octobre dans "Tratando de hacer una obra que cambia il mundo", la compagnie LA-RESENTIDA est à nouveau au programme du Théâtre de la Ville, Paris, dans une création mise en scène par Marco Layera: "LA IMAGINACION DEL FUTURO".
La jeune et brillante troupe s'attaque cette fois à son mythe national: Salvador Allende. Les années de socialisme démocratique (installé au pouvoir par les urnes) au Chili furent brèves (de 1970 à 1973) et enthousiasmantes, vivante alternative aussi bien au communisme totalitaire qu'au capitalisme libéral. La fin d'Allende et de l'expérience socialiste chilienne furent atroces, Allende se donnant la mort dans son palais assiégé par l'armée, et le pouvoir se trouvant entre les mains bientôt sanglantes d'Augusto Pinochet. 24 ans après sa passation de pouvoir et 8 ans après sa mort, après une lente transition vers la démocratie, la troupe interroge ce passé et en particulier la figure héroïque d'Allende. Mais interroge aussi notre présent, notre pseudo-démocratie où l'indifférence a pris le pas sur la solidarité. Et en cela, interroger le Chili d'aujourd'hui revient à interroge l'Europe d'aujourd'hui. Comme s'ils se demandaient: que serions-nous devenus si Allende s'était maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Lui, serait-il devenu un vieux semi-dictateur accroché à son fauteuil de commandant en chef? Ou un pantin entre les mains de ministres, professionnels de la communication? Que serait devenu le rêve socialiste pacifique confronté à la réalité de la mondialisation?
Ils imaginent, transposent, expérimentent, et donnent à voir une sorte de spectacle total halluciné... car ces comédiens se font par moments danseurs de hip hop, slameurs (au cours d'un hommage fantasque au Président), cascadeurs dans les nombreuses bagarres entre Ministres, marionnettistes (dans une scène de confession émouvante, celle d'une enfant victime de la dictature à venir); ce sont tous de formidables performers, les femmes en particulier sont belles, puissantes et s'exhibent. Le style tient de l'expressionnisme (scandale, grimace, hystérie violente) et du burlesque, comme une parodie sombre de cabaret: des moments de très bon divertissement (show musical ou comique) auxquels on tordrait le cou. On tremble un peu de honte et de peur mêlées.
Marco Layera exprime ainsi sa vision:
"Le théâtre peut amuser et ne pas être superficiel. Aucune opposition n’existe entre le fait de faire réfléchir et celui de faire rire ; ces termes ne sont pas dichotomiques. D’autres points de vue peuvent s’ouvrir : ceux de l’ironie, de la cruauté, de l’absurde et de l’humour. Ils ont un pouvoir beaucoup plus inquiétant et corrosif, et qui en somme font réfléchir."
Découvrez ou redécouvrez cet engagement décapant
au Théâtre de la Ville, les Abbesses, jusqu'au 11 décembre 2014.

Un music hall féerique tiré d’une histoire pleine d’enchantement. Après 13 ans de triomphe à Broadway, il s’installe au théâtre Mogador à Paris. Une version fidèle au Disney et drôle par ses objets animés! (suite…)

Le Plancher, Perrine Le Querrec
« Alexandre, Joséphine, Paule, Simone et Jeannot : il y avait une histoire où les parents étaient heureux et Paule, Simone et Jeannot trois enfants gais et insouciants. Mais on n’était pas dans cette histoire-là. »
(suite…)

Christophe Alévêque, Super Rebelle… et candidat libre!
Super Rebelle, le porte parole des muets !
 En 2009, on s’était éclaté avec Christophe Alévêque est Super Rebelle !...enfin ce qu'il en reste.
En 2009, on s’était éclaté avec Christophe Alévêque est Super Rebelle !...enfin ce qu'il en reste.
En 2011, avec les Monstrueuses Actualités de Christophe Alévêque on se demandait s’il n’était pas temps pour l’humoriste polémique de changer de formule. En 2012, on a certes bien ri avec ce nouveau spectacle et cette candidature d’un super héros fantoche qui caricature à peine une campagne assez lamentable.
Super Rebelle moque les mesures de la dernière chance d’un gouvernement qui veut nous sortir de la crise en augmentant le prix des cigarettes et des sodas, certainement parce que Liliane Béttencourt ne fume pas !
Il revient sur cette (pré) campagne présidentielle qui tourne à la mascarade : DSK qui monopolise l’attention pendant 4 mois (et qui préfère baiser la bonne plutôt que de baiser la droite !), Mohamed Merah devient le programme unique de l’ensemble des candidats…
Evidemment, Nicolas Sarkozy reste une cible idéale pour Christophe Alévêque, même s’il n’oublie pas de railler aussi la gauche (« Un robot avec un post-il marqué « Changement » serait élu, mais c’est sans compter sur la force de frappe du Parti Socialiste »), ou encore le centre (Bayrou est en dehors de la campagne à force de se vouloir au dessus du débat).
Alévêque Super Rebelle multiplie les tirades aussi drôles que vraies (« Le peuple a peur, mais ce sont les marchés qu’il faut rassurer ») mais force est de constater que, à l’instar de la Présidentielle 2012, SuperRebelle semble s’essouffler un peu.
Jusqu'au 6 mai 2012
Théâtre du Rond Point
http://www.theatredurondpoint.fr/

Les Monstrueuses Actualités de Christophe Alévêque
« L’Homme est bon. Sauf des fois, sauf des fois. L’Homme est beau. Sauf des fois. »
Christophe Alévêque est impitoyable. Il entame en début de spectacle une revue de presse du pire, égrenant comme un chapelet des faits d’hiver tous plus sordides les uns que les autres, et les agrémentant de commentaires émétiques. Il ponctue le récit de parents qui prostituent leurs enfants et les font participer à des films pornos, par un horrible « Pour une fois que les enfants servent à quelque chose. » !
Il fustige le politiquement correct, qui interdit d’aller aux putes, mais pas d’en être une (à propos de Bernard Kouchner). Il tape à droite (« Hortefeux, le seul ministre de la Vème République condamné pour injure raciale, mais qui n’a pas encore démissionné. L’exception culturelle française ») et à gauche (« La Tunisie est un exemple, elle prouve que sans parti d’opposition, on peut se débarrasser d’un Président. Nous, en France, le problème, c’est qu’on a un parti d’opposition »).
Alévêque tente vaillamment d’échapper au piège qui consisterait à taper sur Sarkozy, cible trop facile mais inévitable des humoristes. Il ne pourra pas s’en empêcher et ne résistera pas au plaisir de glisser quelques peaux de bananes sous les talonnettes présidentielles.
Fin 2009, Alévêque nous avait régalés avec une excellente revue de presse à la fin de son spectacle Christophe Alévêque est Super-Rebelle.
Il renouvelle l’expérience cette année avec un enthousiasme émoussé. Christophe Alévêque hésite sur son texte. S’il sait où il veut en venir, il a du mal à nous mener jusqu’à la chute, si bien qu’il ponctue sa revue de presse de dizaines de « Bon », « Euh… Euh… », et autres « Bon ben », assez déplaisants.
Certes, les textes collent tant à l’actualité immédiate que Christophe Alévêque ne doit avoir le temps de les apprendre par cœur, mais j’aurais préféré qu’il lise franchement son texte, quitte à être moins mobile sur scène.
C’est très dommage car, sur le fond, Alévêque tape fort et vise juste. Il met en exergue le tsunami d’informations qui nous noie et nous abrutit à longueurs de journaux et de journée. Il fustige le sentiment d’angoisse que les médias entretiennent savamment, comme pour alimenter notre peur panique du terrorisme, de la grippe, de la neige etc. … Une angoisse qui fonctionne comme un « épouvantail à cons », et qui détourne notre attention des sujets vraiment importants.
Comme dans Christophe Alévêque est Super-Rebelle, l’humoriste ne peut s’empêcher de pousser la chansonnette enragée, accompagné de ses trois musiciens impassibles. Encore un qui aurait voulu être une rock-star…
Peut-être est-il temps de changer de formule ?
http://www.theatredurondpoint.fr/

Dîtes-leur que je suis un homme, d’Ernest J. Gaines
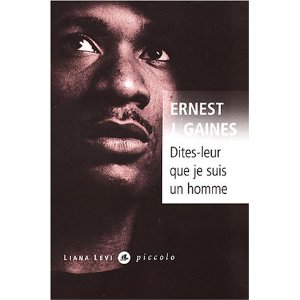
Dans la Lousiane des années 40, un braquage minable d’une épicerie tourne mal : quelques morts et un gamin qui se retrouve condamné pour avoir été présent sur les lieux du crime. Etait-il simple spectateur ou participant actif à la rapine ? Toujours est-il que ce jeune homme, un (sale) nègre pour les uns, un frère pour les autres, sera investi par son peuple de la mission de montrer aux blancs qu’il est bien un Homme. (suite…)

Christophe Alévêque est Super Rebelle !…enfin ce qu’il en reste
 Christophe Alévêque est Super Rebelle… il est aussi super drôle !
Christophe Alévêque est Super Rebelle… il est aussi super drôle !
Christophe Alévêque entre en scène affublé d’un déguisement de super-héros démodé. Il reste muet quelques instants, l’air accablé et dépité. Et de fait, il n’a pas le moral.
« Super Rebelle n’a plus la pêche : hier j’ai croisé un camion de flics, je ne les ai même pas insultés ».
Mais Super Rebelle retrouve bien vite son énergie, galvanisé par ce monde moderne si facile à railler tant il est absurde. Avec son débit de mitraillette et sa voix légèrement haut perchée, Christophe Alévêque commence par fustiger l’argent, ce « doudou d’adulte » et la société de consommation qui consiste à « acheter des choses dont on n’a pas besoin avec de l’argent qu’on n’a pas ».
Il enchaîne sur les média et leur fascination béate devant l’incontournable hyper-président (pas le camembert, le Nicolas) avant de faire un sketch à mourir de rire sur les ados. Je sais, le thème est vu et revu, mais il faut reconnaître que Christophe Alévêque s’en sort vraiment très très bien avec ce sujet.
« Françoise Dolto, sur le fond, elle a raison… le problème c’est qu’on vit en surface ! »
Christophe Alévêque retrouve tellement la forme qu’il se met même à chanter! Il ponctuera son spectacle de trois ou quatre chansons pas vraiment inoubliables mais pas non plus insupportables, un peu à la manière d’un Bénabar. Mais qu’ont donc tous ces comiques, Gad Elmaleh en tête, à se prendre pour des chanteurs ?
On apprécie particulièrement la revue de presse désopilante qui achève de mettre le public dans la poche de Christophe Alévêque. Il parvient à instaurer une complicité étonnante avec les spectateurs qui, malgré la taille non négligeable de la salle, se sentent très proches de l’humoriste. (Les puristes noteront que Christophe Alévêque recycle quelques chroniques, lues notamment dans Siné Hebdo où il officie.)
Christophe Alévêque termine son spectacle en apothéose, nous faisant revivre à la façon d’un exutoire le concert d’investiture de Sarkozy à la Concorde et permettant au public de se lâcher complètement et de quitter la salle heureux. En sortant, j’ai même entendu des spectateurs se féliciter de ce que le spectacle de Florence Foresti était complet.
Du 17 octobre au 14 novembre 2009, Théâtre du Rond Poin

Fragments, Samuel Beckett, Peter Brook, Bouffes du Nord
Un spectacle avec des textes de Beckett, ce Nobel de littérature dépressif et plombant : oh la la, on va pas rigoler ce soir...
Eh bien si !
Peter Brook met en scène cinq courtes pièces de Samuel Beckett, autant de saynètes qui fonctionnent comme des nouvelles théâtrales.
La première pièce, Rough for theater I (Fragment de théâtre I) nous présente un estropié qui se met en tête de guider un aveugle. Rencontre inattendue entre deux souffrances qui rêvent de trouver dans l'Autre un réconfort mais qui échouent pitoyablement à s'abandonner à la confiance et à l'amitié.
Peter Brook met formidablement en scène les textes de Samuel Beckett. Le très beau théâtre des Bouffes du Nord, au dépouillement si poétique, est le lieu idéal pour jouer les textes minimalistes de l'auteur irlandais. (Les textes sont à ce point minimalistes qu'ils n'existent parfois même pas.)
Quant au choix de jouer les textes en anglais (sur-titré en français), ce n'est pas une preuve de snobisme de la part d'un metteur en scène lui-même anglophone. Le jeu en anglais cela permet au spectateur de jouir de la poésie et de la musicalité de la langue de Beckett. C'est particulièrement vrai pour Rockaby (Berceuse), récit concentrique qui tourne en rond et se mord la queue à l'infini, répétant sans cesse l'histoire d'une âme seule qui rencontre son alter ego. L'on n'y comprend vite plus rien (l'incompréhension formelle du texte étant renforcée par la barrière de la langue) mais on se laisse agréablement bercer par la douceur musicale des mots.
Brook tempère la noirceur apparente de Beckett pour mieux révéler l'humour de ses textes. Ainsi, Act without word II (Acte sans paroles II) nous présente deux façons de se réveiller le matin: l'une ronchonne, l'autre énergique. Deux manières de voir une journée qui figurent deux façons de prendre la vie. Or, même le bougon, qui pourrait nous désespérer, nous fait drôlement rire.
Et dans Come and go (Va et vient), ne sont-elles pas franchement comiques ces trois vieillardes assises sur leurs banc, alors qu'elles se délectent des faiblesses de leur amie dont elles dévoilent sans vergogne les secrets?
Un metteur en scène virtuose, un auteur efficace et trois comédiens savoureux (Khalifa Nadour, Marcello Magni et Hayley Camichael): que demander de plus ?!
Jusqu'au 20 juin 2009 Théâtre des Bouffes du Nord www.bouffesdunord.com

Angelin Preljocaj : Annonciation (1995), Centaures (1998) et Eldorado (création 2008)
Le Théâtre de la Ville présente trois pièces du célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj : Annonciation (1995), Centaures (1998) et Eldorado (création 2008). Une soirée de danse à moitié concluante ! (suite…)