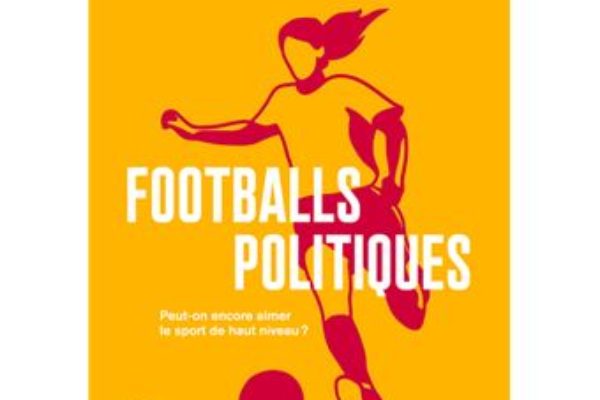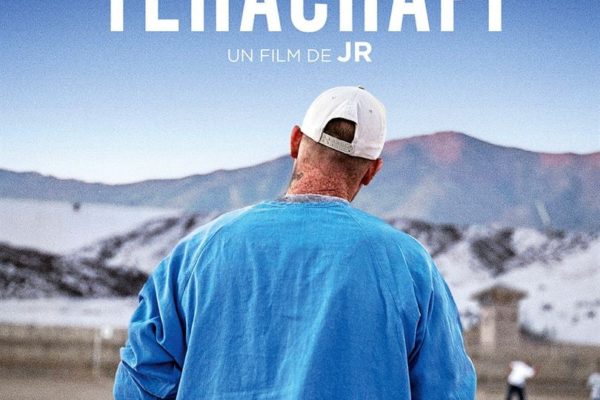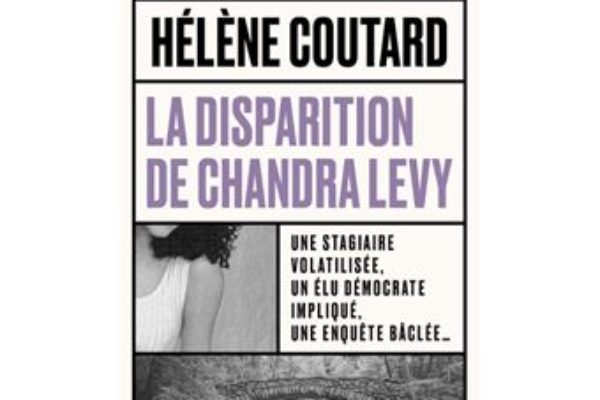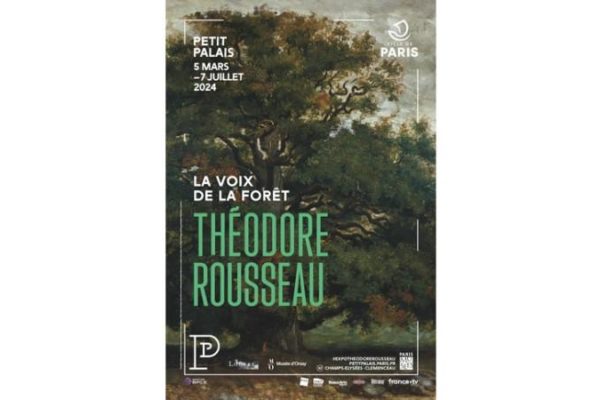Exclusive Stories!
Chère insaisissable, Sophie Tellier, Jean-Luc Revol, Lucernaire


Il y a longtemps et par hasard, j’ai découvert le monde des « demi-mondaines », des courtisanes ou encore des grandes horizontales. D’abord par des livres, puis des expositions. J’avançais dans le temps, de Marie Duplessis à Valtesse de la Bigne. Cette dernière initiera plus tard Liane de Pougy aux plaisirs tarifés, mais aussi à l’amour entre femmes. Belle, élégante, intelligente, Liane (de son vrai nom Anne-Marie Chassaigne), va devenir l’un des personnages incontournables de la Belle Époque. Des dizaines d’hommes vont en être fous et se ruiner pour elle. A la même époque, l’Amazone de Rémy de Gourmont (Natalie Barney), Émilienne d’Alençon et tant d’autres seront subjuguées par la jeune femme. Voire plus. Particulièrement Natalie Barney, pour laquelle Liane de Pougy a écrit Idylle Saphique, ouvrage évidemment scandaleux, car on est au tout début du XXe siècle. Danseuse, courtisane, femme d’esprit, chanteuse, écrivain, Liane de Pougy aimait profondément la liberté. Sa liberté, fait rare à l’époque. Anti conformiste, elle aura eu mille vies, avant de finir son existence pieusement sous le nom de… sœur Anne-Marie de la Pénitence !
Il est étonnant que ce personnage n’ait jusqu’à présent jamais ou presque intéressé le cinéma et le théâtre. Mais c’est chose faite désormais grâce à Sophie Tellier, remarquable dans le personnage de la divine Liane.
Quel parcours que celui de Sophie ! D’abord danseuse avec Roland Petit, elle se forme ensuite au chant lyrique et à l’art dramatique. La voici chorégraphe associée de Mylène Farmer pendant six ans, et bien d’autres la solliciteront par la suite pour ses multiples talents, dont la liste est longue : coach, chanteuse, auteure, metteur en scène, actrice. Elle a d’ailleurs reçu le prix Alterpublising en 2019 pour Chère insaississable.
Dès le début de ce spectacle musical, les expressions, les tenues, les chansons, les mots, tout nous rapproche de la grande horizontale. C’est ainsi qu’on l’imagine. Il y a peu de traces de Liane de Pougy aujourd’hui, à l’exception de photos et d’un petit film restauré de 1906, Aladin ou la lampe merveilleuse.
Mais fermons plutôt les yeux, écoutons Sophie nous parler en imitant parfois Liane. Écoutons Sophie nous raconter l’histoire de la courtisane. Le silence se fait.
Puis regardons-la se mouvoir, danser, s’asseoir avec une réelle sensualité. S’étendre voluptueusement sur une méridienne. Faire d’une simple robe, d’un boa jeté négligemment, une jolie petite scène. Écoutons-la encore une fois. Elle chante les Sœurs Etienne, André Hornez, puis ose un pas dans le temps avec Boris Vian, avant de choisir notre époque, de Gainsbourg à Jean Ferrat et Juliette. Elle s’empare de ces voix de façon juste et agréable, convaincante. Son comparse, Djahîz Gil, l’accompagne au piano et l’on sent entre eux une réelle complicité.
Sophie a une vraie présence scénique. On se regarde, assis dans nos fauteuils, sans un bruit, l’on écoute ces mots d’avant et l’on rit. Ah, quand elle imite Missy ou plutôt « Max », la maîtresse de Colette, c’est si drôle ! L’humour est très présent dans ce spectacle.
Interrogée sur sa vie, Liane de Pougy avait un jour déclaré :
« Ce n'est pas moi que je vends, c'est du rêve ».
A la question : « Pourquoi Liane de Pougy ? » Sophie Tellier répond : « J'ai choisi Liane parce que j'ai ressenti beaucoup de correspondances entre son parcours de femme et le mien. Il m'a semblé que beaucoup de femmes pouvaient s'y retrouver, et qu'il y avait toujours un écho avec notre société actuelle... Les espoirs, les illusions, les désillusions d'une vie de femme. Et la vie des femmes m'importe. »
Souhaitons-lui de faire vibrer encore de nombreux hommes et… beaucoup de femmes.
Jusqu’au 30 juin 2024
Du mardi au samedi à 21h, dimanche 17h30
Théâtre du Lucernaire - 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris
Durée : 1H20
Tarifs : 30€ / 25€ / 15 €/ 10 €
Lorsque l’enfant parait, André Roussin, Michel Fau, Montansier Versailles


Charles Jacquet (Michel Fau), la petite soixantaine bedonnante, est fier de lui : Sous-Secrétaire d’État à la Famille, il vient de faire adopter la fermeture des maisons closes et d'alourdir les peines frappant l'avortement.
Problème : une avalanche de bébés va lui tomber dessus en rentrant chez lui, après sa journée de travail. Son fils attend un enfant hors mariage et sa femme, Olympe (Catherine Frot), est enceinte. Il se passerait bien de ces grossesses qui viennent compliquer sa vie et télescoper la morale qu'il revendique.
"Je t'ai fait un enfant ? A ton âge, ça n'est pas sérieux !"
En parlant d'âge, et sans vouloir être désobligeant, il y a quand-même un côté surréaliste à confier le rôle d'un personnage censé avoir la quarantaine à une comédienne qui, à la ville, a près de 70 ans. Malheureusement, Michel Fau (qui signe la mise en scène) n'utilise pas ce décalage pour en faire quelque chose de comique ; il fait comme si de rien n'était et signe, d'une manière générale, une mise en scène classique au possible, aussi plate et prévisible que le texte de la pièce.
Mais qu'est-ce qui a pris à Michel Fau de monter cette comédie qui aurait pu s'appeler Retour vers le futur tant on se croirait revenu dans les années 1950 ?! Le texte écrit en 1951 par André Roussin (qui deviendra Académicien en 1973) est terriblement bourgeois et daté, ce qui plait manifestement à un certain public qui y trouve toujours son compte, même au XXIème siècle.
En ce 29 mai 2024 au Théâtre Montansier de Versailles, les spectateurs grisonnants et bourgeois sont venus voir des célébrités. C'est un bon public, c'est-à-dire un public indulgent et conquis d'avance (Michel Fau est d'ailleurs applaudi avant même d'avoir prononcé un mot). Il faut dire que ce soir, le Bourgeois et sa bourgeoise ne seront pas choqués, on les brocardera très gentiment avec un humour de bon ton légèrement suranné. Cela donne ce genre de répliques:
- (à propos d'une femme enceinte) "J'espère qu'elle ne couve rien."
- (au téléphone avec la grand-mère qui entend mal) "Son voyage tombe à l'eau. Non, je dis: son voyage tombe à l'eau. Allo ?"
- à chaque évocation d'un couple qui attend un enfant : "Mais comment ont-ils fait?!" (C'est le running gag de la pièce...)
Les gags sont pathétiques, les quiproquos et le dénouement se voient arriver à des kilomètres et la pièce n'a aucun rythme. Cela fait bientôt deux ans qu'ils tournent et, manifestement, ils sont tous fatigués de jouer cette histoire qu'ils récitent presque mécaniquement. La mollesse des comédiens est renforcée par un décor en entonnoir qui réduit l'espace scénique à quelques mètres carrés et leur interdit presque de bouger. Michel Fau n'a même plus la force de cabotiner, et seule Catherine Frot a parfois quelques sursauts d'énergie. Et je ne vous parle même pas des seconds rôles...
Pour tout dire, je n'ai pas ri une seule fois en deux heures et j'ai eu l'impression de passer la soirée avec Édouard Balladur. Mais ce qui m'a troublé, c'est que dans la salle, tout le monde semblait s'amuser, à l'exception notable de ma sœur et de moi qui avons ce soir-là tenu le rôle des deux vieux du Muppet Show. Les seuls qui avaient l'air de s'emmerder autant que nous deux, c'étaient les comédiens !

Jusqu'au 1er juin 2024
Théâtre Montansier Versailles
de 15€ à 39€
De André Roussin, mise en scène Michel Fau assisté de Quentin Amiot
Décor Citronelle Dufay, costumes David Belugou, lumières Antoine Le Cointe
avec Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer ou Laure-Lucile Simon, Quentin Dolmaire ou Baptiste Gonthier, Hélène Babu ou Anne-Guersande Ledoux, Sanda Codreanu, Maxime Lombard
La planète des singes : le nouveau royaume, Wes Ball, 20th Century Fox


Des générations après la dernière trilogie et son héros simiesque César, les singes continuent d’être un miroir étonnant de nos sociétés et nous rappellent que l’on est bien peu de choses dans le grand tout du blockbuster mais aussi de la vie…
C’est ce qu’on aime dans La Planète des Singes : cette science-fiction intelligente qui fait le point sur la prétention des êtres humains et sur leur véritable place dans le Monde. Le Nouveau Royaume continue de nous questionner, un peu à la manière d’Avatar, avec de l’action mais aussi un classicisme presque désuet.
C’est ce qui surprend dans la première partie du film. C’est un gros blockbuster hollywoodien. Les images nous impressionnent. Les effets spéciaux sont clairement saisissants. La caméra virevolte autour de singes de plus en plus agiles. Et pourtant le réalisateur Wes Ball (qui nous avait perdu agréablement dans la trilogie du Labyrinthe) prend son temps. Il installe lentement son héros, Noa, primate qui deviendra petit-à-petit un vrai héros. Le film ressemble presque à un western avec les figures imposées.
Le film devient ensuite un récit initiatique. Il se refuse au second degré trop facile. C’est un film assez sérieux et on s’étonne de voir un film qui ne veut pas nous plonger dans un simple plaisir régressif. C’est la vraie qualité de toute la saga, occupée à s’adresser, avec plus ou moins de bonheur, à notre intelligence.
Le film a donc toujours cette idée d’être un objet politique, désenchanté et contemporain. Hélas, Wes Ball se laisse aller à une œuvre trop remplie, avec trop d’envies et trop de moments inutiles. Après l’apocalypse, on aurait presque aimé un film plus direct et plus sec.
Mais ce nouvel épisode, selon son succès, devrait être le premier d’une nouvelle trilogie. Ça aussi, cela se voit un peu trop. Les intentions sont bonnes mais le destin de Noa est parfois broyé par les effets spectaculaires et des scènes d’action étirées jusqu’à l’ennui.
Il ne faut pas bouder son plaisir, la Planète des Singes montre qu’Hollywood ne veut pas seulement nous abrutir.
Au cinéma le 08 mai 2024
avec Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon et William H Macy -
20th Century Fox
2h25
Mad Max Furiosa, George Miller, Warner Bros


Du sable, de l’essence et de la furie en pagaille, George Miller continue de confondre tragédie et film d’action avec un nouveau volet de la saga Mad Max, déjanté, intrigant et ridicule aussi.
Il a bientôt 80 ans mais George Miller continue de jouer aux petites voitures et de provoquer des accidents. A sa manière si pétaradante. Le cinéaste n’est pas toujours facile à suivre. Ses choix de films sont déconcertants mais quand il se replonge dans l’univers déglingué de Mad Max, il continue de nous surprendre.
Neuf ans après Fury Road, le revoilà avec une nouvelle odyssée mécanique, centrée cette fois-ci sur Furiosa, personnage interprété d’abord par une charismatique Charlize Teron. Ce nouveau film raconte sa jeunesse et son goût insatiable pour la vengeance.
Encore une fois, cela ressemble à un gros blockbuster décérébré avec des personnages grimaçants, des bruits de moteurs assourdissants et de monstrueuses poursuites. Tout le film est d’ailleurs imaginé comme une immense fuite en avant autour d’un enfant traumatisé qui deviendra une guerrière absolue.
Avec elle, on assiste à des cascades folles et des idées de bastons complètement folles. Jusqu’à la folie. La réalisation est savoureuse, redoublant d’énergie pour nous mettre au cœur de l’action. Miller invente des séquences complètement dingues grâce à une grammaire cinématographique qui rend lisible une vraie folie visuelle et parfois morale.
Car George Miller n’est pas qu’un spécialiste de la cascade chromée, c’est un type qui s’interroge sur le besoin d’archétypes et la construction des mythes et des légendes. Furiosa serait une tragédie grotesque, un peu longue, mais véritablement sincère.
Le film est un peu à l’image de Dementus, le grand vilain de l’histoire, joué par un Chris Hemsworth déchaîné, derrière son faux nez tout aussi grossier. Il est à la fois grotesque et fascinant. Bavard, ce personnage nous met dans un vrai inconfort, clairement voulu par le réalisateur, ravi de ne pas nous ménager, au-delà de la violence appuyée qui fait le style de Mad Max. Les hommes ici sont des bouffons affreux, de grands enfants tristes, des pantins face à des destins trop grands pour eux. Reste la figure iconique de Furiosa, silencieuse et mortelle.
Au bout de deux heures et demi, le spectateur sort déboussolé. La virtuosité y est pour beaucoup mais pas seulement… c’est tout le charme et le plaisir du cinéma de George Miller, auteur vraiment à part
Au cinéma le 22 mai 2024
avec Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth, Lachy Hulme et Tom Burke
Warner Bros
2h28
Hot Galleries
Our Editor Reviews
Trending Story

L’Incroyable Épopée de François 1er, Rémi Mazuel et Alain Péron, Contrescarpe

Chacun a une image qui lui vient à l’esprit à l’évocation de François 1er. Il y a d’abord la salamandre, qui avait paraît-il des pouvoirs magiques et que l’on retrouve dans ses châteaux de Fontainebleau et Chambord. A Fontainebleau, sa salle aux plafonds magnifiques est, elle, éblouissante. Bien sûr, il y a aussi la fameuse date de1515, (Marignan) qu’on a tous appris à l’école.
Ce spectacle étonnant nous emmène dans un voyage à travers la vie de cet incroyable personnage, attaché à la France et à notre langue, comme aux lettres et aux arts. Il a d’ailleurs invité Leonard de Vinci. Et puis, comme d’autres rois (beaucoup d’autres rois), il aimait la guerre et les femmes. Un monarque incroyable et dont cette pièce retrace de façon précise et enlevée la vie riche et mouvementée.
Rémi Mazuel, qui interprète le souverain, a un point commun avec lui. Car, si le roi mesurait 1,98 m, l’artiste atteint 2,20 m. Son parcours professionnel est riche et varié : comédien, auteur et metteur en scène. Par ses déplacements sur scène, la puissance de sa voix, les expressions de son visage, on croit voir ce roi qu'on n'a jamais vu. Et de cette épopée royale, il fait une comédie audacieuse mais qui sonne toujours juste. Les décors évoquent une bande dessinée jolie et colorée, les costumes réussis et aux couleurs seyantes (surtout pour les belles robes) ajoutent une touche plaisante à l’œuvre.
Les clins d’œil nombreux (ah, l’amusante fausse barbe de Leonard de Vinci) ajoutent à L’Incroyable Epopée de François 1er une belle touche d’humour.
La grande silhouette souple de Romain Mazuel, sa façon de se mouvoir, ses phrases légères et sa manière bien à lui d’interpréter ce grand roi est troublante. On peut imaginer que François 1er ressemblait un peu à ce personnage.
Précision : le comédien est aussi metteur en scène et co-auteur de ce texte truculent sans temps mort.
Les autres comédiens sont étonnants, jouant avec brio plusieurs personnages historiques, qui parviennent tous à nous faire rire.
Fanette Jounieaux-Maerten, qui interprète Marguerite de Navarre, la sœur du roi, réussit la prouesse d’être également Marie Tudor, Léonard de Vinci et la duchesse d’Etampes. Marguerite de Navarre a tenu un rôle très important auprès de son frère, et la comédienne, avec son port de tête à la Edwige Feuillère, lui donne de l’épaisseur et nous laisse aussi imaginer ce que fut cette femme pour le roi.
Fanette Jounieaux-Maerten n’en est pas à son coup d’essai.
Avoir mis en scène le fameux Voyage avec un âne de Stevenson et avoir chanté dans La fille de Mme Angot sont d’autres cordes à son arc.
Corentin Calmé est également un comédien au parcours éclectique et riche : passer de Molière à Musset, certes c’est classique mais tenter ensuite M. Lepic dans Poil de carotte éveille la curiosité. Lui non plus n’hésite pas à se mettre dans la peau de plusieurs personnages, en l’occurrence Charles Quint et surtout un abbé, un de ceux - très écoutés - qui jouaient un rôle de conseil autrefois. Il pourrait en faire trop mais ce n’est jamais le cas. Nombre de prêtres sont interprétés de manière exubérante ou sombre, trop de gestes, trop de phrases ou presque rien. Ici, le comédien a trouvé le ton juste.
Quant à Anaïs Alric, polyvalente est le premier adjectif auquel on pense. Tout d’abord dans L’Incroyable Epopée de François 1er. Louise de Savoie, Henri VIII, Peperona et Jacques Cartier ? C’est elle. Et quoi d’autre voyons ? Les costumes et la scénographie de la pièce, c’est encore elle. Tout simplement.
Et avant ? Oh, rien qu’une vingtaine de pièces, des tournées à l’étranger… En tant que metteur en scène, adaptatrice et comédienne. Forcément, elle crève la scène, elle est là, et bien là, Louise de Savoie, la maman de François et Marguerite protectrice, jalouse, inquiète aussi. Vive, présente, elle a une palette d’expressions riche, du grand rire à la contrariété. Et quand elle incarne Jacques Cartier, ses gestes, ses expressions sa façon d’être font frissonner. Ou rire.
Prolongations jusqu’au 24 juin 2024
Théâtre de la Contrescarpe - 5, rue Blainville 75005 Paris
Une comédie historique de Rémi Mazuel et Alain Péron
Avec Anaïs Alric, Corentin Calmé, Fanette Jounieaux-Maerten, Rémi Mazuel
Durée : 1H20 | De 12 à 35 €