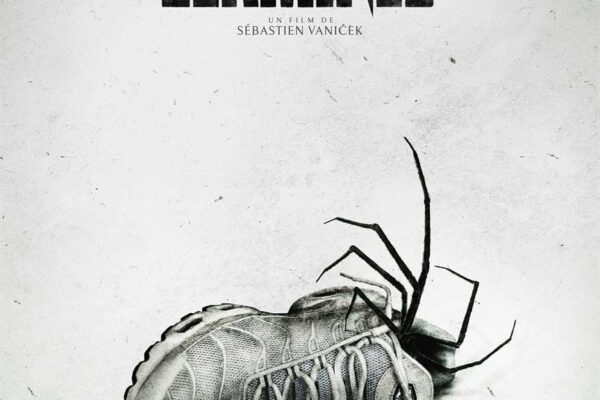Situation amoureuse c’est compliqué

Manu Payet est un chouette mec qui fait des vannes. C'est tout ce qu'on retient de sa première réalisation.
Manu Payet, on le sait, est un type marrant. Il a toujours une bonne vanne dans sa poche pour se faire apprécier. Il a un regard malicieux. Son look passe partout le rend accessible. On s’attache facilement à ce petit gars rieur et déconnant.
Avec son ex, Géraldine Nakache, il est l’un des rares à revendiquer une influence totale de la comédie américaine. Il ne cache pas cette admiration. Il tente d’en faire une force. Dans Tout ce qui brille et Nous York, les œuvres de son ex, mais aussi Radiostars, il cherche ce rythme inimitable et d’une efficacité redoutable que l’on trouve uniquement dans les comédies américaines.
Manque de bol, Manu Payet reste Français. Son cinéma est un ersatz à son image : sympa mais inoffensif. Son premier film est une tentative, jamais pathétique, d’offrir une comédie sentimentale made in France avec un peu plus de punch, de quotidien et d’air du temps.
Il a bien le talent pour décrire les faiblesses d’un trentenaire, un peu bobo, un peu glandu. Il nous décrit un adulescent avec pas mal de clairvoyance mais il se plante très largement dans son illustration qui pourrait faire passer Loulou la Brocante pour du Spielberg !
La grande et bonne idée c’est de prendre deux comédiennes affolantes, au sex appeal et atouts différents. Elles sont là pour faire tourner la tête de son héros, qui a quelques jours de son mariage, tombe sous le charme de son amour de collège…
Mais c’est filmé avec une mollesse impardonnable. Quelques effets donnent l’illusion de modernité un peu hype. Tout sonne faux. Des lumières jusqu’au décor ! Le quiproquo est un peu lourd. Les seconds rôles sont trop caricaturaux pour vraiment nous faire rire. Il veut jouer sur l’émotion et le rire mais ni l’un ni l’autre ne sont réellement stimulés. Ce n’est pas très compliqué : sa comédie est ratée !
Van Gogh / Artaud. Le suicidé de la société / Musée d’Orsay

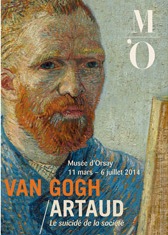
Quand le boucher roux invite Artaud le Mômo à Orsay...
« Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire, non dans l'histoire des choses peintes mais dans l'histoire historique tout court » dixit Artaud. C'est en s'appuyant sur l'exposition de 1947 consacrée à Van Gogh au Musée de l'Orangerie et le livre d'Antonin Artaud Van Gogh ou le suicidé de la société, que le Musée d'Orsay propose d'exposer une quarantaine de toiles, de dessins et de lettres du peintre néerlandais ainsi que quelques œuvres graphiques du poète-dessinateur.
A la demande de Pierre Loeb et suite à la lecture d'un article du Dr Beer croyant déceler chez le peintre une schizophrénie du type dégénéré, Artaud se rendit à l'exposition Van Gogh au musée de l'Orangerie. Il écrit alors un texte dans lequel il accuse ouvertement la société d'avoir poussé Van Gogh au suicide aidé par le monde des psychiatres et son frère Théo. Établissant des parallèles avec Baudelaire, Poe, Nerval et Lautréamont, en quelques pages, Artaud explique que la société a toujours cherché à étouffer, à écarter les extra-lucides. Van Gogh est de ceux-là. La clairvoyance mène fatalement à la mort.
Avec la force vitale propre à l'écriture d'Artaud, l'ouvrage fait ressortir toute l'étrangeté et le génie du peintre : "Rien que peintre, Van Gogh, et pas plus, pas de philosophie, de mystique, de rite, de psychurgie ou de liturgie, pas d'histoire, de littérature ou de poésie, ses tournesols d'or bronzé sont peints : ils sont peints comme des tournesols et rien de plus, mais pour comprendre un tournesol en nature, il faut maintenant en revenir à Van Gogh, de même que pour comprendre un orage en nature, un ciel orageux, une plaine en nature, on ne pourra plus ne pas en revenir à Van Gogh."
Cette exposition des œuvres de Vincent Van Gogh laisse toujours sans voix. On a beau connaître La nuit étoilée, L'église d'Auvers-sur-Oise, La Chambre et les autoportraits issus du Musée d'Orsay, lorsque ces œuvres sont présentées au milieu d'autres plus rarement exposées, la magie opère. Étonnant Crabe sur le dos, flamboyant Cyprès avec deux femmes, superbe Entrée de carrière près de Saint-Rémy, originaux Tournesols venant de Berne, romanesque Fauteuil de Gauguin, mouvementés Lauriers roses de New York, misérable Paire de chaussures qui rappelle les fameux Souliers. L'exposition articulée autour de citations du livre d'Artaud est belle et à voir.
On demeure étonné devant le choix des sujets, notamment les natures mortes (crabe sur le dos, chaussures) qui ont cette couleur roturière et ces positions provocantes, loin de tout conformisme. Une peinture anti-bourgeoise. Qui à l'époque aurait pu accrocher de telles œuvres sur les murs de son salon ? Quand on sait que ces œuvres s'achètent aujourd'hui des millions d'euros...
Et puis il y a la touche, les formes, les volutes et ces traits qui dansent dans des tourbillons de couleurs, ces convulsions dont parle Artaud. "J'aime mieux, pour sortir de l'enfer, les natures de ce convulsionnaire tranquille que les grouillantes compositions de Breughel le Vieux ou de Jérôme Bosch qui ne sont, en face de lui, que des artistes, là où Van Gogh n'est qu'un pauvre ignare appliqué à ne pas se tromper."
Les paysages, les autoportraits, et particulièrement la thématique sur l'hôpital Saint-Paul montrent un Vincent aspiré par l'infini. Regardez Les Arbres dans le jardin de l'hôpital Saint-Paul, ou la forêt de pin au déclin du jour. La verticalité en action... Le Docteur Gachet et son abyssale mélancolie... De quoi vibrer, assurément.
Un seul regret peut-être dans cette exposition, le choix des textes d'Artaud affichés, comme une volonté de rester dans le sens descriptif des œuvres. Il y a bien une salle dédiée à la lecture de l'analyse d'Artaud du Champ de blé aux corbeaux, mais le style poétique, la vigueur insurrectionnelle de l'ouvrage d'Artaud passent sans doute trop inaperçus dans cette exposition. En somme, il ne suffit pas de dire qu'il est poète pour qu'on le sente. On sent le génie de Vincent mais assez peu la fulgurance de Mômo. C'est pourquoi, on recommande activement la lecture de Van Gogh le suicidé de la société pour compléter habilement l'exposition.
Mais pas de doute possible. A voir et revoir, à lire et relire.
Visite virtuelle : Van Gogh / Artaud au Musée d...par FranceInfo
http://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html
Sébastien Mounié
Histoires d’Hommes

Magali Bros, Pauline Devinat et Aude Kerivel font leur possible dans le rôle de femmes incomprises, blessées et lassées par les hommes, mais le résultat n’y est pas.
Le texte tout d’abord, et c’est malheureusement sans appel, ne touche pas. Ayant pour noble ambition de raconter la difficulté des relations amoureuses, il abandonne vite la complexité du sujet pour se contenter de nous présenter trois caricatures de femmes dépendantes et complètement instables, le tout forcément englué dans le pathétique. La vie de ces femmes se résume au nombre de regards ou d’appels d’hommes reçus, comme si rien d’autre et visiblement pas l’amitié, alors que les trois femmes nous sont présentées comme des amies chères, n’était susceptible de leur apporter le moindre soupçon de joie de vivre. Spectateur attristé, on se doute, mais l’auteur ne semble pas s’en soucier, que leur blessure est sûrement plus profonde, plus vieille, et doit avoir des répercussions plus globales que sur leurs seules relations amoureuses.
La mise en scène ensuite, les danses hirsutes notamment et les passages chantés particulièrement, ne convainc pas. Certes, les personnages devraient être des femmes normales et donc, pas forcément des chanteuses, mais pourquoi avoir choisi d’insérer ces airs parfois joyeux, parfois tristes, parfois virulents, jamais percutants, si ce n’est pour confirmer l’instabilité chronique des personnages?
En bref, seul l’effort et le dévouement des actrices est à saluer. Dommage.
Jusqu'au 27 avril 2014 Théâtre de Poche Montparnasse
1er avril

Non Stop

En attendant de faire un troisième Taken, Liam Neeson continue de jouer au chat et à la souris avec des vilains terroristes. Si vous avez le mal de l’air, abstenez vous !
Acteur massif et souvent formidable, Liam Neeson est devenu un peu par hasard, une star du film d’action. C’est un peu le Charles Bronson des années 2000. Suite au carton de Taken, il a donc pris l’habitude de se battre contre des comploteurs de tout poil, avec une certaine efficacité.
Heureusement son physique cabossé amène toujours une pointe de profondeur. Et dans Non Stop, c’est amusant de le voir coincé dans un avion qui a l’air bien trop petit pour lui. Il ne faut pas s’étonner si son personnage picole, mal dans sa peau, jamais remis de la disparition de sa fille.
Ce Marshall des airs est donc harcelé de textos inquiétants. Quelqu’un dans l’avion lui promet d’exécuter un voyageur toutes les 20 minutes si on ne lui donne pas la somme de 150 millions de dollars.
L’ancien flic va donc faire de nombreux allers retours dans le cockpit pour découvrir qui est le machiavélique maître chanteur. Les possibilités sont nombreuses et le scénario tient en haleine le spectateur un temps.
Jusqu’à l’invraisemblance. Les trognes soupconneuses de certains clients et membres de l'équipage inquiètent. Puis le film décolle très haut dans le grand n’importe quoi. Les procédures sont aussi extravagantes que les rebondissements. Le réalisateur espagnol Jaume Collet Serra est assez doué dans la virtuosité. On ne s’ennuie pas une seconde mais très vite, on ne joue plus avec Liam Neeson dans le jeu du chat et de la souris.
Le film pourrait même jouer avec la schizophrénie du personnage central assez border line mais Non Stop reste un film d’action honnête qui, dans un sous genre très codifié, arrive à nous divertir. En tout cas, on aimerait que l’acteur n’atterrisse vers un prévisible Taken 3 où il continuera à casser des bras et tirer dans tous les sens !
De Jaumet Collet Serra
Avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy et Michelle Dockery – Studio Canal – 26 février 2014 – 1h40
Captain America 2 / Anthony RUSSO et Joe RUSSO

Captain America n’aime pas la guerre préventive. Il fallait bien un film pour nous rassurer !
Le premier épisode était très sympathique. Le film avait la bonne idée de se passer dans les années 40 et rappelait par certains aspects les « serials » de l’enfance de nos grands parents (et un peu Indiana Jones aussi). Un pari culotté pour un film de super héros assez agréable à regarder et qui soignait son coté rétro avec bon goût.
Dans le monde moderne, les choses se compliquent. Le pauvre Captain America ne comprend plus grand-chose en géostratégie. Il n'y a plus d'uniformes nazis pour identifier le mal. Il a bien du mal à accepter de buter des ennemis de son pays qui pour l’instant n’ont rien fait.Mais pourraient faire selon ses nouveaux chefs!
George Bush et les conservateurs ne vont pas apprécier ! D’autant que le Captain va découvrir un terrible complot à l’intérieur du SHIELD, l’équivalent de la CIA dans le monde pétaradant des héros Marvel !
Aidé par le Faucon Noir et la Veuve Noire, il va donc piétiner tout un tas de traitres et d’affreux méchants qui veulent sacrifier la liberté au nom de la sécurité. Sur le papier on pourrait croire que le héros américain est devenu un affreux hippy !
Le vieux film d’aventures était l’essence du premier film. Le second s’amuse à copier le thriller politique en récupérant même Robert Redford, ravi de replonger dans les conspirations comme dans Les trois jours du Condor ou Les hommes du président. Les cinéphiles apprécieront l’inspiration de cette saga qui réussit à ne pas lasser par des élans patriotiques que suggère le blanc héros, toujours joué avec énergie par Chris Evans.
Réalisateurs de petites comédies inoffensives, les frères Russo arrivent même à faire quelques scènes d’action lisibles et ludiques, ce qui n’est pas un mal en cette période de bouillie visuelle hollywoodienne.
Pourtant le concept « conspirations et espionnage » n’est pas assumé d’un bout à l’autre du film. Le film respecte trop sagement le cahier des charges, sans surprise. Chaque scène est découpée pour répondre à l’attente oisive d’un spectateur qui a déjà tout vu en matière de super héros. A l’image du héros, le film reste lisse et trop sage. Content de savoir qu’il n’est pas un patriote décomplexé, mais on aimerait bien que Captain America s’encanaille un peu !
Pierre Loosdregt
A mon âge je me cache encore pour fumer

Confidences de femmes dans un hammam à Alger. Une pièce courageuse qui donne à rire et s’émouvoir.
On se verrait entrer au hammam d’Alger tant le théâtre embaume le savon noir. Trois générations de femmes se retrouvent pour un moment beauté à l’abri des regards. Un moment entre elles pour se parler. Lieu propice des confidences. Elles expriment leurs aigreurs, leurs souvenirs, leur sensualité. Et parlent des hommes bien sûr ! Ah ces hommes. Source de leurs joies et de leurs souffrances, ils ne les ont pas épargnés.
Samia aurait voulu être médecin mais travaille au hammam pour rencontrer un mari. Alors elle y rêve d’oliviers, de pamplemoussiers et du prince charmant qui viendrait la chercher sur son chameau blanc. La violence, la misère mais aussi le courage a traversé la vie de Fatima. Mères, amantes, laïques ou religieuses, les neuf femmes sur scène crient leur désir de jouissance.
L’auteur Rayhana se dresse au travers de cette pièce engagée pour l'émancipation des femmes et contre l'obscurantisme religieux. Ce qui lui a valu une agression musclée… L’origine française des comédiennes les protège quant à elles. On aurait pourtant aimé un casting plus algérien. Certains récits ne sonnent pas toujours justes contés par des Françaises. Linda Chaïb reste la plus prodigieuse de sincérité dans le rôle de Samia. Avec énergie, elle illumine le plateau et touche au coeur.
Sur fond politico-religieux, la pièce souffre par ailleurs du principal défaut de sa qualité. A trop vouloir en dire, elle balaye les drames de la femme algérienne et perd un peu le spectateur. Aussitôt évoqué un destin, on passe à un autre ce qui disperse l’attention. Les mouvements des uns parasitent la parole des autres. Il s’en dit souvent plus à deux ou trois que dans la cacophonie.
Dans le cadre de l’événement Miroirs d’Algérie, le théâtre des quartiers d’Ivry a donné la parole aux hommes dans la pièce Invisibles de Nasser Djemaï puis ici aux femmes dans A mon âge je me cache pour fumer. Deux reflets complexes et sensibles dans le miroir de la société algérienne.
Estelle Grenon
Jusqu'au 30 mars2014 Théâtre Quartier d'Ivry
Les méfaits du tabac

Le dialogue saisissant du théâtre avec la musique !
Denis Podalydès et Floriane Bonanni ont trouvé la place exacte de la musique dans ce monologue de Tchekhov.
A l’occasion d’une conférence dans l’école de musique de son épouse, Nioukhine, admirablement joué par le Michel Robin, lâche le poids de 33 ans de mariage. A la fatigue, l’emprisonnement, l’envie de fuir, l’angoisse et la tristesse de Nioutchkine font écho le chant (Romance op 47 n°1 de Piotr Ilitch Tchaïkovski), le piano (Partita n°2 en do mineur, BWV 826 de Jean-Sébastien Bach) et le violon (Sequenza VIII pour violon de Luciano Berio) de ses filles.
Comme si, dans l’enfermement imposé par la mère, le dialogue entre le père et ses filles ne pouvait être que musical, qu’aux mots trop lourds du père, les filles ne pouvaient répondre que par des notes.
Ainsi, naît un magnifique concert de cordes, des cordes vocales fatiguées de la voix du vieil homme, aux cordes sublimement tendues par sa fille soprano, frottées et pincées par sa fille violoniste et frappées par sa fille pianiste.
De ce dialogue subtil et mystérieux, une chose semble commune aux quatre acteurs, la corde est raide, et la lumière accompagne avec brio la gravité du moment.
Un petit bijou !
Du 18 au 22 mars et du 1er avril au 12 avril 2014
Théâtre des Bouffes du Nord
www.bouffesdunord.com