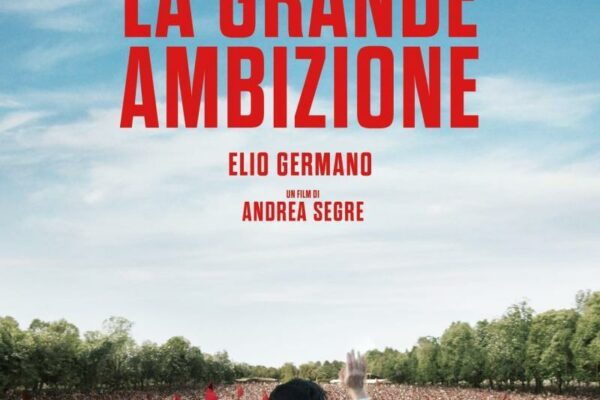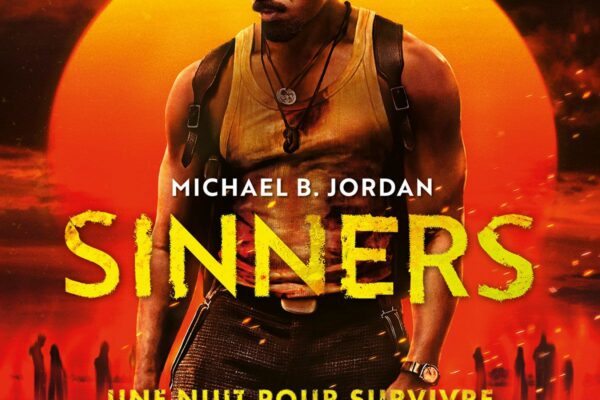Exclusive Stories!
Ulysse, Josette Baïz, Jean-Claude Gallotta, Rond-Point


Ensemble ! Dix-sept interprètes de 10 à 14 ans nous épatent d'emblée par leur parfaite synchronisation qui marque la rigueur et le professionnalisme de leur travail.
Ensemble ! Parce qu'on n'est pas ici dans l'émission Prodiges où de petits compétiteurs jouent à qui sera le plus fort. Ici, on la joue collectif.
Ensemble ! Parce que ces enfants sont issus de milieux divers.
Ensemble ! Parce qu'ils réconcilient danses classique, moderne et de rue.
Ensemble ! Parce que c'est un magnifique travail transgénérationnel entre deux chorégraphes septuagénaires (Josette Baïz et Jean-Claude Gallotta) et des jeunes qui pourraient être leurs petits-enfants.
Ensemble ! Parce que ce spectacle donne de la joie aux petits comme aux grands.
Cela fait 30 ans que Josette Baïz, à travers la Compagnie Grenade, fait confiance à des enfants pour interpréter des œuvres du répertoire moderne. Il faut dire que cet exercice convient parfaitement à Ulysse, une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta datant de 1981.
J'étais tellement absorbé par le spectacle que je me suis demandé comment restituer mon émotion de voir cette jeunesse porter un projet ambitieux tandis que nous, les adultes, pilonnons sans scrupules leur avenir.
Mais ce que je veux garder, c'est le bonheur de voir des enfants donner vie à la danse de Jean-Claude Gallotta qui a conservé quelque chose de la joie de l'enfance avec ses répétitions hypnotiques, ses jetés de bras sur le côté, ses mouvements d'avant en arrière, ces corps trottinants, bondissants et chantonnant qui, régulièrement, marquent le rythme avec leurs mains. Ça a l'air tout simple, et c'est justement ça qui est génial !
Jusqu'au 12 octobre 2025
Théâtre du Rond-Point, Paris VIII
Durée 1H00
de 8€ à 38€
Les petits clichés font de bonnes surprises (Technopolice, Pamplemousse, Al Qasar)


Les clichés sont de la connerie en boite qui permet de vite penser et vite nourrir des banalités souvent lourdingues. Les Italiens parlent avec les mains. Les Anglais vivent sous la pluie. Les Allemands sont rigoureux. Les Portugais sont petits. Les Français sont sales. Les gens des Ardennes sont des tueurs d’enfants. Les parigots ont des têtes de veaux. Ça y va fort !
En matière de musique, si je vous dis Marseille ? Vous allez d’abord certainement penser à un rappeur gitan qui remplit les stades ou un fameux groupe de quinquas qui danse le mia. Et bien entendu, ceux qui connaissent la ville pourront vous dire qu’il y a plus de punk dans l’imagerie de la ville que de rap. Ce que prouve Technopolice et ses mélodies rapides et rêches.
Après des EP remarqués, le groupe signe enfin un premier disque - Chien de la casse - qui est à la hauteur de la réputation. Le quatuor fait dans le vintage avec une capacité d’exécution hors norme. C’est du rock échauffé et du punk limpide.
Ça fusille les conventions et c’est d’une urgence qui va très à la cité phocéenne, bouillon de cultures et de folies en tout genre. Pas étonnant que Technopolice vienne de là : ils sont malpolis, jouent la provocation mais sont d’abord talentueux et ravis de faire la différence. Leur punk vient se cacher derrière des couches new wave ou garage.
La voix est bien sûr pleine d’humour et de rage tandis qu’elle est poursuivie par une guitare en fusion. De loin on pourrait dire que c’est du grand n’importe quoi mais on découvre que c’est vraiment du bel ouvrage.
De la Réunion, vous avez le droit d’imaginer de l’exotisme mais il faut compter sur le groupe fruité Pamplemousse. Ils sont deux et se prennent clairement pour Nirvana, en mode surchauffe !
Porcelain est un album qui fracasse tout. Imaginez que vous ayez le droit de tout casser dans une maison avec une batte de baseball et vous aurez une idée de quoi il en retourne dans ce nouvel album qui ne peut avoir comme adjectif que percutant !
Ça dérouille dans tous les sens et pourtant, on devine au fil des écoutes de jolies nuances qui ressemblent à des petites failles émotionnelles. C’est ce qui rend le punk si touchant : il a quelque chose d’essentiel pour ses artisans. Ici, le groupe a la bonne idée de retrouver les sensations sonores des meilleurs disques grunge des années 90. Cela donne une ribambelle de chansons écorchées et spectaculaires.
Pour finir, nous allons faire un tour chez les têtes de veaux ! Eux aussi doivent vivre avec une pluie de stéréotypes. Si je vous en fais un échantillon, vous allez trouver que cette chronique devient vulgaire. Donc nous allons nous arrêter à la station Barbès. Si chère au groupe FFF, c’est ici qu’un petit Parisien a décidé de nous faire voyager et échapper aux clichés de la capitale pour d’autres stéréotypes, ceux de la world music.
Thomas Bellier est le fondateur d’Al Qasar (qui veut dire la forteresse) et intègre le rock psychédélique des années 70 qui faisait fureur au Moyen-Orient. Voici donc la version franchouillarde d’Altin Gunn. Et cela fonctionne plutôt bien.
Le producteur et ses musiciens réalisent des chansons généreuses et militantes. Effectivement on se promène sur les dunes du nord de l’Afrique mais les mélodies sont ici des reprises et elles profitent pleinement du dépaysement. L’album Uncovered est une bouffée chaleureuse qui nous feraient aimer les poncifs.
L’enfance en lumière, exposition Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) au Petit Palais


A l’occasion des 300 ans de sa naissance à Tournus (Bourgogne), en 1725, le Petit Palais propose de redécouvrir l’œuvre de Jean-Baptiste Greuze, peintre longtemps boudé par les Français – à la différence des Anglo-Saxons et des Américains, pionniers dans sa réhabilitation – en raison du caractère jugé mièvre ou moralisateur de ses scènes de genre.
Adulée jusqu’à la Révolution, au point d’alimenter un fructueux commerce d’estampes, l’œuvre de Greuze passe de mode dès la fin du XIXe siècle, rendue désuète par l’essor du style néoclassique et de la grande peinture d’histoire dont Jacques-Louis David (1748-1825) est le chef de file.
Greuze était pourtant lui-même un novateur : il avait rompu avec le style rococo (scènes galantes, couleurs pastel, et formes incurvées), et la peinture frivole pratiqués par son aîné François Boucher (1703-1770) et son contemporain Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Élève de Charles-Joseph Natoire (1700-1777), connu pour ses scènes mythologiques et religieuses peintes avec grâce et légèreté, il s’en était démarqué par des œuvres inspirées de la réalité quotidienne des classes populaires, dans un style proche de celui des maîtres néerlandais du XVIIe siècle tels que Rembrandt.
Proche de la sensibilité des philosophes des Lumières, de Rousseau, l’auteur d’Émile ou de l’éducation (1762), et surtout de Diderot, qui louait dans ses toiles le réalisme et l’émotion qu’il cherchait lui-même à exprimer dans le « drame bourgeois » – le nouveau genre théâtral dont il était le théoricien –, Greuze a en effet essentiellement peint des scènes de la vie familiale paysanne ou bourgeoise, sensées procurer au spectateur des modèles de vertu et de pédagogie, ainsi que des portraits d’enfants.
Ce sont ces portraits d’enfants justement, peints avec une technique virtuose et une grande sensibilité, qui valent la peine d’être admirés aujourd’hui, pour la valeur intemporelle de ce qu’ils représentent et la finesse d’observation du peintre, mais aussi pour le contexte particulier dans lequel ils s’inscrivent : celui de la reconnaissance, pour la première fois en Europe, de l’importance du temps de l’enfance, des besoins propres et des droits de l’enfant.
L’exposition, très intelligemment, se déploie en sept sections thématiques alternant des portraits d’enfants et des scènes de la vie familiale, sans oublier, en section 5, les nombreuses estampes exécutées d’après ses dessins et peintures. Parmi la centaine d’œuvres exposées, beaucoup sont conservées au Louvre, mais un grand nombre provient aussi de collections particulières, comme les portraits des deux filles de l’artiste, venues de New-York, ou Le Repos ou Silence !, prêté par le roi Charles III d’Angleterre.

Ces sept sections sont entrecoupées, comme dans un drame, par quatre « actes » évoquant les périodes clés de la vie de l’artiste : « La famille Greuze. Théâtre heureux », en introduction, avec des portraits de sa très jolie femme Anne-Gabrielle Babuty et de ses deux filles, ainsi que deux petites period rooms évoquant l’intérieur de l’appartement familial ; « Peintre insoumis et couple haut en couleur », pour aborder les forts caractères de Jean-Baptiste et de sa femme et les tensions au sein du couple ; « Le scandale du Septime Sévère et Caracalla », histoire du cuisant échec de Greuze, en 1769, à obtenir le statut de peintre d’histoire ; en conclusion, « Les infortunes du peintre », sur la triste fin de vie de Greuze, qui finit divorcé et ruiné.
La section 2, « L’enfance d’après nature », présente peut-être les plus beaux portraits d’enfants de l’artiste, avec ceux de la fin du parcours : plusieurs petits garçons rêveurs ou pensifs, l’un concentré sur sa leçon, un autre endormi sur son livre.

Au milieu du parcours, la section 3, « Aimer, allaiter, éduquer », met en perspective les thèmes abordés par l’artiste avec le contexte social du XVIIIe siècle, notamment les idées nouvelles des pédagogues sur l’éducation. L’une des principales nouveautés pour l’époque consiste en la promotion de l’amour maternel dès la naissance, indispensable pour élever l’enfant dans le sens du bien et de la vertu, et, partant, de l’allaitement maternel, ciment de ce lien mère-enfant. La pratique, largement répandue depuis le XVIIe siècle, de la mise en nourrice, est donc décriée. De manière très simple et pédagogique, des extraits de définitions tirés de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sont affichés, au-dessus d’éditions originales des tomes cités. En parallèle, les tableaux de Greuze intitulés Le Retour de nourrice et L’Enfant gâté (gravures exposées) illustrent les effets néfastes de la perte du lien familial, alors que Le Repos ou Silence ! et Les Écosseuses de pois furent pensés comme des modèles à suivre pour les parents.
Dans la section 4, « Histoires de famille », sont exposées les toiles qui firent le succès de l’artiste mais qui nous paraissent aujourd’hui théâtrales et affectées : le Père de famille lisant la Bible à ses enfants, acclamé au Salon de 1755, et L’Accordée de village ou La Remise de dot (1761 ; études pour la toile exposées). On peut pourtant encore y admirer, en plus du rendu virtuose des différentes matières (crépi des murs, vêtements des paysans, bois des meubles, cuivre et terre des ustensiles), les expressions très variées des personnages, notamment des enfants, attentifs, contrits, rêveurs ou distraits. Dans les coins inférieurs de ces deux tableaux, par exemple, un petit enfant, trop jeune pour comprendre la solennité de la scène, joue avec un animal.
La section 6, « La leçon de l’histoire : le fils face au père », poursuit l’exploration des relations familiales avec les personnages singuliers du père – figure centrale de l’autorité au XVIIIe siècle – et du fils aîné : le diptyque de la Malédiction paternelle, composé du Fils ingrat (1777) et du Fils puni (1778), renouvelle l’interprétation de la parabole du Fils prodigue en y associant une réflexion sur l’éducation : si le fils est ingrat et puni (et non pardonné, comme dans la Bible), et que le père lui-même est puni, puisqu’il ne parvient à pas retenir son fils et meurt avant de l’avoir revu, c’est peut-être faute d’une bonne éducation… Juste à côté, le Septime Sévère et Caracalla (L’Empereur Sévère reproche à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner) raconte encore une histoire d’éducation paternelle ratée. Si cette grande composition, de style néoclassique, peut sembler austère, l’étude pour la tête de Caracalla (conservée à Gotha, en Allemagne), au visage crispé de colère contenue, est d’une grande expressivité.
La dernière section regroupe plusieurs portraits de jeunes filles sur le point de perdre la pureté de l’enfance, souvent par la faute d’un prédateur masculin. L’oiseau – essayant de s’envoler, retrouvé mort dans sa cage ou tué par un oiseleur (Le Guitariste ou L’Oiseleur, 1757, musée national de Varsovie) – est souvent le symbole de cette innocence menacée. Plus éloquente, La Cruche cassée (1771-1772), représentation à peine voilée d’une jeune fille victime d’un viol, apparaît extrêmement novatrice dans une époque où la sexualité et les agressions sexuelles étaient taboues. L’exposition se clôt cependant sur une image moins tragique : la réunion exceptionnelle des deux ravissants portraits bucoliques ayant appartenu à la marquise de Pompadour, Un Berger qui tente le sort, conservé au Petit Palais et restauré pour l’exposition, et son pendant féminin, La Simplicité, prêté par le Kimbell Art Museum de Fort Worth.
du 16 septembre 2025 au 25 janvier 2026
Petit Palais, Paris VIIIème
Plein tarif : 14 euros
Tarif réduit : 12 euros
Gratuit : - 18 ans
Made in England (Part 2) : Divine Comedy, Suede, The Darkness

La britpop toujours et encore. Là ca devient un flashback musical sans précédent. Toutes les vieilles gloires sont de sortie. Et ça ne devrait pas s’arrêter. Est ce un manque d’imagination ? Un besoin nostalgique ou une collusion commerciale ?

Ce qui est certain, c’est la forme olympique des vieux héros des années 90. Il a beau avoir une belle moustache et un regard de chien battu, l’homme orchestre Neil Hannon revient en pleine forme avec le treizième album de Divine Comedy.
Fan de Jacques Brel et de Scott Walker, le fantaisiste irlandais, francophile, revient à ses premiers amours. Des histoires tendres et doucement cyniques. L’onirisme reprend le dessus dans cet album qui montre un artiste qui se regarde vieillir.
Cela faisait six ans qu’il était silencieux, et le revoilà comme un vieux dandy endormi en train de bavarder sur le mauvais temps. Rainy Sunday Afternoon. Bien vu de le sortir en automne ! La vie ralentit. Les mélodies sont délicates. L’envie symphonique n’est jamais loin mais le musicien reste dans cet état ouateux pour de nouvelles chansons qui ne sont pas surprenantes mais qui se laissent aller à un spleen d’une rare élégance, qui fait la marque de fabrique de Divine Comedy.
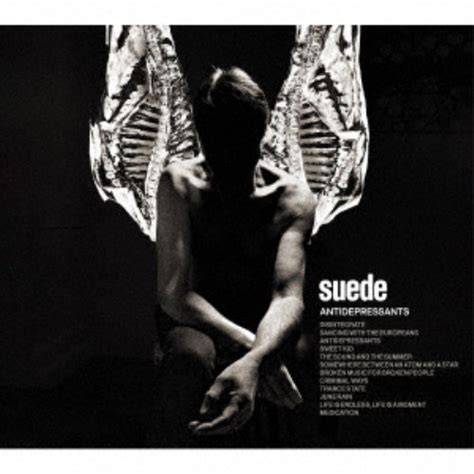
Bien entendu ce n’est pas un disque d’enragés et cela nous aurait surpris. Au début des années 90, Suede était le fer de lance du courant avant que Oasis et Blur se fassent la guerre. Aujourd’hui le groupe de Brett Anderson bouscule encore. Au bout de dix albums et des séparations à gogo, le groupe londonien remet le couvert avec une sérénité absolument incroyable et un sens de la mélodie imparable.
De disque en disque, le groupe est l’un des rares à progresser. Le groupe a échappé au fur et à mesure aux clichés des dandys androgynes pour glisser vers un rock quasi post punk, avec des albums concepts et des concerts convaincants. Suede devient un valeur sûre dans le sens authentique et réconfortant.
On ne se trompe pas à écouter ce groupe trépidant, qui ne se nourrit de toutes ses émotions et offre de beaux moments électriques avec une voix toujours aussi splendide et prenante ainsi que des guitares orageuses et tout aussi passionnantes. Au bout de toutes ces décennies, Brett Anderson et ses complices arrivent encore à être poignants et leur présence est toujours aussi forte lorsqu’ils nous présentent de nouvelles chansons. Ils se bonifient avec le temps. La profondeur de Antidepressants est incroyable. Avec le temps tout s’en va mais pas la performance de Suede. Comme David Byrne la semaine dernière, on se demande si on n’est pas en face d’un petit chef-d’œuvre de l’année 2025.

Il aurait été normal de terminer sur cet album spectaculaire de Suede mais face à tous ces retours de vieux beaux qui ne veulent plus être fatigués ou fatigants, on va parler du dernier disque de The Darkness, groupe anglais glam rock qui a aussi connu son heure de gloire au début des années 2000.
Voilà donc Dreams on Toast, sorte de fanwork de Queen avec une voix qui monte et qui descend entre rock heavy et délire baroque tout en électricité. C’est absolument amusant et d’une légèreté assumée. Le groupe ne veut plus rien prouver si ce n’est une certaine vitalité qui existe au-delà des cinquante ans.
Donc en trente minutes environ, le groupe vous fait traverser tout un genre avec des facilités un peu lourdes et de coups d’éclat qui donnent le sourire. Ces Anglais militent pour un style vintage aussi ringard que résolument séduisant. Comme Oasis et les autres, les quinquas anglais ne veulent pas être enterrés trop vite. Depuis le Brexit, on devine l’Angleterre dans un brouillard épais : quelques vieux se font le phare d’une résistance qui fait plaisir à entendre.
Hot Galleries
Our Editor Reviews
Trending Story

Joie de vivre : David Byrne, Bret McKenzie, Vinyl Williams
La tendance est à la morosité. La sinistrose s’empare de ce mois de septembre. C’est toujours un moment délicat, la rentrée. Nos rêves de liberté et de changement s'estompent comme le bronzage. Le stress reprend le dessus.
Les nouvelles du Monde sont rudes. Hanouna est revenu. Et Patrick Sébastien fut la star de l’été. Au milieu de cet océan de médiocrité et de tristesse, un homme se lève et se dit que finalement tout ne va pas si mal. Qu’il y a du bon partout. Et qu’il vaut rire que faire la gueule.

Cette attitude si décalée, on la doit à David Byrne, le roi de l’avant garde musicale et du détournement de sons. Who is the sky est la dernière œuvre du leader des Talking Heads et vogue à contre courant de l’ambiance générale.
Le musicien fait le positivisme forcené pour continuer à décrire un monde absurde et déglingué. La première chanson donne le ton : jovial, heureux et fier de l’être. C’est un disque coloré comme sa pochette. Une fois de plus, Byrne s’entoure de musiciens joyeux d’en découdre avec son univers barré et fantaisiste. Il démolit les règles de la pop avec une légèreté délicieuse et semble encore s’amuser comme un petit fou. Ce disque est une invitation à ne pas se prendre la tête. Et peut être la meilleure chose à écouter depuis ce début d'année !

On remercie David Byrne et on se dit qu’il serait ravi de rencontrer Bret McKenzie. Lui aussi prend la vie du bon côté. Acteur Néo-zélandais, il se révèle avec la série Flight of the Concords et prouve que la musique et l’humour vont de pair en obtenant un Oscar pour une chanson écrite pour le Muppet Show.
Vu dans le Seigneur des Anneaux, Bret McKenzie est un touche à tout passionnant qui rend hommage à ses aînés de Harry Nilsson à Burt Bacharach en passant par d’autres crooners fantasques et californiens.
Son second disque est un concentré de soleil musical et de chaleur mélodieuse. Il nous fait visiter Freak Out city, lieu où les arrangements sont délicats et les voix sont capricieuses. C’est un grand tour de manège avec des chansons sautillantes et enjouées. Les harmonies se succèdent pour nous faire nous asseoir dans une chaise longue. L’auteur a une vraie sensibilité qui se cache derrière une belle mélancolie. Encore une raison d’être optimiste.

Et on va s’offrir une petite galette d’optimisme avec Vinyl Williams, groupe rigolard et lyrique. Derrière ce nom se cache le petit-fils de l’immense John Williams, légende des musiques hollywoodiennes. Lionel Williams aime cependant les ambiances tout aussi épiques mais avec son style bien à lui.
On pourrait dire qu’il empruntait plus à Brian Wilson qu’à son grand-père. C’est un son bien psychédélique qu’il défend depuis plusieurs années. C’est désuet mais ça ne manque pas de charme et surtout cela nous éloigne du pessimisme qui règne. Et il nous offre un véritable festival de good vibrations avec deux disques coup sur coup: Polyhaven et Portasymphony.
A chaque fois, ça fait décoller l’auditeur. Le musicien bidouille des morceaux étranges, spacieux mais fabriqués avec des moyens humbles. Comme papy, il s’imagine à la tête d’un orchestre symphonique mais techniquement il se contente de vieilleries vintage et doucement funk. C’est un peu répétitif mais il faut avouer que Vinyl Williams a de la suite dans les idées et nous embarque dans un vrai trip lumineux et rassurant.
Après cela, si vous voulez continuer à faire la tronche… et bien regardez la télé ou attendez le nouvel album de Florent Pagny…