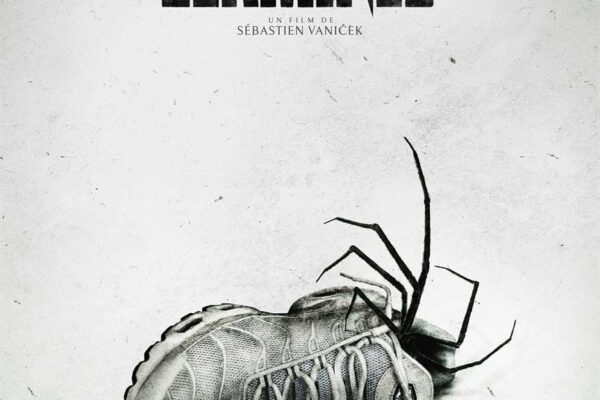A la recherche de la chaleur (Pat Kalla, Die Spitz et The Terrys)

Bon on est à peu près d’accord: il fait froid. On a la goutte au nez. Il faut sortir les gros manteaux. Les Etats Unis subissent une tempête digne d’un film de Roland Emmerich. Le Portugal a été lui aussi balayé par des vents froids et violents. Marseille est éliminé de la ligue des champions. L’hiver fait son oeuvre.
Heureusement nos oreilles peuvent nous réchauffer. Il suffit de contrer ces fraîches sensations par des sons moites et réconfortants. A ce niveau, il faudrait obliger tous les frileux à écouter le disque de Pat Kalla et le Super Mojo, Belle Terre!

Le réchauffement climatique dans ce qu’il a de meilleur. Produit par le DJ, Guts, on bronze sous des notes chaudes et des styles qui empruntent aux Caraïbes comme à l’Afrique. Rumba, beguine mais aussi de la grosse inspiration soul, le disque fait transpirer.
Et c’est bénéfique pour notre moral. Face aux bourrasques, la force de ce disque est cet ensoleillement constant. Il y a une candeur musicale qui ressemble à de la vitamine D. Les paroles sont enlevées et ne s'arrêtent pas à un exotisme rassurant. Ce disque est une bouillotte.

Mais si vous voulez avoir les joues rouges et transpirer à grosses gouttes, vous pouvez aussi vous tourner vers des rythmes plus basiques mais tout aussi efficaces. Ce premier album de Die Spitz va vous donner des bouffées de chaleur.
En 2025, on vient de trouver les petites soeurs de L7 ou Hole. Des rockeuses. Pas des filles sages et lisses. Non, de la tatouée énervée qui a bien l’envie d’en découdre avec un monde viril et pas toujours correct. Ce quatuor de nanas mal élevée fait monter la température en quelques riffs surpuissants.
C’est du rock malpoli, qui refuse d’être saucissonné par une quelconque mode. C’est agressif et d’une beauté abrasive. Elles empruntent au metal mais décollent avec des compositions qui se font plus cohérentes au fil des écoutes.
On devine la colère post adolescente mais ce premier disque est d’une maîtrise incroyable. Les filles de Die Spitz semble avoir digéré toutes les années grunge. Ca touche réellement au sublime: l’électricité est au service de quatre sorcières étonnantes. Something to Consume devrait faire l’affaire pour vous donner du peps dans ce monde frigorifié.

Et s’il faut mettre le feu, vous pouvez compter sur le joyeux groupe The Terrys. Venus d’Australie, ils ont eux aussi cette vision bien festive et rassurante du bon vieux rock’n’roll. Et comme de nombreux groupes australiens, ils en font des tonnes pour que cela fonctionne.
Est-ce lié à l’isolement ou la dangerosité de l'île, mais en Australie, on a toujours ce petit pas de côté qui permet de se démarquer. Les Terrys imitent donc la formule surf pop mais le groupe réussit à faire quelque chose de décalé.
Tout avait l’air futile dans ce disque qui ne dure que trente minutes. Mais on y revient. Car tout se fait sans cynisme. Avec un vrai talent pour réaliser des petits hymnes rock enflammés et surtout crédibles.
Ce troisième album est une petite merveille de simplicité. Chansons courtes. Refrains imparables. Paroles marrantes. C’est désarmant. Le groupe joue bien sur l’image de glandus sur la plage mais leur disque a tout d’un coup de soleil. Ca ferait du bien à tout le monde en plein milieu de l’hiver.
LOS ANGELES 2013

Face aux agissements de la tristement célèbre ICE, le regard cynique et misanthrope de John Carpenter sur le sort de l’Amérique trouve un écho salvateur et mélancolique.
Parce que Carpenter est un sacré observateur de la politique américaine. Il s’est toujours méfié du pouvoir, religieux ou politique. Son cinéma a toujours été socialement marqué par une vision triste d’une Amérique divisée où le plus déglingué n’est jamais celui que l’on croit. Assaut reste son film matrice sur ce sujet là.
On pourrait même le soupçonner à ses débuts d’être un gros réactionnaire. Mais rapidement, par son expérience personnelle avec les studios, le cinéaste a montré qu’il était un desperado désappointé par le Monde et surtout par la bêtise crasse de ses contemporains.
Los Angeles 2013 met en lumière la révolte d’un individu face à un pouvoir outrancier dénoncé comme une théocratie basée sur la terreur. C’est ce que l’on observe, actuellement, avec la réaction des citoyens américains face à ICE, cette milice policière qui chasse les sans papiers à travers les villes américaines.
Le plus jeune soldat à avoir été décoré par le président! Il a sauvé un président. Deux médailles d’honneur. Pourtant Snake Plissken est l’homme le plus recherché des Etats Unis. Un criminel dangereux. Car il ne croit pas au pouvoir en place. Pour lui la liberté est morte. Le hors la loi incarne l'individualisme forcené, celui qui ne dessert jamais les dents.
L’icône du héros qui ne croit en rien, sauf en lui. Et sa fameuse phrase: Appelez moi Snake. Un sans foi ni loi qui assure tout de même le spectacle. Cowboy du futur, héros qui a survécu à un New York de punks, Snake Plissken est chargé de retrouver la fille du président. Elle a volé une arme redoutable. Snake Plissken a 10 heures pour retrouver la mallette du président et tuer un terroriste péruvien, cousin parodique de Nicolas Maduro et Che Guevara.
Avant cela, il se promène dans un Los Angeles en feu et à sang, une parodie guerrière de la vie californienne où tous les défauts de l'American Way of Life sont grossis. A cause d’un séisme, la ville est devenue une île. Tous les marginaux y sont emmenés de force.
Alors ça bastonne sévère avec notre borgne insociable. Et finalement, comme à son habitude, Snake devient un résistant. L’homme silencieux est un homme qui pense aussi. C’est ce que l’on voit aussi à la télévision de nos jours. Face à la brutalité ou ce qui s’apparente à une forme de fascisme, les individus se mettent à siffler, crier et critiquer lorsque les patrouilles encagoulées de ICE interviennent.
On aurait pu comparer le film Invasion Los Angeles (autre charge de Carpenter contre la droite libérale) avec la situation américaine d’aujourd’hui. Parce qu’il est grotesque, Los Angeles 2013 correspond plus à la période Trump. Les outrances et la violence sont caricaturales.
Comme c’est du cinéma c’est beaucoup moins qu' inquiétant que dans nos vraies vies mais en toute honnêteté, on ne pensait que ce film bancal du champion de la terreur, pourrait être un jour réhabiliter pour comprendre notre histoire… drôle d’époque.
Los Angeles 2013 (1996) Bande Annonce VF HD
Avec Kurt Russell, Valeria Golino, Stacy Keach et Pam Grier - 1996 - 1h40
Exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco », Musée des Arts décoratifs (mAd),


C’est l’exposition du centenaire : elle célèbre les cent ans de l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui se tint à Paris du 28 avril au 30 novembre 1925 et accueillit les pavillons de dix-neuf pays européens (dont la France, plus la Chine, le Japon et la Turquie) de l’esplanade des Invalides jusqu’à la place de la Concorde en passant par le pont Alexandre III et le Grand Palais.
Cette exposition, qui aurait dû se tenir en 1915 mais fut repoussée dix ans plus tard en raison de la guerre, fut la vitrine du style « Art déco », alors à son apogée : un mouvement artistique international né dans les années 1910, au moment du déclin de « l’Art nouveau ». Ce nouveau style ne fut baptisé et théorisé qu’a posteriori, lors d’une exposition organisée par le musée des Arts décoratifs de Paris en 1966.
L’exposition du mAd, très ambitieuse et qui ne compte pas moins de dix-sept salles sur trois niveaux, cherche à donner un aperçu du foisonnement créatif pendant les « années folles » (la décennie 1920) et au-delà, de la diversité des techniques et des interprétations par les artistes de ce style, jusque dans ses contradictions : luxe décoratif, d’une part, production de masse, d’autre part.
Elle présente en une salle la manifestation de 1925, dont plusieurs œuvres sont disséminées dans les salles suivantes, puis explore les origines du mouvement, analyse la « grammaire visuelle » de ce nouveau style, et donne à voir ses principaux représentants – artistes, artisans, « ensembliers » (qui coordonnent l’ensemble des arts décoratifs dans un projet) et collectionneurs – depuis les années 1920 jusqu’à nos jours.
Tous les arts décoratifs – joaillerie, textile et mode, verrerie et vitrail, céramique, ferronnerie, ébénisterie, affiches… – ainsi que l’architecture (celle des pavillons de l’exposition de 1925, notamment), la sculpture et la peinture (souvent associées à l’architecture) sont convoqués. Une grande partie des 1200 œuvres exposées provient des collections du mAd lui-même, dont l’ancêtre, l’Union centrale des arts décoratifs, avait acquis dès les années 1910 plusieurs pièces maîtresses.
La salle 3 donne les clés permettant de reconnaître, tout au long du parcours, les caractéristiques du nouveau style : simplification et géométrisation des formes, à l’opposé des lignes sinueuses et naturalistes de l’Art nouveau, contrastes de couleurs vives ou de noir et blanc, utilisation de bois précieux et de techniques oubliées ou exotiques, telles que le galuchat, la marqueterie de paille ou la laque, motifs récurrents du panier de fleurs ou de fruits, de la fontaine bouillonnante, du paon, de l’antilope ou de la biche élancée.

Dans la salle 4, qui revient sur les prémices du nouveau style, les tissus et les meubles du décorateur Paul Follot témoignent d’une curieuse transition entre Art nouveau et Art déco. Sa chaise-longue de 1912, notamment, rappelle encore par sa forme et ses dorures les styles historiques, ses lignes sinueuses sont héritées de l’Art nouveau, mais la sobriété de son décor et sa structuration par des motifs de roses stylisées appliqués le long de la ceinture et du dossier la font déjà entrer dans l’Art déco.

Une salle entière (la salle 2) est dédiée au joailler Cartier, qui exposa quelque 150 pièces en 1925 et fit figure de pionnier pour sa géométrisation des formes et son inspiration orientale. Ses créations sont aussi visibles dans d’autres salles, comme cette somptueuse pendule de 1927, composée à partir d’un écran chinois en jade blanc sculpté du XVIIIe siècle (écran qui devait orner le bureau d’un lettré), dont les montants en onyx figurent deux têtes de dragons stylisés.

L’ébéniste Jacques-Émile Ruhlmann, surnommé « le Riesener de l’Art déco » (en référence à l’ébéniste de Louis XVI) pour sa maîtrise des essences rares associées à d’autres matériaux précieux et la clientèle prestigieuse de son entreprise, apparaît comme le modèle de l’ensemblier, qui conçoit l’ensemble de ses intérieurs, décors, mobilier et objets d’art compris. Le pavillon, dit « du Collectionneur » qu’il fait construire par Pierre Patout sur l’esplanade des Invalides en 1925, véritable manifeste de l’Art déco français, réunissait les œuvres de près de quarante artistes et artisans (Brandt, Puiforçat, Décorchemont…). Plusieurs de ses créations emblématiques sont visibles ici, tel le bahut Élysée, exposé au Salon d’automne de 1920 puis à l’exposition de 1925 avant d’être livré à l’Élysée. Sa façade ornée d’une marqueterie en loupe d’amboine vernie et ivoire reproduit un motif de cailloutis élaboré par la manufacture de porcelaine de Sèvres dans les années 1760.

Les pièces sélectionnées par le décorateur Jacques Grange, à la fin du parcours, représentatives du renouveau du goût pour l’Art déco depuis les années 1960, font écho aux collections de Nelly de Rothschild en salle 5, et surtout de Jacques Doucet, en salle 6, dont la vente, en 1972, fut un moment fondateur dans la redécouverte de ce style sur le marché de l’art.
L’exposition se concentre sur les manifestations de l’Art déco en France – ce qui peut paraître étonnant pour un style international. Déjà excessivement riche, elle aurait difficilement pu évoquer en plus la diversité des interprétations de ce style dans le monde. Une seule salle est donc consacrée aux artistes étrangers et, parmi eux, seulement aux Suédois et aux Japonais : « l’art déco vu d’ailleurs » (salle 15). Quelques meubles et objets représentatifs de la « Swedish Grace », particulièrement appréciée en 1925, sont montrés, ainsi que des vases et kimonos témoignant de l’influence plus tardive de l’Art déco au Japon dans les années 1930.
La salle 16 s’intéresse au développement des moyens de transport, en particulier l’avion, et du tourisme, tandis que la salle 17, qui occupe l’intégralité de la nef au rez-de-chaussée du musée, est une exposition à part entière, consacrée à la renaissance de l’Orient-Express et aux ouvrages des nombreux métiers d’art français engagés dans cette aventure.
Des maquettes à taille réelle du wagon-bar, d’un wagon-restaurant ou d’une cabine permettent de s’immerger dans le confort raffiné de ce train d’exception, tandis que des échantillons des éléments du décor à différentes étapes de leur réalisation, accompagnés de films explicatifs, révèlent toute la complexité et l’excellence de ces métiers d’art.

Le projet est né à la suite de la découverte à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, en 2015, de seize voitures datant des années 1920-1930 oubliées sur les voies de ce mythique train de luxe créé en 1883 par la Compagnie internationale des wagons-lits, qui assura jusqu’en 1977 la liaison entre Paris, Vienne, Venise et Constantinople. La SNCF, acquéreur, associée au groupe Accor, a décidé de les restaurer dans un style qui réinterprète et modernise l’Art déco. Dans le rôle de l’ensemblier, l’architecte Maxime d’Angeac coordonne depuis 2020 le travail de trente corps de métiers différents à la réalisation de cette œuvre d’art totale. Les voitures flambant neuves devraient reprendre du service à partir de 2027.
jusqu’au 26 avril 2026
au musée des Arts décoratifs (mAd)
Father Mother Brother Sister, Jim Jarmusch, Le Pacte


Ton père, c’est Tom Waits. Il a encore cette démarche féline. Il a ce regard perçant. Et surtout c’est une voix. Rauque et magnifique. On y entend l’usure et le doute. Tom Waits, comme papa étrange, ça fonctionne merveilleusement bien.
Et c’est le vieux complice de toujours de Jim Jarmusch qui installe en toute simplicité le vieux chanteur dans un canapé pour nous offrir une joli moment en famille. En face de lui, la star de la télé Mayim Bialik et le fidèle Adam Driver. Ils sont propres sur eux et observent un papa donc au bout du rouleau.
Les trois comédiens ont leur parcours et ils semblent venir avec dans un schéma narratif assez simple : les enfants retrouvent leur papa et s'inquiètent poliment pour lui. Avec son regard chirurgical mais mélancolique, Jim Jarmusch trouve toujours les petites touches comiques dans le quotidien, les corps qui affrontent le malaise d’une situation.
Le réalisateur nous met au cœur d’une situation connue de tous et en fait un moment presque poétique, à l’absurdité assez européenne. C’est sa marque de fabrique depuis Stranger than Paradise. Transcender le quotidien, voire l’ennui.
Les relations sont fragiles mais délicates. Jusqu’à un twist qui ressemble à l’irrésistible Tom Waits. Et ensuite, ta mère, c’est Charlotte Rampling. Là encore, on est aspiré par le mythe de l’actrice. Son parcours, sa carrière, son charisme. En un seul plan, lovée dans son canapé, on est pris par l’actrice, magnétique et froide en même temps.
Son personnage attend ses deux filles pour un goûter annuel au fin fond d’une Irlande esthétisée. L’une est extravertie tandis que l’autre ressemble à une vieille fille godiche. Les clichés sont là. Comme les mets servis à table, l’auteur de Night On Earth en fait quelque chose de délicieux.
Il décortique mécaniquement les rapports familiaux. Dans la filmographie de Jarmusch, le film à sketchs est récurrent. Il connaît les répétitions et les enjeux de la comparaison entre les sketchs. Alors il rappelle que les erreurs sont les mêmes et qu’ils se trouvent souvent dans les détails.
Ton frère et ta sœur sont Indya Moore et Lija Sabbat, deux jolis acteurs issus des séries. Ils viennent pleurer leurs parents, à Paris, en fermant leur appartement. Ils sont deux étrangers avec beaucoup de points communs. Là encore, tout est dans le détail. Et dans la ville. Paris devient un endroit singulier, labyrinthique à l’image des rapports entre le frère et la sœur.
Là encore, la mélancolie de Jarmusch se rappelle à notre bon souvenir : les artifices sont évidents mais au service de l’émotion. C’est pourquoi il s’agit de cinéma. Les images véhiculent toujours une idée. Le sketch est une mise au point pour Jarmusch. Les trois histoires sont différentes mais touchent à l’universalité.
C’est du cinéma très calme. Jarmusch n’est plus le rockeur déluré mais plutôt un vieux sage au regard apaisé, qui tente de rendre les choses belles et subtiles sur des sujets pas faciles comme la famille. Il reste facétieux avec l’âge et son film, lion d’or à la Mostra de Venise, est une délicate intention, faite de tendresse et d’humour aigre doux. Comme tous ses films, la poésie l’emporte et on adore la façon dont il hait la famille. Un grand petit film.
Avec Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett et Charlotte Rampling
1h50 - Le Pacte
Anaconda, Tom Gormican, Sony Pictures


Jack Black fait des grimaces et de la musique avec sa bouche. Comme toujours. Paul Rudd fait le beau gosse maladroit. Comme toujours. Steve Zahn reste le second couteau le moins bien exploité de la planète. Tout comme la charmante Thandie Newton, cachée sous la coupe de cheveux la plus étrange de l’année. Voilà le quatuor qui va affronter de nouveau le serpent géant et carnivore !
Et autant le dire tout de suite : on est à peu près au même niveau que cette saga qui comporte déjà six films (des direct to video). C’est mauvais. Ce nouvel épisode se veut une variation comique du film d’aventures et d’horreur. Ce n’est pas drôle et ça ne fait pas du tout peur.
Pourtant les vingt premières minutes sont assez sympathiques. Les deux stars d’Hollywood font leur numéro mais ils le font assez bien. Pour un quadra cinéphile, voir des stars jouer des quadras cinéphiles, c’est assez touchant. La fascination du cinéma, le plaisir coupable des nanars, les utopies que la fiction peut engendrer, le rêve de gloire… Oui, le film observe les doux rêves de paumés dans la vie.
Et l’idée de les voir refaire le film Anaconda est amusante et bien sentie avec l’arrivée d’un personnage brésilien joué par Selton Mello, plus nuancé que les autres acteurs. Le film devient pourtant plus flou à partir de son arrivée. Le scénario se perd comme les personnages s'enfoncent dans la forêt amazonienne.
Il y a une histoire d’or, un anaconda affamé et des zozos largués au milieu du fleuve qui dissertent sur le coup de boule. En termes de tensions, comiques ou horrifiques, les scènes s’annulent les unes après les autres.
Le réalisateur (Tom Gormican), qui a refait récemment Le flic de Beverly Hills, compile les blagues meta et les situations grotesques, presque gênantes. Tout est en pilotage automatique et sans grand intérêt. On devine un film sympa mais totalement saccagé par une histoire qui n’est jamais tenue. Ça sent l'improvisation. Une réplique dans ce sens ressemble à un aveu.
Ainsi les acteurs semblent un peu largués dans ce film qui partait sur un postulat intéressant. Bon allez, du navet pendant les fêtes, ce n’est pas si indigeste. Mais on regrette que ce soit réellement sans saveur !
Au cinéma le 30 décembre 2025
avec Jack Black, Paul Rudd, Thandie Newton et Steve Zahn
Sony Pictures - 1h30
Avatar 3, de feu et de cendres, James Cameron 20th Century Fox
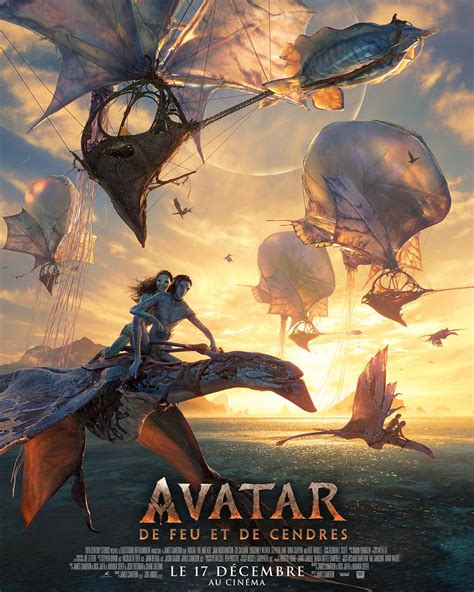
Un peu raté, un peu passionnant, Avatar 3 est un film “un peu”. Ce n’est pas forcément le vœu de James Cameron, roi du monde numérique et qui trouve enfin ses limites avec ce troisième épisode sur la planète Pandora.
En réalité, le nouvel Avatar est comme le précédent : trop long. Quand le temps se met à traîner, le spectateur a le temps d’échapper à la force de l’émerveillement et d'observer les contours, les finitions et finalement les répétitions. Avec sa carrière exceptionnelle, James Cameron fait dans l’autocitation et ça donne une impression de tourner en rond. Ça sera le gros problème de Avatar 3.
On découvrait la faune de la planète dans le numéro un. On comprenait la complexité de la planète dans le numéro deux. On baille poliment devant le numéro trois qui se permet une narration trop proche du numéro deux. Et un vilain sentiment de copié-collé pour les scènes finales, spectaculaires et finalement ennuyeuses.
Bon une fois encore, on est sur un film de plus de trois heures. Donc quand les Na’vi défendent une écologie new age et simpliste, on regarde sa montre. On est plus sensible sur quelques scènes intimistes : Cameron réussit avec toute sa technologie contrainte et voyante, à faire passer des émotions. Juste pour cela, cet Avatar est passionnant.
Les effets spéciaux se mettent au service de sentiments. Et cela fait la différence dans le monde lissé des blockbusters ! L’artifice rend compte d’une réalité affective. C’est bluffant. Car finalement les Na’vi sont la version guerrière des Schtroumpfs.
James Cameron restera comme le plus grand technicien de tous les temps mais il est plus fragile sur l’aspect narratif. Il nous fascine avec ses obsessions (en gros le parallèle homme machine) mais il se base sur des stéréotypes parfois grossiers. Il fait néanmoins un énorme effort ici avec une méchante charismatique, Varang, sorcière d’une tribu qui vit à l’ombre d’un volcan.
Là, il y a de la hargne et de la malice. A quelques endroits, le personnage apporte un miroir déformant des héros presque malaisant. Belle et cruelle, elle nous fait espérer le meilleur puis au milieu du film, plus rien : elle devient un second couteau, comme une vieille James Bond Girl que l’on jetterait aux crocos. A l’inverse, l’enjeu du film se base sur le personnage le plus faible et caricatural du film. Si bien que le film devient bancal.
Les héros sont des bénis oui oui. Les méchants grimacent comme des catcheurs américains. Et pourtant il y a encore cette magie. Cameron, avec Avatar, veut clairement créer une mythologie moderne. Mais reste très conventionnel. L'œuvre dans son ensemble est même un échec à ce niveau.
Pourtant le réalisateur de Titanic conserve cette technicité qui nous plonge, presque malgré nous, dans un monde réellement original, avec quelques zones d’ombres bien senties (petite passion pour les calamars voraces et évidemment géants) et une grande ambition qui conjugue tous les médias et tous les sens. Avatar, en odorama, on y est presque.
Ce troisième épisode est encore sensoriel. Se dire que tout est numérique force le respect. C’est un blockbuster mais il est honnête par tous les sentiments qui le traversent. Ceux de l’auteur, toujours à la recherche d’une formule magique ; ceux des personnages qui n’existent pas vraiment et qui pourtant arrivent à être vibrants ; ceux du spectateur qui rencontre un parc d’attraction inédit, parfois ridicule, parfois secouant.
Cameron tente trop de nous convaincre qu’il est un créateur. Son film manque d’humilité : cela gonfle à la fois les défauts et les qualités. De toute façon, même un Cameron en petite forme, cela donne une œuvre fascinante à suivre.
Au cinéma le 17 décembre 2025
de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang et Oona Chaplin
20th Century Fox - 3h17
Dossier 137, Dominik Moll, Haut et Court


Dominik Moll est un auteur insaisissable. Lorsque l’on observe sa trajectoire depuis son premier succès Harry Un Ami qui vous veut du Bien, en 2000. Avec son complice Gilles Marchand, le cinéaste continue d’épurer son idée du thriller jusqu’à la moelle… ou le réel le plus réel.
Car il est loin le temps de Lemming, sortie fantastique du réalisateur. Depuis La Nuit du 12, on redécouvre un passionné de polar qui s’en prend aux fondations du genre. Très astucieux et respectueux au début de sa carrière, l’homme a retiré les oripeaux au genre et sa dernière œuvre est un regard clinique aussi froid que motivant.
C’est Ken Loach chez les flics. Le social pénètre totalement une intrigue d’une banalité apparente et presque ennuyeuse. Stéphanie Bertrand travaille à l’IGPN. Face au mouvement des Gilets Jaunes, en 2018, elle recueille les plaintes de tout bord. Une femme vient porter plainte car son fils est à l’hôpital après un tir de flashball.
La policière mène son enquête et fait une découverte qui évidemment ne va plaire à tout le monde. Dominik Moll jouait avec les images et les ambiances, il y a quelques années. C’est fini. Le style est posé mais très direct.
Le film s’infiltre entre le boulot plutôt ingrat de la flic, parfaitement jouée par Lea Drucker, et sa vie personnelle bousculée par un ex mari un peu virulent et l’arrivée d’un chat errant. Mais il n’y a rien d’extraordinaire chez cette personne, assez volontaire.
Comme il n’y a rien de folichon dans son enquête qu’elle dirige avec quelques collaborateurs qui ont de la compassion pour la colère des manifestants et les réactions parfois violentes de leurs collègues.
Pourtant, par un habile montage, Dominik Moll nous attrape par la main et nous met dans le sillage d’un fait divers qui illustre une violence sourde, idiote et même étouffée par les institutions. Le réalisateur nous installe ensuite à coté de Stéphanie Bertrand et nous fait deviner tous les sentiments qui l'habitent.
Les témoins et les victimes ne sont donc plus que des points d’ancrage pour arriver à la vérité, qui d’ailleurs ne donne aucune forme de réconfort. Comme à son habitude, Moll conserve ce ton rageur malgré une forme différente de ces premiers films. C’est une succession de faits, qui finissent en constat mais qui trouve dans une forme cinématographique, une efficacité d’un thriller à l’ancienne. C’est froid et indélicat mais terriblement bien fichu.
Avec Léa Drucker, Solan Machado Graner, Jonathan Turnbull et Stanislas Mehrar - Haut et court - 1h55
Disques diablotins pour Noël

Bon on va continuer de fuir les petits anges, les saints glinglin et la naissance du petit Jésus avec des disques joyeux, heureux et d'une certaine manière, exigeants ! Vous n'avez pas l'impression de baisser vos exigences lorsque les sapins de Noël se pointent dans votre salon ? Le bon goût semble disparaître à l'avantage d'un ensemble culturel rigide, ennuyeux, rouge et vert. Ce n'est pas vraiment la magie de Noël mais plutôt la loi de Noël !

En bas du sapin, je vous invite à y déposer le disque de Blu et August Fanon, un formidable album de hip hop, qui nous console de toutes nos productions locales, sclérosées elles aussi par des conventions lourdingues.
Ici, on parle musique et on fait une mise au point sur la quarantaine, moment phare qui permet de prendre du recul et d'avoir des idées pour le futur. Le flow est d'un lyrisme étourdissant et surtout il se dépose sur les boucles sonores d'August Fanon, petit génie du sample.
C'est un peu fait à l'ancienne mais on apprécie grandement les rassurantes influences jazz et soul. C'est un vrai cadeau que ce disque qui refuse de faire dans le jeunisme.
Il y a une vraie réflexion sur le temps qui passe et la place d'un art dans une vie. C'est d'une élégance rarement entendue dans un style qui apprécie plus le clash et la démonstration. On retrouve le goût de la chronique et des paroles assez poétiques. Le tout est vraiment collaboratif. C'est un disque de bonne action.

La musique de Vulfpeck est elle aussi pleine de bonnes vibrations. Cette fois-ci, pour les fêtes, le groupe vous invitera à une grande farandole autour de grooves joliment datés. Voici le genre de groupes qui ne peut sortir que des Etats-Unis et son entertainment forcené. Impossible de résister aux riffs de Vulfpeck, ses lignes de basses délicieuses et ses rythmes gorgés de funk. Ajoutons à cela une voix exceptionnelle.
Clarity of Cal est une nouvelle excuse. Comme Dave Matthews Band, les chansons sont des pistes pour des sessions de jam bands qui devraient électriser les salles de concerts du Monde entier (ils sont à Paris en juillet). Cela reste de très beaux morceaux avec des musiciens qui bien entendu font monter la qualité du son à des hauteurs inimaginables.
Quelques parties instrumentales hérissent les poils de plaisir. Les rats de studio se prennent pour des stars et Vulfpeck ressemble à une belle revanche sur un système qui voudrait tout ripoliner. Le professionnalisme se confond avec le talent, l'humour (bah oui) et l'exaltation. Ce disque est le plus beau chant de la saison. Du soft rock en état de grâce.

Enfin, pour Noël, on vous offre des pulls moches alors que l'on devrait vous donner une grande épée, un bikini (pour vous aussi messieurs) et un cheval blanc pour aller vous battre contre les forces du mal. C'est ainsi que se présente la chanteuse du groupe Castle Rat qui réunit des fans des costumes médiévaux et du métal exalté.
The Bestiary est le nom de leur second opus et confirme bien que le groupe se vautre avec délice dans un heavy metal, qui a inspiré par le passé toutes les grimaces de Jack Black. Heureusement pour nous, la blague n'a rien de grotesque et est joliment exécutée.
On n'a pas du tout l'envie de les prendre au sérieux quand on voit les costumes assez délirants du groupe, la licorne sur la pochette et les inspirations kitsch. Mais musicalement la leader du groupe, Rat Queen, assure le spectacle : une voix qui se glisse dans une cérémonie électrique d'une remarquable confiance.
Pas de second degré et ça fonctionne: c'est un disque d'heroic fantasy. Cela va plutôt bien à l'hiver avec ses ambiances blanches et mortes. On ricane avant de se laisser convaincre.
Les New-Yorkais réussissent à nous transporter dans un univers crédible musicalement qui rappelle les grandes heures de Black Sabbath et quelques titres de Genesis ou Led Zeppelin peuplés de druides et autres bestioles rupestres et imaginaires. Si vous êtes en manque du Seigneur des Anneaux, ce Bestiary fait le job : de la grosse artillerie lourde mais présentée avec beaucoup de cœur...
Pour que votre Noël soit différent cette année...
Pied de nez et doigts dans le nez

Allez les enfants, on fonce vers Noël. Les sapins. Le Black Friday. Les marchés de Noël. On consomme et on ferme sa gueule. La musique permet aussi de filer de l'autre côté de la bienpensance et envoyer des scuds aux conventions et aux nausées de la fin de l'année.

Par exemple, pour Noël, je vous conseille d'écouter le dernier pamphlet des Dropkick Murphys. Les voilà de retour pour de bon, après deux disques acoustiques résolument tournés vers le passé. Les parrains du celtic punk sont de retour et le monde selon Trump ne leur convient pas du tout.
Alors ça cogne et ça hurle. Les traditions irlandaises ont toujours caché un côté punk et le groupe de Boston continue dans cette voie. Les Pogues rencontrent les Sex Pistols. Les riffs sont racoleurs. Le chanteur nous vend du poisson. Les rythmiques nous font sauter comme des hobbits bourrés à la bière.
Ken Casey, le leader du groupe, est cette espèce de troubadour populaire, qui a mis les doigts dans la prise et vomit sa haine des républicains américains et de la violence du monde. Les paroles sont aussi musclées que les refrains. Tout est entraînant chez ce groupe qui commence à échapper à ses propres conventions. For the People est un album incroyable. L'énergie se politise. Les chansons défendent des valeurs. Chaque instrument semble être une arme contre la bêtise et lutter pour la démocratie. Certainement l'un des albums les plus nécessaires en ce moment. Aux Etats-Unis ou ailleurs.

Bon. A Noël, vous avez le droit de subir l'énième retour de Mariah Carey et sa chanson mielleuse. Pour vraiment sortir de cette période en rouge et vert, voici une potion magique en trois dimensions qui va vous arracher à la mièvrerie de décembre.
Et il est bon de dire que le nouvel album de Hazzerd peut vous donner aussi des idées positives face à la morne grisaille de la fin d'année. Leur disque, the 3rd Dimension, est un concentré de trucs pétaradants du heavy metal qui va vous faire franchement rigoler.
Les quatre Canadiens s'affirment comme des musiciens héroïques qui défendent un metal totalement vieillot mais tout à fait mélodique. Ça gratouille à fond les ballons pour un style très eighties, souvent réconfortant. Les gars égratignent les phalanges : le son d'un autre temps totalement jubilatoire. Nous ne sommes pas loin de la parodie. Et d'un vrai plaisir mélomane aussi.
Parce que oui, les musiciens sont très doués pour faire du trash metal, un objet plus complexe. Après 15 ans d'existence, Hazzerd vient de produire son troisième effort, ce qui prouve que le groupe s'applique dans son style si particulier. Toutes les oreilles ne seront pas sensibles au talent du groupe mais leur esprit vintage et rigolard fait franchement la différence. Avec sa pochette bien ringarde et laide, The 3rd Dimension est une machine amusante à remonter le temps. Et nous permet d'éviter les chants de Noël qui nous brûlent les oreilles à chaque fin d'année.

Ce qui nous amène à parler des cinq Suèdois de Crazy Lixx et de leur album magique qui réussit à créer la fusion improbable entre AC DC et Aerosmith. Que du bon goût. Mais en cette période de fête, on ne va pas se priver de ce petit groupe qui sait défendre quelques couplets très jouissifs. Copieux comme une dinde, leur disque est gras mais réconfortant.
Thrill of the Bite se vautre donc allégrement dans ce rock and roll un peu beauf mais qui fait rire et secouer la tête bêtement. C'est le réveillon de la débauche électrique. Les musiciens en font des tonnes. Et cela marche totalement.
En dix titres, on a l'impression de comprendre tout le heavy metal champagne et grotesque du siècle dernier. Les dix morceaux sont concis, bien réalisés et surtout donnent le goût de l'excès à chaque rupture de ton. C'est un joli doigt d'honneur à la respectabilité et la bienséance. Comme un gosse à table lors d'un déjeuner familial trop long, ces trois œuvres bruyantes se mettent allégrement le doigt dans le nez et l'air de rien nous détournent joyeusement des sucreries et des obligations de fin d'année.
Exposition « Le Grand Dauphin (1661-1711), Fils de roi, père de roi et jamais roi » au Château de Versailles


A la mort de Louis XIV, en 1715, il ne reste pour lui succéder qu’un orphelin de cinq ans, son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Qu’est-il donc advenu des deux générations qui l’ont précédé ? Le Château de Versailles, qui avait consacré à Louis XV et à ses passions une très belle exposition il y a deux ans, revient sur le destin du fils unique de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche, père lui-même de trois garçons parmi lesquels le futur roi Philippe V d’Espagne. Comme son fils aîné, le « petit Dauphin », il mourut quelques années avant la fin du règne de Louis XIV et ne fut donc jamais roi.
Louis de France ne fut en fait appelé « grand » Dauphin qu’après sa mort, pour le différencier de son fils, devenu le nouveau Dauphin de 1711 à son propre décès, l’année suivante. De son vivant, il était appelé « Monseigneur ». Cependant, le titre de « Dauphin » était utilisé pour désigner l’héritier du trône de France depuis 1349, date à laquelle la région du Dauphiné (nom dont l’origine elle-même est obscure) fut rattachée au royaume de France. Le fils de Jean II le Bon, Charles V le Sage, fut le premier à porter ce titre.
L’animal héraldique est donc omniprésent dans l’exposition, sur la plupart des objets ayant appartenu au fils de Louis XIV ou l’ayant représenté : cadres des tableaux, socles des bustes, canons en modèles réduits, plateaux des commodes marquetées… Il y est figuré non pas de manière naturaliste, bien que les artistes français aient pu avoir l’occasion d’observer de véritables dauphins, mais selon des modèles antiques qui le font ressembler à un étrange poisson au museau épais, parfois proche d’un dragon.

L’exposition, foisonnante, sur un parcours qui ne compte pas moins de 14 salles, suit les trois grandes étapes de la vie de ce prince, perfidement résumées par le mémorialiste Saint-Simon (« fils de roi, père de roi et jamais roi ») :
- l’évènement de sa naissance et son enfance, marquée par une éducation aussi soignée que sévère ;
- son mariage, en 1680, avec Marie-Anne de Bavière et la naissance de leurs trois fils, dont le cadet succède au roi Charles II d’Espagne (fils de Philippe IV), mort sans descendance en 1700 ;
- les passions de Monseigneur, de son mariage à sa mort, pour les œuvres d’art et objets précieux, dont il fut un éminent collectionneur, pour la chasse et pour son domaine privé de Meudon.
La première partie est particulièrement intéressante pour comprendre le contexte des premières années du règne personnel de Louis XIV, l’importance accordée à la naissance de son héritier légitime, seul survivant des six enfants qu’il eut avec la reine Marie-Thérèse, et la manière dont on élevait alors les enfants princiers.
Le fils de Louis XIV, bien qu'oublié après sa mort, a fait l’objet de très nombreux portraits dans son enfance. On le voit porter des vêtements féminins dans ses premières années puis, après son somptueux baptême, à l’âge de six ans et demi – âge auquel l’enfant a plus de chances de survivre – vêtu comme un roi en miniature.
La plupart des œuvres sont issues des collections de Versailles mais rarement exposées, comme cette curieuse réunion de la reine mère Anne d’Autriche, de Marie-Thérèse et du Dauphin (vers 1664), par Charles et Henri Beaubrun, qui évoque une sainte famille (sainte Anne, la Vierge Marie et l’Enfant).
Plusieurs portraits, cependant, proviennent de Madrid, où ils avaient été envoyés au grand-père maternel du Dauphin, le roi Philippe IV d’Espagne. Sont exceptionnellement réunis, notamment, le portrait de Marie-Thérèse et de son fils, vêtus d’un extraordinaire costume de fête « à la polonaise », celui du Dauphin à l’âge de deux ans, par les mêmes frères Beaubrun, et l’émouvante effigie de sa petite sœur Marie-Thérèse de France, morte à l’âge de cinq ans, par Jean Nocret.

Ce n’est qu’à l’âge de sept ans qu’il est d’usage pour un garçon de « passer aux hommes », soit de quitter le giron des femmes pour être confié à des éducateurs masculins. Supervisée par son précepteur, le prédicateur Jacques Bénigne Bossuet, dont un très beau portrait par Pierre Mignard est prêté par Meaux, son éducation comprend de très nombreuses disciplines, destinées à le préparer à son métier de roi : histoire, géographie, héraldique, français, latin, mathématiques, physique, dessin, musique, cartographie, ou encore art militaire, sa matière préférée. Les devoirs de français du jeune prince écolier, corrigés par Bossuet, ou ses dessins à la plume, exécutés avec l’assistance de son maître, le graveur lorrain Israël Silvestre, nous le rendent plus proche.
Le plafond de la chambre du Dauphin aux Tuileries avait été orné par Jean-Baptiste de Champaigne de très belles scènes peintes sur fond doré, sur le thème de l’éducation d’Achille. Heureusement déposés à la Révolution, encadrés et conservés au Louvre, ces décors ont échappé à l’incendie du château en 1871. La peinture qui était placée au centre de l’alcôve, une allégorie de l’Aurore et la Nuit, est particulièrement poétique.
Parmi les plus belles œuvres présentées au cours de l’exposition se trouvent plusieurs bustes en marbre de Louis XIV, du Dauphin et de la Dauphine par Antoine Coysevox, sculpteur lyonnais qui participa à la décoration du château de Versailles et de ses jardins. Le plus remarquable est peut-être le profil gravé en bas-relief du jeune homme (vers 1676-1677), dont il parvient à rendre expressifs les traits pour le moins disgracieux.

La deuxième partie de l’exposition permet de réunir plusieurs portraits des trois fils du Dauphin et de son épouse, Marie-Anne de Bavière (nés en 1682, 1683 et 1686). L’un des plus beaux est celui que fit Hyacinthe Rigaud du duc de Bourgogne, leur fils aîné, en 1703 : représenté en chef des armées dans les Flandres (où il ne s’illustra pourtant pas), l’écharpe blanche et le cordon de l’ordre du Saint-Esprit se reflétant sur sa cuirasse, les cheveux au vent, il désigne le champ de bataille à l’arrière-plan. Cette mise en scène militaire rappelle le portrait que fit Rigaud du Grand Dauphin en vainqueur de Philippsbourg (une citadelle alsacienne occupée par les troupes impériales de Léopold Ier de Habsbourg, assiégée par l’armée française en 1688), la grande victoire qui l’avait couvert de gloire onze ans plus tôt.
Un portrait de la famille princière avec les enfants petits, en 1687, par Pierre Mignard, laisse deviner la mésentente du couple. On y voit le père de famille à l’écart du groupe, déjà empâté, vaguement ennuyé et rêvant d’autres plaisirs, la mère, triste, le regard absent, épuisée par de trop nombreuses grossesses, qui tient mollement la main potelée de son dernier-né, le fils aîné, impétueux, brandissant une lance, et le cadet, plus calme, occupé à caresser son petit chien.

La troisième partie aurait pu fournir le sujet d’une exposition à part entière tant elle est pléthorique : il s’agit de donner un aperçu des immenses collections d’œuvres d’art réunies par Monseigneur dans son dernier appartement à Versailles – trois pièces au rez-de-chaussée, au sud du corps central du château –, puis dans le domaine de Meudon que Louis XIV racheta pour lui à la veuve du marquis de Louvois (ancien secrétaire d’État à la Guerre puis surintendant des bâtiments du roi), en 1695.
Une salle donne un aperçu du mythique cabinet des Glaces de Monseigneur à Versailles, chef-d’œuvre de marqueterie – pour les murs, le parquet et les consoles – de l’ébéniste Charles Boulle, et quelques-unes des extraordinaires pièces d’orfèvrerie, gemmes, porcelaines et statuettes en bronze qui s’y trouvaient, aujourd’hui dispersées.
Un peu plus loin, un film offre une intéressante reconstitution en 3D du château de Meudon vers 1715, avec son « château-vieux » datant du XVIe siècle et le « château-neuf » que bâtit Jules Hardouin-Mansart pour le Dauphin entre 1706 et 1709. Plusieurs des plus beaux salons et cabinets de ces deux châteaux sont présentés, ainsi que la chapelle accolée au château-vieux, également édifiée par Hardouin-Mansart en même temps que celle de Versailles.
Les fabuleux jardins conçus par André Le Nôtre pour Louvois dans les années 1680, simultanément au chantier de Versailles (et à ceux des autres résidences royales) sont évoqués par des dessins d’Israël Silvestre et des eaux-fortes plus tardives de Jacques Rigaud.

En dépit des panneaux explicatifs, le visiteur est un peu perdu à travers ces vastes espaces et ne comprend qu’à la fin de la visite que, de toutes ces merveilles, il ne reste pas grand-chose : le château-vieux a été incendié en 1795 et le château-neuf, occupé par les Prussiens et bombardé depuis Paris en 1871.
Louis de France meurt en 1711, à 49 ans, de la variole, une maladie tellement contagieuse qu’il est inhumé sans cérémonie à Saint-Denis. Louis XIV le pleure mais la cour l’oublie bien vite, occupée à enterrer ses successeurs : le petit Dauphin, son épouse, puis leur fils aîné, moins d'un an plus tard. Une gravure au burin représente un projet de monument funéraire pour son tombeau, qui ne fut jamais réalisé.
jusqu’au 15 février 2026
au Château de Versailles,