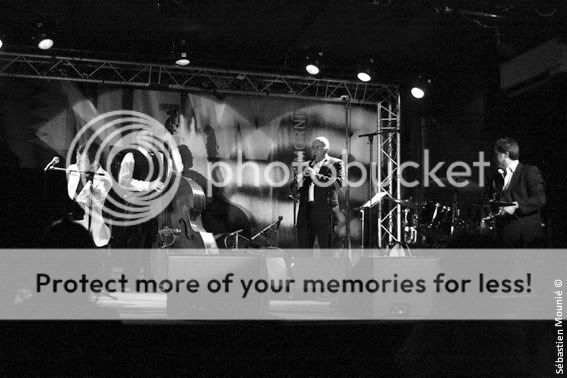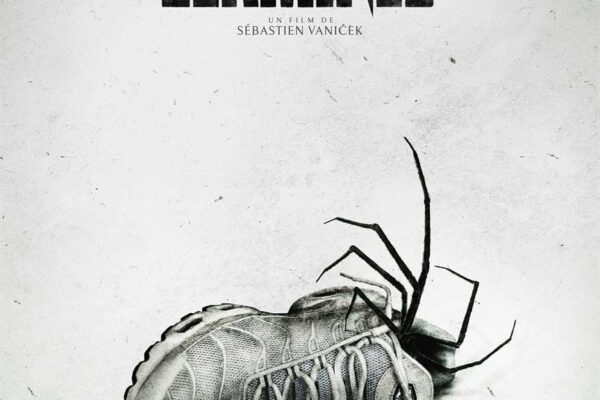RÊVE GÉNÉRAL / Agnès BIHL / (Banco Music-2010)

Agnès Bihl nous appelle au rêve général. Un nouveau virage pour cette chanteuse qui nous avait ému lors de son précédent album, Demandez le programme, plus rebelle et intimiste.
Agnès Bihl nous appelle au rêve général. Un nouveau virage pour cette chanteuse qui nous avait ému lors de son précédent album, plus rebelle et intimiste. Pour cet album, Agnès Bihl invite des artistes comme Grand corps malade, Alexis HK, Didier Lockwood ou Dorothée Daniel qui signe à elle toute seule plus de la moitié des paroles de l’album.
Si le duo avec Grand Corps malade est plutôt maladroit, le texte tombe à plat à côté de la qualité des autres textes, le reste des rencontres apporte un nouveau souffle à Agnès Bihl qui emprunte des chemins plus légers comme dans De bouche à oreille, petite cantate enfantine optimiste sur le devenir de la planète, reprise en chœur par des enfants.
On retrouve toute l’énergie d’Agnès Bihl qui déclame des textes sur des airs de musette et de swing manouche. Les grands styles populaires des heures de gloire de la chanson française sont déclinés, de la valse au tango en passant par le blues. Le rythme est souvent soutenu et met en avant une gaieté même lorsque le questionnement sur l’amour est présent dans C’est encore loin l’amour ?. ou Habitez-vous chez vos amants ? avec Alexis HK.
Je pleure, tu pleures, il pleut est une jolie chanson d’amour accompagnée au piano qui donne envie d’en entendre plus. L’acoustique met davantage en valeur les textes que lorsque l’orchestration est nombreuse. On se dit alors qu’un album sur ce mode aurait pu tenir largement la route. A ce titre, le SDF Tango avec accordéon chromatique, violon, est une belle réussite, comme Véro qui prouvent encore une fois que c’est dans l’équilibre entre un beau texte et une orchestration acoustique simplifiée mais de qualité qu’Agnès Bihl est la plus touchante et la plus convaincante.
Decorum – KATEL – (V2 Music -2010)


Katel nous revient avec « Decorum ». Un album aux tonalités pop forgé dans des chemins de traverse rock. Entre bousculades et dédales, Katel enfonce le clou de l’anticonformisme. Bravo.
Quelle joie de retrouver la voix de Katel ! Une énergie positive mise au service d’une parole qui s’amuse à chercher perpétuellement les ruptures. Si ce nouvel album est plus pop que rock dans les arrangements, on retrouve la hargne vocale de la demoiselle et surtout l’art de prendre les chemins de traverse pour nous surprendre et bousculer notre âme.
Les textes sont toujours appuyés par une articulation volontaire de mots qui ont tout leur poids, sans excès. Un Dominique A au féminin qui assume sa féminité et son humanisme. « Je suis la racine et le papillon mais au fond je ne sais plus le nom » « Je suis une Muse ou une putain, avant la fin tu n’en sauras plus rien » (Decorum). Un incessant aller-retour entre une tumultueuse intériorité et la banalité du réel rejeté en bloc. Une démarche poétique en somme.
Les arrangements penchent clairement sur des ambiances oniriques. Alors on ne sera pas surpris de retrouver Nosfell sur le Chant du cygne, un chant percutant propulsé par des chœurs puissants et vertigineux qui mettent Katel en avant sur un fond de guitares mordantes. Une projection qui la place entre perdition et élévation.
La musique tourbillonne quand les phrases enchainent non sens et contournement pour toucher une forme d’absolu. Katel cherche de toute évidence à s’évader du réalisme pour toucher une abstraction figurative qui donne la part belle à la musique. Les motifs se répètent, se superposent, s’entrechoquent, s’épuisent, s’effacent, se « réverbent » (Les Parfums d’été).
L’album est émouvant par la forme du texte volontairement déstructurée et chanté par un timbre aigu souvent porté par des chœurs. Le désir de se livrer aux aléas de la vie remet au goût du jour l’envie de liberté. « Où est l’insoumis qui vivait en vous ? Où est ce chien qui mordait votre cou ? Ce chien invisible quand vous deveniez fou, mon vieil ami ? Où sont les phrases ? » (Mon vieil ami) Une bénédiction !
La pochette de l’album rend clairement hommage au travail d’Escher qui détournait le réel pour construire l’impossible et mettre en abîme une géométrie de l’infini.Chez Escher lui rend un brillant hommage en finissant sur un angoissant violoncelle...
Katel parle souvent de folie et de délivrance. Un chant amoureux de l’abandon pour partir dans l’Ailleurs et célébrer l’intouchable. L’album est le parfait reflet d’une tête qui prend le risque de s’échapper de la circularité du monde pour atteindre l’inattendu et l’impossible verticalité. A écouter. En boucle.
Sébastien Mounié © Etat-critique.com - 06/05/2010
Concert au New Morning de Matthieu BORE


Matthieu Boré était au New Morning. Crooning et swing au programme. L’art de faire danser les notes.
Salle bondée au New Morning. Matthieu Boré est entouré de Stephen Harrison à la contrebasse, de Guillaume Nouaux à la batterie, de Guy Bonne à la clarinette et au sax tenor. Seront invités Ferruccio Spinetti à la contrebasse et Jean Marc Labbé au sax.
Costume blanc et pompes blanches, Matthieu est au piano. Dès le départ Boré donne le LA de la soirée, une musique jazz directement inspirée des années 50. Entre swing et rock’n’roll, Matthieu insuffle dans ses mélodies toute sa jeunesse et toute sa tonicité pour un charme évident. Entre la douceur d’Elvis et la vivacité d’un Cab Calloway qui se cacherait derrière le piano mais plus pour très longtemps…
Les musiciens s’amusent beaucoup sur scène et on aimerait s’amuser davantage dans la salle. Les culs frétillent rapidement sur les chaises trop serrées du New Morning. Les genoux font la pompe. On a simplement envie de tout envoyer valdinguer pour saisir sa partenaire de gauche et enchainer des pas de danses endiablés, comme au temps fort du Caveau de la Huchette.
Stephen Harrison, le contre bassiste, lui, s’éclate. Costume trois pièces cravate, coupe de cheveux gominée et houpette de circonstance, le musicien au masque neutre, jubile intérieurement et se met
de côté pour mieux taper sur sa contrebasse.
Les pales de la climatisation se mettent en route et nous voilà dans un tripot des bas-fonds Chicagoans. Les hélices tournent. Steven vient à l’avant-scène, fait faire des 360 à sa contrebasse quand il n’avance pas sa main surmontée d’un peigne noir pour remettre dans l’axe capillaire sa gomine-à-reluire. On sourit et on applaudit devant tant de comédie. Un air de bonheur.
On voyage, on pense à Louis Prima, aux danseurs de claquettes et aux autres artistes de Music-Hall montés sur scène pour nous amuser plus que pour se nombriliser. Le concert est au-delà de son dernier album Frizzante (« pétillant » en italien). Une vraie rencontre avec la fraîcheur et la créativité d’artistes présents pour être, sans esbroufe dissimulée. On joue et on assume. On fait le spectacle pour un jazz populaire qui a fait danser des cohortes de noctambules.
Matthieu oublie une grille pour le sax, qu’importe, on ajoute quelques grilles pour permettre au sax de chorusser et de partager avec le public ses moments de bonheur. Le public ne participe pas assez, on stoppe, on dialogue le sourire en coin avec le public et ça repart au piano. La voix est convaincante, les compositions de structure classique sur le fond mais modernes sur la forme et le ton utilisé. Une jolie pêche même s’il nous manque un peu de scat pour parfaire le tableau.
Boré et ses musiciens ont la classe décontractée de ceux qui préfèrent l’authenticité du jeu à l’essai d’incarnation marketé des grandes figures du jazz. Pour cette honnêteté musicale et ce swing remis talentueusement au goût du jour, on dit Bis ! A écouter et à danser …
10 questions à Louis-Ronan CHOISY

Louis-Ronan Choisy sort Rivière de plumes. L'occasion pour la rédaction de le rencontrer et de lui donner la parole pour notre traditionnel "10 questions à ..."
Bonjour Louis-Ronan,
Vous êtes assis confortablement ?
Bon, alors voilà : www.etat-critique.com a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer… et dix questions à vous poser.
On y va ?
D'abord la mauvaise nouvelle : la fin du monde est pour la semaine prochaine.
Maintenant, la bonne nouvelle : vous serez le seul survivant (ou presque) et vous avez le pouvoir de sauver 10 monuments de votre Panthéon personnel.
Voici les thèmes . A vous de désigner les heureux élus !
1. Le disque que vous souhaitez sauver
The good book de Louis Armstrong
Pour sa compassion et le parfum de mon enfance
2. Le film que vous souhaitez sauver
Singing in the rain
Si c'est la fin du monde, un peu de Monde merveilleux où tout est beau, où les gens chantent et dansent sous la pluie, ne peut pas faire de mal
3. Le livre que vous souhaitez sauver
Les œuvres complètes de Rimbaud
Pour sa vérité, sa force et sa capacité à faire voyager
4. La bande dessinée que vous souhaitez sauver
Le deuxième tome de la série Tétralogie du monstre, 32 décembre, d'Enki Bilal
Pour ses dessins fabuleux et son histoire tortueuse
5. L'homme que vous souhaitez sauver
Adam
Pour une deuxième chance
6. La femme que vous souhaitez sauver
Eve
Pour une deuxième chance
7. L'objet, le lieu ou le monument que vous souhaitez sauver
Un piano
Pour voyager
8. L'émission télévisée que vous souhaitez sauver
Tracks sur Arte
Pour apprendre ce que l'on apprend nulle part ailleurs
9. Le plat (ou repas) que vous souhaitez sauver
Pain beurre
Miam miam!!!
10.Votre œuvre personnelle que vous souhaitez sauver
Refuge de Francois Ozon
Car c'est un très beau film avant tout...
Et puis dans lequel j'ai la chance de pouvoir marier deux grandes passions : la musique et le cinéma
Merci Louis ! Nous transmettons votre liste à qui de droit…
http://www.louisronanchoisy.com/
Les Justes, Albert CAMUS

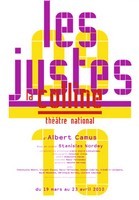 Au Théâtre La Colline jusqu’au 23 avril Stanislas Norday nous propose une intense mise en scène des Justes d’Albert Camus.
Au Théâtre La Colline jusqu’au 23 avril Stanislas Norday nous propose une intense mise en scène des Justes d’Albert Camus.
Les Justes, ou l’abîme de la révolte. Dans cette pièce de 1949, l’homme révolté de Camus déploie toute l'étendue de ses interrogations, l’ambiguïté et la tragédie de sa position, son immense valeur et sa misérable situation.
L’action de la pièce s’inspire des événements historiques de la Russie du début du siècle dernier lorsque le Parti socialiste décide et réussit à exécuter à la bombe le grand-duc Serge. Les trois protagonistes de l’Histoire, Ivan, Stepan et Dora, ici incarnés respectivement par Vincent Dissez, Wajdi Mouawad et Emmanuelle Béart, représentent les différentes façons d’être terroriste, ils étirent toutes les facettes contenues dans la nécessité et dans les limites de la violence politique et dans son but social imparfait et ambigu.
Quelle valeur possède la vie d’un homme ? Celle d’un homme au pouvoir ? Celle d’un jeune intellectuel ? Et celle d’un enfant riche ? Le suicide de l’exécuteur est-il une forme de légitimation de l’assassinat ? L’intelligentsia peut-elle agir au nom du peuple et conduire vraiment le peuple à sa libération ? Les générations futures sont-elle le seul espoir de rachat de ces terroristes qui refusent le salut divin ?
Un décor à la fois essentiel et imposant, un jeu extrêmement affecté et étiré dans la durée, des comédiens qui, ne se touchant presque jamais et même ne se regardant qu’à peine dans les yeux, personnifient avec force et intensité le système clos de différents discours idéologiques qui se confrontent : leurs corps deviennent pur dialogue, un questionnement complexe et inachevé, toujours à reproposer avec acharnement, sur les possibles raisons et sur les justifications éthiques d’un geste violemment radical et politiquement fondamental.
http://www.colline.fr/les-justes.html
Gloria Morano
© Etat-critique.com - 18/04/2010
Description d’un combat, Maguy MARIN

 Sur scène au Théâtre de la Ville jusqu’à samedi 27 mars, le nouveau spectacle de Maguy Marin, une création qui confronte la danse aux limites du mouvement et de l’épopée.
Sur scène au Théâtre de la Ville jusqu’à samedi 27 mars, le nouveau spectacle de Maguy Marin, une création qui confronte la danse aux limites du mouvement et de l’épopée.
Dans le noir, neuf danseurs arrivent soudainement devant les spectateurs, les uns après les autres et restent debout, immobiles. Puis, en alternant, ils commencent à réciter des vers de l’Iliade, le terrible bain de sang entre Troyens et Achéens. Ils ne s’arrêteront qu’au bout d’une heure dix, à la fin du spectacle et, tout au long de la performance la scène restera sombre.
Derrière les danseurs, un sol bleu-vert qu’ils dévoileront petit à petit. Les tissus qu’ils enlèvent déploient ainsi le sens de leur récitation, ce sera le seul contre-point visuel au texte déclamé : de l’or, puis du rouge – l’héroïsme, puis la boucherie. Par moments se surimposeront aux vers de l’Iliade des passages d’autres auteurs en italien, portugais, espagnol, anglais et allemand et s’érigera ici une confrontation sensible entre l’épopée classique et la narration personnelle plus contemporaine.
Maguy Marin construit ainsi un rythme visuel et acoustique presque entièrement monocorde, pointé par quelques instants de surprise, de rupture sonore ou figurative (des images surgissent, les voix individuelles se transforment brièvement en un chœur).
Il s’agit d’un jeu sur l’épuisement que certains spectateurs refusent et que d’autres admirent passionnément : soit on est magnétisé, soit on reste indifférent et on s’ennuie. C’est une réflexion radicale sur la littérature, sur les images qu’elle produit et sur les possibilités de les représenter en déclinant la solution facile de la figuration directe. C’est ainsi également une méditation plus globale sur le mouvement, sur la visibilité, sur le son et le rythme.
Personnellement, une expérience fondamentale et émouvante.
Gloria Morano
© Etat-critique.com - 26/03/2010
Genre Oblique, Brigitte SETH et Roser MONTLLó GUBERNA

 Entre théâtre et danse, la dernière création de la Compagnie Toujours Après Minuit propose une énergique réflexion sur les normes et les conventions, l’identité ressentie à l’intérieur de soi-même et celle partagée par l’entourage auquel les corps sont soumis.
Entre théâtre et danse, la dernière création de la Compagnie Toujours Après Minuit propose une énergique réflexion sur les normes et les conventions, l’identité ressentie à l’intérieur de soi-même et celle partagée par l’entourage auquel les corps sont soumis.
Une ironie irrésistible, un comique excellent investissent la scène dès le début de la représentation. Et aussi une merveilleuse capacité à bouleverser les images conventionnelles des gestualités et des mouvements grâce à des corps différents par rapport à ceux auxquels on est habitués dans les créations de danse contemporaine.
Des corps décalés qui jouent de leur différence, de leurs exagérations, des travestissements successifs qui créent des liens entre les six comédiens-danseurs. Des corps qui déséquilibrent les frontières du féminin et du masculin, du nu et de l’habillé, du gracieux et du comique et qui inventent sous nos yeux de nouvelles possibilités visuelles et sensitives - simplement de nouvelles images.
Ces frontières symboliques auxquelles s’accompagnent de riches expériences autour du langage : se mélangent différentes langues (le français, le castillan et le catalan) et différents accents et les monologues qui passent d’un personnage à l’autre (Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna mettent en scène de vrais personnages, dont on saisit chaque caractère, chaque force individuelle), d’une bouche à une autre, à indiquer la multitude des possibilités expressives, la fragilité des liens humains, le langage à la fois comme lieu de l’intime et de la façade sociale.
Les corps, leurs travestissements et leurs paroles, les musiques, l’espace - tout cela ensemble creuse des déplacements stratifiés dans le ressenti des gestes et des mouvements. Entre intimidation des costumes de l’autorité religieuse (une référence au XVIe siècle espagnol et à la figure historique de Juana I de Castille et d’Aragon) et sensualité soudaine et irréfrénable, avec sa nouvelle création la compagnie Toujours Après Minuit séduit le public en le plongeant dans un jeu irrésistible de sensations et de comique.
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-lang-190-fr
Gloria Morano
© Etat-critique.com - 11/03/2010
FOR THE MASSES – HADOUKEN! – (Surface Noise Recordings-Naïve-2010)


J’étais sur les pistes de ski. Je venais de recevoir le dernier disque d’Hadouken. Je me suis dit : « allez, on va se marrer un peu ». J’ai mis mon casque sur les oreilles… J’ai failli me tuer.
Hadouken revient avec For the masses. Produit sur son label Surface Noise Recordings, le disque confirme les premiers ressentis du premier album qui a fait un tabac : Music for an accelerate Culture.
Dès le premier titre, on sent qu’Hadouken veut s’adresser à une foule dansante qui veut un son puissant pour clamer sa rage de vivre. Le son rock moderne alterne beat de rap et guitares métal hurlantes. Disto saccadée sur samples inspirés de tecno transe, un mélange des genres qui ne vise qu’une seule chose : vous faire sauter sur place le poing en l’air. Orgiaque. De l’interprétation des raves…
Ce jour-là, j’ignorais tout. Hadouken… Bizarre comme nom. J’ai lancé mon lecteur, les basses ont fait bondir mon bonnet ancré sur mon crâne, la musique m’a soudain fait croire que j’étais un super-héros de la glisse, un athlète local recalé pour les JO de Vancouver par manque de reconnaissance. Hadouken vous transcende.
La piste rouge ne devient qu’une piste de luge. Masque devant les yeux, bâtons serrés dans les mains, me voilà projeté en avant par des chœurs carl-offiens s’élèvant d’un bas-fond métallique. Me voilà descendant tête en avant la piste rouge. Ouch ! A 2’00 pétantes le beat vous assomme et me voilà slalomant entre trois mémés chasse-neigeantes et un lacet de bambins suivant une canne habillée de rouge. Un moniteur probablement, je n’ai pas eu le temps de le voir.
« Turn the lights out » débute… Une phrase scandée qui relance le tout. Hum ! Et on regrette de ne pas à être à un concert pour sauter. On va se lancer sur la prochaine bosse…« You can’t stop this » « I don’t know where we are » chante James Smith. C’est un peu vrai mais ce n’est pas grave, on y va quand même. Tête baissée on ferme les yeux et on prie pour que les genoux tiennent…
« Evil » clame maintenant « I won’t go, I won’t go »… Et un regret vous prend le cours d’un instant. Quel bien fait cette satanée musique ? Pourquoi ai-je pris cette bosse ? Le réveil ne va-t-il pas être douloureux ? Pas de réponse car les gimmicks successifs de « House is falling » ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Une alternance de rythmes qui enfonce des portes ouvertes et qui ne révolutionne pas le genre mais qui vous amuse avec une auto-dérision assez rare dans le genre. C’est tout simplement bien fait. Jouissif pour la dépense d’énergie. Les genoux ont tenu.
« Mic Check » est un must dans le genre, montée en puissance, rupture, beat puissant et voix violente qui dégueule « Check one check two one mic ckeck ! » De quoi faire chauffer la piste et faire fondre la neige… La descente s’accélère.« Bombshock » « I’m gonna run get my feet on the floor » me lance James Smith. Il me voit skier! Du coup, plus de carre. Ca glisse… Je fonce, je suis un danger parmi les dizaines de skieurs évités… Un mono, une mémé, un papi, un surfeur, un panneau ralentissez, un enfant, une balise, le panneau ralentissez ?…Je suis hors-piste. Puis le vide. De l’air. Le vent. Le beat dans les oreilles. Jusqu’à « Lost » le dernier morceau de l’album. Un pisteur m’accueille au bas des pistes… Hadouken ? me lance-t-il.
Allongé, endolori, je lui dis : Hadouken !
A consommer avec modération…
http://www.myspace.com/hadouken
Tournée en France :
17/03 - Cabaret Electrique, Le Havre
18/03 - La Maroquinerie, Paris
19/03 - La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand
20/03 - Le Marché Gare, Lyon
Sébastien Mounié © Etat-critique.com - 10/03/2010
Uprising / In your rooms, Hofesh SHECHTER

 Jusqu’au 21 février le Théâtre de la Ville invite la compagnie de Hofesh Shechter pour un double spectacle intense et enthousiasmant.
Jusqu’au 21 février le Théâtre de la Ville invite la compagnie de Hofesh Shechter pour un double spectacle intense et enthousiasmant.
Pour la première fois, le public parisien a la possibilité de découvrir ces deux performances récentes du chorégraphe israélien résident en Angleterre : Uprising (2006) et In your rooms (2007) enchantent et enflamment les spectateurs grâce à une énergie infatigable et une époustouflante présence des corps sur scène.
Dans Uprising, Shechter emploie un septet masculin qui, avec ironie et puissance, constitue par moment un contrepoint, à d’autres moments une alliance dynamique avec la musique électro-indu et le jeu des lumières régnant sur scène. Le spectacle engage directement les entrailles du public, il ne cesse de le solliciter avec la force des sons et des lumières et, surtout, avec des gestualités et des mouvements toujours imprévus et vigoureux, à la fois spontanés et contrôlés, populaires et sophistiqués. Uprising laisse les spectateurs le souffle coupé.
In your rooms présente, au contraire, une dizaine de danseurs mixtes, accompagnés sur scène par cinq musiciens et en off par une voix ironique et amusante qui s’exprime à la première personne. Après une première partie dans laquelle apparaissent et se succèdent de très courtes mises en scène, presque photographiques, toujours inattendues et surprenantes, la deuxième partie de la performance est un flux ininterrompu auquel participent tous les danseurs : un rythme fulgurant et frénétique autour duquel se construit une intense réflexion chorégraphique sur la relation à l’autre, les pouvoir politiques, l’énergie des corps, les différences et les liens possibles à l’intérieur d’un groupe. Une gestualité et des mouvements - basés notamment sur les passages au sol - encore une fois multiformes et déroutant, où se mélangent des éléments contemporains et urbains avec d’autres plus traditionnels. Ressort ainsi une spiritualité insolite et impressionnante, faite d’extase pure, pointée subtilement, mais énergiquement d’ironie et de plaisanterie inlassables.
Un travail puissant et éloquent sur l’humanité et sur la communication - à ne pas manquer.
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-hofesh-shechter-150
Gloria Morano
© Etat-critique.com - 19/02/2010
LA FABBRICA, Ascanio CELESTINI et Charles TORDJMAN

 Le Théâtre de la Ville choisit de débuter l’année 2010 par une adaptation de la pièce de 2001 du célèbre comédien et humoriste italien Ascanio Celestini, mise en scène par Charles Tordjman.
Le Théâtre de la Ville choisit de débuter l’année 2010 par une adaptation de la pièce de 2001 du célèbre comédien et humoriste italien Ascanio Celestini, mise en scène par Charles Tordjman.
Comment transposer le monologue de Celestini, la récitation toute particulière de ce jeune artiste italien, pour le rendre accessible au public français ? Comment adapter en France le style mordant d’Ascanio Clestini qui, depuis une dizaine d’année, raconte l’Histoire de l’Italie à travers des dialogues de la vie quotidienne, à travers un langage populaire et un accent romain très caractéristique et qui, la plupart du temps, ne remplit la scène presque nue que par l’éloquence de sa voix et de son visage, par le rythme infatigable de ses phrases ?
Si Celestini a conçu La Fabbrica comme un flux irrépressible d’où prennent forme et consistance les différents personnages de l’usine, leurs vicissitudes et leurs sentiments, Charles Tordjman, en accord avec le comédien italien, a choisi de confier la récitation du monologue en alternance par Agnès Sourdillon et Serge Maggiani et de les faire accompagner sur scène par la chanteuse Giovanna Marini qui, avec trois autres choristes, interprète en italien des chants traditionnels et d’autres écrits de Celestini et Marini eux-mêmes.
Cette interaction entre plusieurs présences sur scène se révèle une bonne solution d’adaptation de la pièce italienne. La multiplicité des voix, le ton décalé et naïf de Sourdillon et Maggiani, la poésie et la force des chanteurs sur scène donnent vie à une pièce à la fois ironique et lyrique dans laquelle la narration se développe à un rythme soutenu et, par la description de la vie quotidienne et des luttes d’usine, rend tangible l’Histoire de l’Italie du début du XXe siècle jusqu’aux années 70, en passant notamment par les deux guerres et l’époque fasciste.
Bien que le ton général trahisse légèrement le style de Celestini en devenant parfois trop pathétique et les chants trop prépondérants par rapport à la narration des comédiens, l’adaptation française de La Fabbrica se révèle tout à fait réussie.
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-la-fabbrica-131
Gloria Morano
© Etat-critique.com - 06/01/2010